Publiée une fois par année, la Revue électronique suisse de science de l'information (RESSI) a pour but principal le développement scientifique de cette discipline en Suisse.
Présentation de la revue
Contenu du site
Se connecter
Publié par Ressi
WikiBiGe, un wiki qui bouge
Ressi — 30 avril 2008
Résumé
Ce compte-rendu décrit l’expérience d’un groupe de bibliothécaires dans la mise en place d’un wiki comme outil de communication et de partage de connaissances pour les bibliothécaires de l’Université de Genève. Les statistiques de consultation des pages du wiki sont analysées depuis sa création afin de dégager les tendances de son utilisation. Il en ressort que le dynamisme et la mise à jour de l’information sont cruciaux pour que les pages soient consultées. L’utilisation du wiki pour gérer les projets en cours et en informer les professionnels est un bon moyen pour motiver la consultation et la participation.
Abstract
This report reviews the experience of a group of librarians who set up a wiki as a communication and knowledge-sharing tool for librarians at the University of Geneva.
Through analysis of visitor statistics of the wiki pages consulted since its creation, a sense of the usage trends of the target community has been developed. The results of the study highlight that frequency of information change and the addition of up-to-date information are crucial factors for pages to be frequently consulted and re-visited. It was found that the use of the wiki for managing on-going projects and keeping participants informed was a good means to encourage consultation and participation within the community.
WikiBiGe, un wiki qui bouge
Introduction
Suite à une présentation d’Iris Buunk, bibliothécaire à la Faculté des sciences économiques et sociales, sur les outils du Web 2.0 et ses applications possibles dans les bibliothèques, un groupe de bibliothécaires de différentes Facultés de l’Université de Genève s’est formé spontanément pour mettre sur pied un wiki au service des bibliothécaires. Le but était d’avoir un outil qui facilite l’échange et le partage d’informations, d’idées ou d’expériences, et renforce la communication et la cohésion entre des bibliothécaires dont les lieux de travail sont disséminés en plusieurs endroits de la ville.
Pourquoi un wiki ?
à la différence d’une plateforme collaborative classique, la mise en place et la gestion d’un wiki sont simples, ce qui permet un gain de temps notable et évite l’implantation d’un système plus complexe, souvent géré par l’intermédiaire d’informaticiens dont on dépend par la suite. La facilité d’édition en temps réel est un autre atout non négligeable, car cela permet effectivement de travailler “ensemble” et (presque) en même temps sur un dossier.
La définition du wiki donnée par Wikipedia (2007) reprend effectivement ces deux aspects liés à la collaboration et à la simplicité : « Un wiki est un système de gestion de contenu de site Web qui rend les pages Web librement et également modifiables par tous les visiteurs autorisés. On utilise les wikis pour faciliter l’écriture collaborative de documents avec un minimum de contraintes.»
Un wiki, outil typique du Web 2.0, rime également avec transparence, puisque toutes les modifications des pages peuvent être librement consultées, et partage, puisqu’il permet le travail collaboratif, ce qui en fait un excellent outil de “Knowledge Management”.
Pourquoi un wiki des bibliothécaires à l'Université de Genève?
De telles fonctionnalités ont vite séduit les bibliothécaires qui ont constitué spontanément un groupe de travail. Le WikiBiGe (Université de Genève, 2007) était né.
Certes, c’était un moyen de se mettre à la page et d’appliquer les développements du Web 2.0 de façon concrète. Mais outre cet “effet de mode” (avant le WikiBiGe, la création d’un blog avait été envisagée), un outil collaboratif de ce type devait contribuer à renforcer l’échange et la collaboration entre les professionnels.
Assez vite, les objectifs du WikiBiGe ont donc été définis comme suit :
- améliorer la communication entre les différents professionnels des bibliothèques
- disposer d’un espace d’échange collaboratif
- favoriser et consolider la collaboration
- fédérer l’accès à l’information professionnelle
- partager les connaissances
- capitaliser les compétences
De tels objectifs pouvaient sembler ambitieux et malgré tout, le groupe de travail s’accordait à dire que “l’outil” wiki n’allait pas changer les pratiques d’échanges d’informations - aussi limitées fussent-elles jusqu’alors - du jour au lendemain. Le WikiBiGe ne resterait qu’un moyen incitant à échanger entre collègues, fournissant une plateforme pour cet échange. Il n’allait pas être LA solution miracle qui ferait de ses utilisateurs des “hypercommunicants”. L’utilisation de l’outil wiki ne devait pas être une finalité en soi, mais constituer une forte incitation à renforcer ce qui faisait légèrement défaut : la communication.
Création du WikiBiGe
L’enthousiasme des participants au groupe de travail a été tel qu’il a provoqué une gestion de projet un peu particulière : plutôt que de débuter par des études d’opportunité et de faisabilité, et donc de multiplier les réunions, il a été décidé de créer le wiki aussi vite que possible ! Certains ont donc commencé par élaborer le contenu et la structure du wiki, pendant que d’autres recherchaient et testaient divers logiciels. Le choix s’est assez rapidement porté sur le logiciel libre DokuWiki (DokuWiki, 2007). Les principaux arguments en sa faveur relèvent de la technique : scripts écrits en PHP - langage maîtrisé en interne, importante communauté d’utilisateurs, donc nombreux templates (modèles) et plug-ins, simplicité intrinsèque due à l’absence de base de données. Plus pragmatiquement, le choix a également été effectué en fonction de ce qu’il était possible d’installer sur les serveurs de l’Université avec l’aide du webmaster. Notons qu’un blog a été créé pour échanger les informations dans le groupe de projet, mais celui-ci a vite été abandonné, car la plus classique communication par e-mail s’est révélée être amplement suffisante lors de cette phase de démarrage.
Deux mois après la rencontre initiale, le wiki était en ligne: léger au niveau du contenu, mais néanmoins installé avec les fonctionnalités de base permettant de le développer. Le choix du contenu a bien sûr évolué depuis le début, mais les thèmes principaux sont restés les mêmes. La structure thématique s’est également adaptée à la mise en place de groupes de travail réfléchissant à une réorganisation générale des bibliothèques universitaires de Genève.
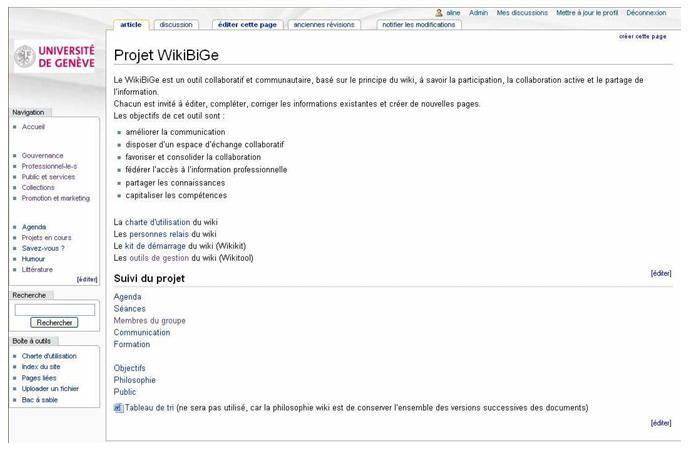
Fig. 1: Exemple d’une page du WikiBiGe: la page du projet WikiBiGe lui-même
Formation
Le wiki a été officiellement présenté au personnel des bibliothèques en mai 2007 lors d’une séance de travail. Celui-ci a eu la possibilité de s’autoformer ou de participer à des sessions de formations organisées. Dès lors, chacun-e a eu la possibilité de consulter, d’insérer ou de modifier le contenu du wiki.
Autoformation :
Dans une Boîte à outils, plusieurs documents permettent à chacun de se familiariser avec le wiki:
- Le wikikit ou kit de démarrage fournit les informations nécessaires à l’inscription sur le wiki.
- Avant toute nouvelle utilisation, chaque personne est tenue de consulter la charte d’utilisation.
- Un mode d’emploi présente les principales manipulations.
- Un bac à sable permet de faire ses premiers pas sans risques.
Formation en groupe :
Des formations en petits groupes d’une dizaine de personnes ont été proposées sur chaque site de l’Université de Genève en juin 2007. Commençant par la présentation du principe du wiki ainsi que des principales manipulations, elles ont permis à chaque participant de se familiariser avec le WikiBiGe en pratiquant quelques exercices. Notons que ces formations ont rencontré un vif succès !
Thématiques et usages actuels :
Voici les thématiques principales présentes dans WikiBiGe :
- Gouvernance : tout ce qui touche à la direction et à la gestion des bibliothèques
- Professionnel-le-s : profils (et compétences) des collègues, formation continue, offres d’emploi
- Public et services : prêt, formation documentaire, services de référence, catalogues
- Collections : politique d’acquisitions, catalogage, indexation, classification, ressources électroniques
- Promotion et marketing : mission, animations
- Agenda : agenda des formations continues et évènements professionnels
- Projets en cours : espace réservé aux projets en évolution (WikiBiGe, archives institutionnelles, implantation de SFX, etc.)
- Humour : page essentielle!
- Littérature : page qui regroupe des liens sur des sites web et des articles d’intérêt professionnel, classés par thème.
Ou, puisqu’une image vaut mille mots:
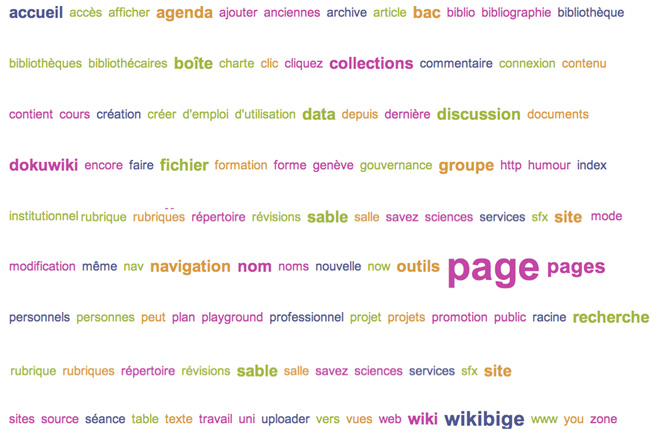
Fig. 2: Tag cloud du WikiBiGe
Ce tag cloud ou “nuage d’étiquettes” se base sur la version HTML du wiki qui contient près de 100’000 “mots”! Les étiquettes représentées ici sont constituées d’au moins trois lettres et apparaissent au minimum 30 fois (les noms de personnes ont été éliminés, l’algorithme utilisé est celui de mozcloud). Plus le mot est gros, plus il apparaît fréquemment dans le wiki.
Rubriques les plus utilisées
Des statistiques d’utilisation ont été récoltées, correspondant au nombre de clics sur une rubrique par mois (y compris plusieurs clics lorsqu’on désire éditer une page). Les graphiques ci-dessous donnent une idée de la consultation du WikiBiGe, mais il faut garder à l’esprit que le nombre de clics n’est pas forcément égal au nombre de personnes ayant consulté la page et encore moins à l’utilisation de cette page. A noter également que le nombre de personnes inscrites sur le wiki est de 117 le 6 décembre 2007.
La figure 3 montre la fréquentation globale du wiki. On observe nettement un grand intérêt durant les mois de mai et juin (le wiki a été lancé en mai), puis une diminution au fil des mois suivants. Le regain de consultation que l’on pouvait attendre après la pause de l’été est visible, mais relativement faible. On retrouve logiquement la même tendance dans les autres graphiques.
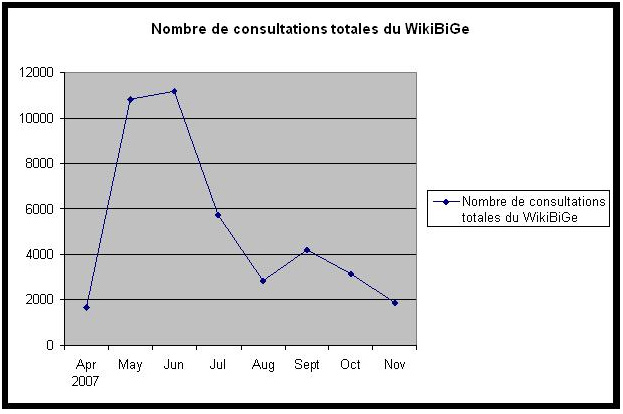
En ce qui concerne les rubriques principales (figure 4), les Projets sont très consultés car ils permettent au personnel des bibliothèques de se tenir au courant des projets en cours ainsi que de leur évolution. Chacun peut donc être au même niveau d’information quel que soit le poste qu’il occupe dans la bibliothèque. La page Professionnel-le-s a également du succès car elle contient les pages personnelles des collègues, toujours très consultées (voir figure 7). A noter que la seule page à nouveau bien consultée après la pause de l’été est celle des projets en cours. Les autres pages sont liées aux différents groupes de travail, gelés jusqu’à nouvel avis.
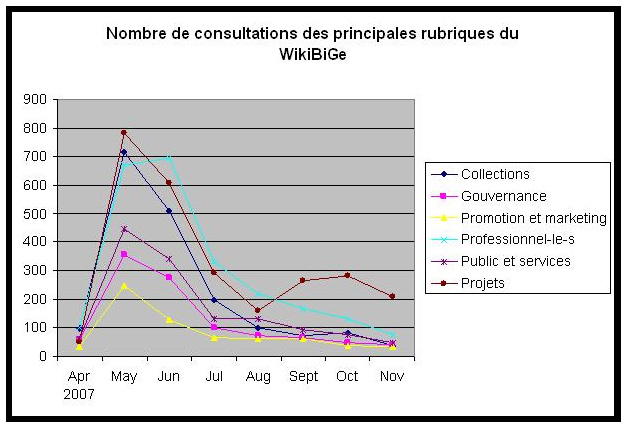
La figure 5 détaille la consultation des pages Projets. Très logiquement, c’est le projet du Wiki lui-même qui est le plus consulté puisque les bibliothécaires instigateurs de cet outil sont des convaincus et l’utilisent pour la gestion complète du processus (y compris la rédaction de cet article). Les autres projets concernent les divers groupes de travail (les données “Groupes de travail” correspondent au total des consultations de sept groupes). Ceux-ci étant gelés, leur consultation tend vers zéro.
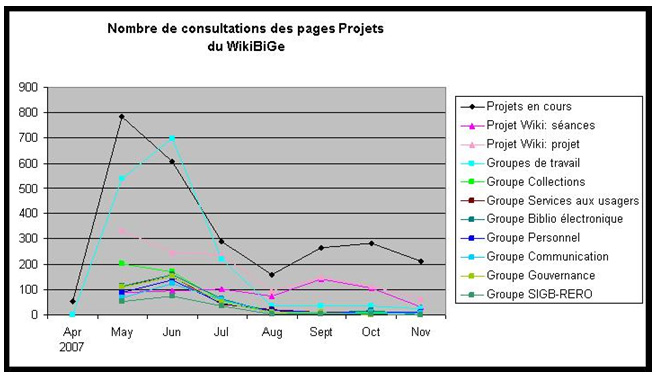
La figure 6 présente les projets ajoutés au wiki dès septembre. Ces pages suscitent une consultation modeste (chaque projet n’intéresse pas forcément toute la communauté des professionnels) mais réelle.
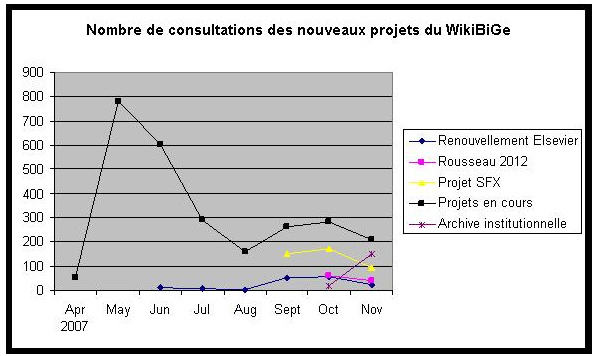
Dans la figure 7, les autres rubriques sont analysées et comme mentionné plus tôt, ce sont les pages personnelles des collègues qui ont le plus de succès, mais l’intérêt retombe lorsque tout le monde les a visitées. On peut remarquer le concours de la plus belle page personnelle lancé en juillet : le pic de juillet concerne l’appel à créer ces pages, et le pic de septembre l’appel à voter pour la meilleure.
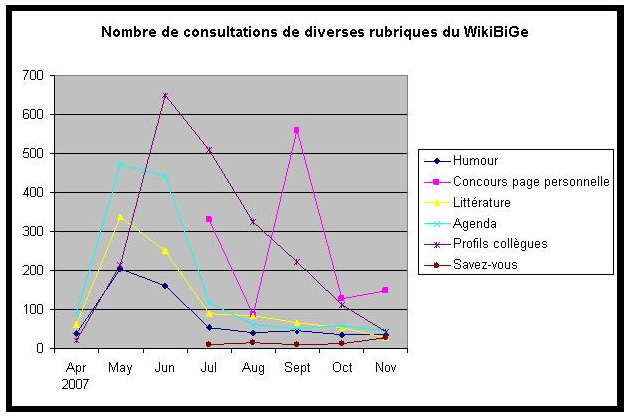
La figure 8 enfin représente la consultation des divers outils permettant à chacun de se familiariser avec le wiki et ses fonctionnalités. Le bac à sable a été pris d’assaut lorsque tout le monde a voulu y faire ses premiers pas, puis l’intérêt pour ces outils est vite retombé.
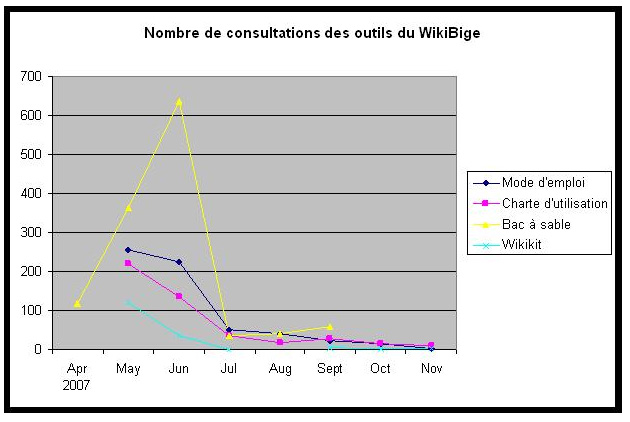
Et l'avenir alors ?
Cet outil est encore jeune, mais on peut déjà noter que le nombre d’utilisateurs inscrits dépasse la centaine, et les graphiques ci-dessus montrent que certaines rubriques rencontrent de l’intérêt.
Pour que ce type d’outil Web 2.0 apporte un vrai plus à la communication (par rapport à un site web simple, ou une communication par e-mail), il est nécessaire d’encourager la consultation et la participation, ce qui constitue un véritable défi. Comme le dit Liziard (2007), <« l’utilisateur doit pouvoir s’approprier le site et avoir un intérêt à y participer.»
Pour rendre la consultation du WikiBiGe attractive, quelques idées ont déjà été mises en oeuvre comme le concours de la plus belle page personnelle, mais d’autres actions sont nécessaires. On peut remarquer que lorsqu’une page est statique, sa consultation tend vers zéro après quelques temps. La mise à jour et l’apport de nouvelles informations sont donc cruciaux pour que l’intérêt demeure. A noter par exemple que l’organisation de la page d’accueil a été repensée: elle va être utilisée pour mieux diriger l’utilisateur, tout en restant claire et dynamique (ajout de nouvelles, etc.). L’ajout de pages consacrées aux nouveaux projets est également un bon moyen de rendre le wiki indispensable à tous ceux qui désirent se tenir informés.
Le taux de participation à la vie du wiki dépend, lui, de la motivation de la communauté à être proactive. En général, seul un petit pourcentage des personnes participent véritablement à l’enrichissement du wiki, les autres se contentant de le consulter. Encourager les groupes de projet à utiliser cet outil pour leur communication interne ou externe permet par exemple aux professionnels de s’habituer à son utilisation.
Il sera également intéressant d’observer ce qu’il se passera dans le cas où la nouvelle directrice nommée au poste de Direction de l’information scientifique pour l’Université de Genève reprend ce wiki comme outil de communication, comme cela avait été initié à la naissance de ce wiki avec la directrice précédente.
Dans tous les cas, il est indéniable que le suivi et la sauvegarde de l’historique des projets des bibliothécaires et de la vie des bibliothèques en général en sont facilités. Le côté convivial de l’outil ressort également des nombreuses consultations des profils des bibliothécaires et du concours du plus beau de ces profils.
Quoi qu’il en soit, s’habituer à un nouvel outil prend toujours du temps et la surveillance des statistiques de consultation futures permettra de confirmer ou non le succès à long terme de WikiBiGe.
Conclusion
Cet article a été rédigé, corrigé, modifié et recorrigé à 18 mains, mais sur des claviers différents... C’est aussi ça, la “magie” du wiki. Les bibliothécaires de l’Université de Genève sont-ils désormais en plein surf sur les vagues du Web 2.0 ? Même si les vagues ne sont pas encore hautes, c’est déjà un début !
Bibliographie
DOKUWIKI (2007). Wiki:dokuwiki. In : DokuWiki [en ligne]. Modifié le 07 mars 2007, [consulté le 06.12.2007]. http://wiki.splitbrain.org/wiki:dokuwiki
LIZIARD, David (2007). Travail collaboratif avec un wiki : pistes à partir d’expériences de bibliothécaires. Bulletin des Bibliothèques de France [en ligne], [consulté le 19.12.2007], t. 52, no. 6, p. 56-59. http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/2007/06/document.xsp?id=bbf-2007-06-0056-012/2007/06/fam-dossier/dossier&statutMaitre=non&statutFils=non
UNIVERSITE DE GENEVE (2007). WikiBiGe : le wiki des bibliothécaires de l’Uni [en ligne]. Modifié le 04 décembre 2007, [consulté le 06.12.2007, accessible uniquement depuis le réseau informatique de l’Université de Genève]. http://lnxweb.unige.ch/biblio/WikiBiGe/doku.php?id=accueil
WIKIPEDIA (2007). Wiki. In : Wikipédia, l’encyclopédie libre [en ligne]. Modifié le 23 novembre 2007, [consulté le 06.12.2007]. http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki
La notion de solidarité archivistique pour les Archives fédérales suisses : définition, historique de leur engagement, activités actuelles et autres réflexions sur la question
Ressi — 30 avril 2008
Andreas Kellerhals
La notion de solidarité archivistique pour les Archives fédérales suisses : définition, historique de leur engagement, activités actuelles et autres réflexions sur la question
NDLR : A l’occasion d’une rencontre du Forum des Archivistes genevois, Monsieur Andreas Kellerhals, directeur des Archives fédérales suisses est intervenu sur le thème de la solidarité archivistique. La finalité première du texte qui a servi de support à son intervention n’était certes pas la publication mais le contenu étant intéressant, nous avons décidé de le proposer à nos lecteurs.
S’il est question de solidarité inter-archivistique, donc de projets de soutien entre Archives auxquels les Archives fédérales suisses (AFS) participent, c’est d’habitude le projet de coo-pération avec les Archives nationales d’Albanie qui est mentionné en premier.
Programme de modernisation des archives d’Albanie
Ce projet court depuis 1994 et il est le programme d’entraide le plus complet que nous ayons réalisé. Grâce au financement de la Direction du développement et de la coopération (DDC) et à l’aide de nos experts, les Archives nationales d’Albanie ont pu être modernisées fonda-mentalement. Les locaux administratifs et magasins d’archives ont été entièrement rénovés et un système IT complet a été mis en place. Ce projet de longue haleine a engendré en outre une large palette d’actions complémentaires, telles que l’édiction d’une nouvelle loi sur les archives, la digitalisation des instruments de recherche, la création d’un site internet per-mettant l’interrogation des fonds d’archives (1), l’ouverture d’une nouvelle salle de lecture et la mise en place d’une formation en archivistique pour la région. L’engagement de la Suisse auprès des Archives nationales d’Albanie a ainsi permis de renforcer la position de cette ins-titution auprès de son gouvernement et du public et a surtout permis la promotion de la « bonne gouvernance » pendant la période de transition en Albanie.
Cela dit, il ne faut pas oublier que c’est aussi un projet qui a traversé nombre troubles politi-ques : chez notre partenaire de projet se sont succédés trois gouvernements et quatre direc-teurs d’Archives – en 1997, pendant une courte guerre civile, nous avons même connu trois directeurs différents en six mois. Ces changements, ainsi que le dernier changement de gouvernement en juillet 2005, ont souvent occasionné d’importants retards dans l’avancement du projet.
Cette coopération avec l’Albanie est-elle typique de la solidarité archivistique ? Ou encore : Que faut-il entendre par solidarité archivistique ? Nous pouvons en donner une définition gé-nérique en parlant des efforts de la communauté archivistique internationale pour mener des projets d’assistance à l’étranger dans le but de développer les outils et l’expertise nécessaire aux communautés en voie de développement et à celles en transition. Adoptons cette pers-pective, mais n’oublions pas que le terme de solidarité a également une connotation plus combative provenant du mouvement ouvrier ou des mouvements de libération, un élément que l’on ne retrouve pas nécessairement dans la coopération entre gouvernements ou agen-ces étatiques.
Les formes d’actions de la communauté internationale sont diversifiées et la distinction entre coopération et solidarité reste parfois vague. Il est ainsi possible de trouver réunis sous cette appellation tant :
- La collaboration avec des partenaires pour partager informations et expériences pro-fessionnelles, ce qui représente plutôt une forme de partenariat qu’une action de so-lidarité au sens stricte du terme.
- Les échanges d’experts dans des buts de formation et d’enseignement. Dans ce contexte s’inscrit ainsi notre coopération au projet PIAF (2) mené par l’Association inter-nationale des archives francophones – un projet qui a récemment été présenté dans le cadre du Forum des Archivistes Genevois.
- La fourniture de fonds, d’expertise et/ou de matériel pour réaliser des projets archivis-tiques concrets.
Il faut noter en outre que la solidarité archivistique ne se déploie pas uniquement sur le plan international et dans l’axe nord-sud, mais également au niveau européen ou même national. Elle ne se limite pas non plus à une solidarité entre institutions mais peut aussi bien se dé-ployer entre professionnels. Les actions de solidarité peuvent donc viser à former des archi-vistes, à fortifier une institution d’Archives ou même à consolider, par l’appui aux Archives, la démocratie et l’état de droit ainsi que de protéger les droits de l’homme.
La solidarité archivistique a une longue tradition et au cours du temps les initiatives locales, régionales et internationales se sont multipliées. Il est toutefois difficile d’en obtenir une vision globale et les actions entreprises mériteraient souvent d’être coordonnées pour gagner en efficacité, au lieu de se trouver dans une situation de concurrence peu fructueuse entre les pays « donateurs ». Pour répondre à ce besoin d’orientation et de coordination, le Conseil International des Archives, à travers son projet « Archives solidaires », s’est attelé à la tâche du recensement des nombreuses formes d’assistance et de relations qui s’établissent entre institutions d’archives à travers le monde.(3)
Mais revenons à l’action des Archives fédérales suisses. Initialement grâce à la sensibilité de mes prédécesseurs, puis dès 1998, conformément à l’inscription du principe dans la loi sur l’archivage, les AFS ont poursuivi plusieurs projets de collaboration avec des institutions d’archives étrangères.
En jetant un regard en arrière, je crois pouvoir identifier quatre types d’action de notre part :
- Une première prise de conscience de notre responsabilité se manifeste dans l’engagement continu des AFS au sein du Conseil international des Archives depuis les années 1970 (Oscar Gauye en a été le président, Christoph Graf le vice-président et président de la Conférence Internationale de la Table rondes des Archives). La solidarité s’oriente vers la promotion de la fonction de l’archivage et les échanges dans la profes-sion. Il s’agit donc en première ligne d’une solidarité dans la profession et non entre les institutions.
- Depuis les années 1980, les AFS en tant qu’institution relativement nantie ont mené une série d’actions ponctuelles et bilatérales à l’égard des institutions les plus défavorisées. Ces actions étaient toutefois très dispersées et leurs résultats difficilement quantifiables. Cela englobait tant des activités de formation, des échanges de littérature, des visites scientifiques que l’élaboration de programmes de développement ou de numérisation, etc.
- La dissolution de l’ex-bloc soviétique et les besoins consécutifs en expertise et finance-ments européens sont ensuite venu modifier quelque peu la donne. Afin de mener une action efficace et concertée, la communauté archivistique européenne a dû concentrer son action. Dès ce moment, les AFS sont donc entrées dans une phase d’action intensive et recentrée. Conformément à une répartition tacite des sphères d’influence, l’Albanie a dès lors principalement bénéficié de notre expertise et de nos ressources. D’autres projets de coopération nous on également conduit en Lituanie (formation générale en collaboration avec la Suède), en Russie (numérisation des archives de la KOMINTERN).
- Par la suite, nous avons été motivés par une volonté d’action plus générale et moins immédiatement basée sur les besoins matériels des institutions aidées. En collaboration avec la Direction du développement et de la coopération (DDC), les AFS ont lancé un programme de sensibilisation intitulé « Information et bonne gouvernance ». L’objectif était de sensibiliser les institutions d’archives de pays émergents aux liens étroits qui existent entre la gestion de l’information et des documents, d’une part, et l’Etat de droit et le processus de démocratisation, d’autre part. Cet ambitieux programme ainsi que le volume global de notre action d’entraide a toutefois dû être drastiquement redimensionné en raison de contraintes politiques et financières.
Cette distinction de quatre types d’actions reste toutefois purement analytique. Les différents styles d’engagement des AFS ne se sont pas succédé dans le temps. Chaque nouveau projet a englobé la somme des expériences faites précédemment (lessons learned) pour évoluer vers la forme d’action la plus adaptée à l’objectif poursuivi. La solidarité archivistique telle que pratiquée par les AFS présente donc un mélange de formes, d’actions et d’objectifs comme vous pourrez le constater dans les deux exemples suivants :
- INCOMKA, programme international de numérisation et d'indexation des archives de la IIIème Internationale – dite Internationale communiste ou Komintern – est l’un des plus grands projets de coopération archivistique jamais entrepris. Le projet piloté par le Conseil International des Archives (ICA), placé sous l'égide du Conseil de l'Europe et soutenu par huit organisations partenaires, dont les AFS, a conduit, après 10 ans de travail, à la réalisation et l’enrichissement d'une base de données documentaire consacrée au communisme interna-tional. Regroupant l'ensemble des inventaires du fonds du Komintern (22 000 pages et 1 059 354 documents numérisés choisis par un comité scientifique), cette base constitue une réelle avancée pour les chercheurs qui s'intéressent à l'histoire politique de l'Entre-deux-guerres. Ce projet est donc un projet multilatéral qui ne s’adresse pas à un seul pays bénéficiaire mais inclut le partenaire russe comme partenaire équivalent et qui a comme objectif d’une part de renforcer les institutions des Archives mais également de promouvoir la transition démocratique en Russie, en empêchant une relecture de l’histoire glorifiant les phases non-démocratiques, voir dictatoriales.
- Nous nous concentrons aujourd’hui sur des activités axées sur la thématique « Archives et Droit de l’homme » dont voilà l’un des projets conduits par les AFS : Accueil d’une copie des archives de la police guatémaltèque. En ma qualité de responsable de l’axe de programme prioritaire du CIA intitulé « Défense et promotion des archives », j’ai souhaité plaider notre cause auprès du Conseil des droits de l’homme, qui siège à Genève. Organisé conjointement par les AFS, le DFAE et le CIA, un side-event fut donc proposé aux délégués du Conseil, afin de les sensibiliser à l’importance des archives pour la défense des droits de l’homme. Dans le panel d’intervenants, une émissaire du procureur national des droits de l’homme au Guatemala a relaté les faits suivants afin d’appuyer notre démonstration : En 1996, des accords de paix ont mis fin à un conflit qui a duré plusieurs décennies au Gua-temala. Par la suite, le gouvernement a toujours nié l’existence d’archives de police. Toute-fois, en 2005, on découvre par hasard environ 8km/l d’archives de la police nationale dans les caves d’une caserne : rapports de police, plans, décrets officiels sont empilés à même le sol, disposés là comme de simples déchets. C’est la compilation la plus importante de ce genre découverte en Amérique latine. Grâce au soutien de la coopération internationale, plus de 200 personnes travaillent aujourd’hui à la remise en état de ces archives, à leur conserva-tion et à la mise en place d’une réglementation de consultation. A ce jour, presque 1,5 millions de documents ont pu être numérisés, un travail de recherche est effectué parallèlement afin de clarifier nombre de cas de violations des droits humains. Ces informations étant des plus sensibles, les archives ne sont toutefois pas à l’abri d’une tentative de destruction à la faveur d’un éventuel retournement politique. Au terme de la table-ronde, la Suisse s’est donc déclarée prête à accueillir une copie de sécurité des archives de la police nationale du Gua-temala dans le but d’en assurer la sauvegarde à long terme.
Voilà donc un échantillon d’exemples concrets de la solidarité archivistique telle que pratiquée par les AFS. Malgré cela, le concept même de solidarité archivistique reste une notion vivante qu’il faut sans cesse redéfinir au gré des changements d’ordre politique, économique et/ou éthique que connaissent nos institutions. Pour preuve en est le fait que la question a encore été discutée lors de la première journée des archivistes nationaux dans le cadre de la dernière Conférence Internationale de la Table rondes des Archives, qui s’est tenue il y a quelques semaines à Québec :
Un retour sur investissement doit-il devenir le critère pour octroyer son aide à des institutions démunies ? Et ce, afin d’éviter de disperser ses ressources pour arroser le désert. Ou bien la solidarité est-elle une action qui se doit d’être désintéressée et affranchie de telles notions d’ordre économique ? Toute institution archivistique légitimée mérite-t-elle un soutien ?
La réponse qui se profile actuellement est qu’un acte de solidarité doit toujours être un acte de solidarité responsable qui inclut la faculté de rendre des comptes. Il faut certes viser un retour sur investissement, même indirect. Mais le critère décisif semble plutôt être la capacité à convaincre nos décideurs politiques. Et l’inscription de tels projets dans une perspective de développement durable nous facilite cette tâche. Renforcer l’état de droit et la démocratie est un bon retour sur investissement, même si nous risquons de nous retrouver proches des missionnaires, en faisant la promotion du système politique juste en lieu et place du dieu juste. La solidarité reste donc un acte à la balance délicate.
Notes
(1) http://www.albarchive.gov.al
(2) Portail International Archivistique Francophone : www.piaf-archives.org/
(3) Groupe de travail « Archives solidaires » créé en 2000 ; http://archives3.concordia.ca/Solidarity/quoi.html
ONLINE INFORMATION 2007 - Appliquer le Web 2.0 : innovation, impact et implémentation
Ressi — 30 avril 2008
Ariane Rezzonico, Haute Ecole de Gestion, Genève
ONLINE INFORMATION 2007 - Appliquer le Web 2.0 : innovation, impact et implémentation
Le congrès Online s'est tenu à Londres du 4 au 6 décembre 2007. Cette 32ème édition a rencontré un succès très important puisque 900 participants représentant 43 pays ont assisté aux nombreuses conférences proposées. Les professionnels participant à cette conférence sont bibliothécaires dans le secteur public ou privé, documentalistes, managers de l'information, spécialistes des NTIC, courtiers, architectes de l'information, spécialistes de knowledge management, webmaster, éditeurs, diffuseurs de contenu, etc.
Les nombreux changements dans les organisations liés à l'évolution du web 2.0 expliquent ce succès et l’on sent aussi une certaine peur de l'avenir exprimée parmi la profession des bibliothécaires en Grande Bretagne. On assiste actuellement à un manque de repères et les thèmes du congrès étaient tout à fait dans l'air du temps et de nature à conforter certains professionnels dans leurs pratiques ou consolider leurs connaissances.
Afin de renforcer les liens entre les participants du congrès, un blog les invitait à commenter les conférences et, nouveauté 2007, ils pouvaient se retrouver sur Facebook.En 2006, beaucoup de conférenciers avaient présenté des expérimentations autour du web 2.0. L'année 2007 a permis de montrer à quel point l'utilisation des réseaux sociaux au sein des organisations devenait courante.
Jimmy Wales, fondateur de Wikipedia a ouvert les feux en revenant sur le travail accompli et en présentant leur nouveau projet WIKIA (1). Wikia est un moteur de recherche basé, comme Wikipedia, sur la communauté des internautes et contrairement à Google, offrant plus de transparence sur son fonctionnement (le code est en open source). Les internautes sont invités à évaluer les résultats et participent à la création de mini-articles de synthèse sur le terme de recherche. Cet outil veut se distinguer de Google par la qualité des résultats et la protection des données privées. Actuellement, l'outil n'est pas encore performant pour réellement concurrencer Google.
Jimmy Wales s'engage dans la mise à disposition de l'encyclopédie sur le continent africain en s'impliquant personnellement dans les projets sur le terrain. Il souhaite que l'encyclopédie rassemble toujours plus d'articles dans des langues actuellement peu représentées. Quant à la fiabilité des informations, il reste toujours prudent en conseillant aux utilisateurs de l'encyclopédie de confronter les informations sur d'autres sources, Wikipedia n'étant pas une source académique !
Les moteurs de recherche : nouveaux acteurs
De nombreux spécialistes des moteurs de recherche ont présenté les dernières innovations dans ce domaine et nous pouvons retenir quelques outils intéressants pour leurs fonctionnalités tels que Facbites.com (2) ou Intelways.com (3). Le premier permet de découvrir dans quel contexte est utilisé un terme de recherche en proposant des résultats sous la forme de phrases extraites des pages. On peut éviter ainsi d'ouvrir des pages qui n'ont pas de lien avec le contenu de notre recherche. Le second offre la possibilité d'effectuer une recherche puis de sélectionner toute une série d'outils dont certains du web 2.0 offrant une comparaison des résultats. Grâce à une série de boutons, on navigue d'un outil à l'autre à travers une interface très conviviale. Ces deux outils sont utiles pour démarrer des recherches.
Tous les spécialistes relèvent que l'utilisation de plusieurs outils pour une recherche professionnelle renforce la pertinence car la couverture du web n'est pas identique d'un outil à un autre et les paramètres de classement et de recherche diffèrent sensiblement. Quant à la notion de "privacy", beaucoup de conférenciers l'ont évoquée en rappelant les liens entre moteurs de recherche, sociétés publicitaires, outils de création de blogs, réseaux sociaux etc. Une image du New York Times illustre bien cette problématique en imaginant l'interface de Google en 2084 (4)! Ces alliances avec les sociétés publicitaires permettent aux moteurs de recherche d'avoir accès à une masse d'information sur les internautes et leurs pratiques sur le web (sites consultés, mots clés, achats). La recherche de blogs, de personnes, de réseaux sociaux, de podcasts, de flux RSS devient très importante et les outils ont tous développé des fonctionnalités offrant ce type de recherche. Des outils permettent d'ailleurs une compilation des résultats sur une même page en présentant ces différents types d'information. L'intégration de types de documents hétérogènes parmi les résultats est toujours plus importante. La recherche autour d'une personne ou d'une organisation est toujours plus accessible grâce à des outils comme LindedIn (5). Cet outil propose un répertoire des internautes inscrits auquel on accède sans s'identifier. Toutefois, pour consulter un profil plus complet, il faut s'identifier.
Les bibliothèques: l'impact des outils du web 2.0
Confrontées à des publics issus de la "génération Google", les bibliothèques ont présenté des applications utilisant YouTube, Second Life, Facebook ou des développements autour des OPAC. Ces derniers sont beaucoup plus proches de ce que proposent depuis longtemps déjà des sites comme Amazon. L'idée est d'aller chercher leurs usagers là où ils se trouvent en leur offrant des applications utiles à leurs besoins. Comme exemple, on peut retenir des présentations des événements de la bibliothèque sur YouTube ou de l'équipe des bibliothécaires (6). La présentation de l'actualité de la bibliothèque sous forme vidéo prend du temps mais semble rencontrer un grand succès. D'autres ont choisi ce moyen pour présenter tous les services de la bibliothèque ou de ses ressources. La British Library a engagé une personnalité connue du public pour cette présentation.
Les OPAC évoluent également en fonction de ces nouveaux outils. La recherche dans les catalogues se transforme et intègre des suggestions orthographiques (did you mean?) à l'instar de Google, des conseils de lectures (ceux qui ont emprunté tel document ont également emprunté tel autre) comme le proposent de nombreux services commerciaux (ITunes, Amazon, etc.). Tout est fait pour encourager la serendipité. Les lecteurs peuvent ajouter des commentaires, classer les documents selon leurs préférences. La recherche visuelle permet de voir quels sont les termes les plus utilisés et l'on peut les mettre en relation avec les emprunts.
Les entreprises 2.0 : knowledge management, rseaux sociaux et intelligence collective
Les jeunes collaborateurs engagés dans les entreprises arrivent avec d'autres méthodes de travail et une grande pratique des réseaux sociaux. Il est donc difficile de leur demander d'utiliser l'e-mail pour travailler sur des projets ! Tant IBM que Microsoft ont intégré depuis déjà plusieurs années le web 2.0 dans leur manière de travailler. Les blogs sont utilisés pour communiquer tant à l'interne qu'à l'externe. Ils permettent également de documenter et organiser son propre travail. Le blog produit parfois des connexions inattendues : des personnes qui ne se connaissent pas entrent en communication et partagent des savoirs. Les employés peuvent mettre leurs photos, ajouter des données (tags) et l'on peut ainsi savoir qui est expert dans quels domaines. Chez IBM, des conférences sont organisées sur Second Life permettant ainsi à tout le monde d'y assister. Ces entreprises créent des mondes virtuels pour s'initier à de nouvelles techniques, rencontrer des personnes ou partager des contenus. Tous les conférenciers ont insisté sur l'importance de distinguer les espaces publics et privés afin de protéger les données sensibles. Le succès de ces applications et de leur utilisation importante dans certaines organisations est totalement dépendant du temps dont dispose le collaborateur pour intégrer ces nouvelles pratiques dans son travail. Certains managers l'ont compris et les conférenciers ont insisté sur cet aspect important.
L’exposition professionnelle : reprer les nouveauts
Pour conclure, quelques mots sur l’exposition professionnelle. Elle rassemble plus de 250 exposants provenant de différentes sphères professionnelles (fournisseur de contenu, gestion de contenus, associations, etc). Elle offre une très belle vitrine à ces exposants qui rencontrent les milliers de visiteurs présents durant ces trois jours. Enfin, une centaine de séminaires gratuits permet de découvrir de nouvelles interfaces de bases de données, d’apprendre des techniques de recherche sur le web ou d’identifier les compétences des professionnels de demain.
Si cette édition 2007 a peu évoqué le web 3.0 voire 4.0, il semble certain que la prochaine conférence de 2008 (7) abordera de manière plus approfondie ces thématiques. Le rendez-vous est fixé du 2 au 4 décembre à Londres.
Notes
(1)http://www.wikia.com/wiki/Wikia
(4)http://www.nytimes.com/imagepages/2005/10/10/opinion/1010opart.html
(6)Lea bibliothèque du Williams College prsentent son quipe – The L-Team – sur YouTube à l'adresse : http://www.youtube.com/watch?v=YwCUtpbUWgk
Une enquête qualitative auprès des publics de BiblioSciences à l’Université de Genève
Ressi — 30 novembre 2007
Florence Muet, Haute Ecole de Gestion, Genève
Céline Bui, diplômée Haute Ecole de Gestion, Genève en Information documentaire
Susanne Lehner, diplômée Haute Ecole de Gestion, Genève en Information documentaire
Nadia Moresi, diplômée Haute Ecole de Gestion, Genève en Information documentaire.
Résumé
Dire que, dans l’univers de la documentation spécialisée, les bibliothèques académiques vivent aujourd’hui une période de transition relève aujourd’hui presque du lieu commun. Un faisceau d’évolutions bouleverse en effet, comme pour d’autres types de services d’information, leur environnement et leurs repères. L’avènement de la documentation numérique modifie en profondeur le métier des bibliothèques, qui passe d’une logique de traitement bibliothéconomique et de conservation de collections à une logique de gestion des accès à des ressources informationnelles multiformes. Le bouleversement vient aussi, et peut-être surtout, des utilisateurs, dont les pratiques documentaires évoluent face à une masse d’informations et de documents numériques directement accessibles, par l’intermédiaire ou non de la bibliothèque. Dans ce contexte, les bibliothèques universitaires sont placées devant l’obligation d’une réflexion sur l’évolution de leur offre de service et de leur positionnement.
L’objectif de cette courte communication est de contribuer à la réflexion sur cette évolution. Il présente les résultats d’une étude qualitative auprès du public potentiel de bibliothèques universitaires, dans le cadre d’un Travail de Diplôme de fin d’études au sein du département Information documentaire de la Haute Ecole de Gestion de Genève. Au-delà de l’objectif de valorisation du travail fait par des étudiantes dans le cadre de leur formation en information – documentation, la présentation de ces résultats, mis en perspective avec quelques autres enquêtes publiées, donne l’opportunité de dresser quelques pistes sur les axes de structuration possibles de l’offre de services des bibliothèques universitaires.
Une enquête qualitative auprès des publics de Bibliosciences de l’Uni Genève
La Faculté des Sciences de l’Université de Genève comprend six sections (Biologie, Chimie, Mathématiques, Physique, Sciences Pharmaceutiques, Sciences de la Terre) et deux départements (Astronomie et Informatique). Elle dispose de sept bibliothèques principalement situées dans Genève : Anthropologie et écologie (Département de Biologie) ; Centre universitaire informatique ; Mathématiques ; Observatoire ; Physique ; Sciences de la Terre ; Sciences II (Biologie, Chimie, Sciences Pharmaceutiques). Ces sept bibliothèques proposent une collection d'environ 300'000 volumes, plus de 1'300 journaux spécialisés, ainsi que de la documentation électronique, gérés par une vingtaine de professionnels. Comme d’autres bibliothèques académiques, elles ont pour mission principale de mettre à disposition des membres de la communauté universitaire la documentation scientifique et technique nécessaire à l’enseignement et à la recherche effectués au sein de l’Université. Le gros de leurs utilisateurs est composé par les membres de la Faculté (étudiants, assistants, professeurs). Le réseau interne constitué par ces sept bibliothèques est aujourd’hui très hétérogène, tant au niveau des budgets que des locaux ou du personnel. Une fonction de coordination a été mise en place (avec la création d’une nouvelle appellation pour l’ensemble des bibliothèques : Bibliosciences), dans la perspective d’une harmonisation progressive de l’offre faite aux utilisateurs. Une réflexion globale est donc engagée sur les évolutions nécessaires de cette offre de service.
C’est dans ce contexte qu’une enquête a été menée entre juin et septembre 2006 par trois étudiantes du département Information documentaire de la HEG Genève, dans le cadre de leur Travail de Diplôme, sous la responsabilité de Florence Muet, professeure à la HEG Genève et d’Anne Christine Robert, coordinatrice de Bibliosciences. L’objectif de l’étude était d’appréhender de façon exploratoire (aucune enquête n’ayant jamais été réalisée dans ce lieu) les pratiques et les comportements documentaires de la communauté desservie par ces bibliothèques universitaires, soit les enseignants et les étudiants. Ce parti pris méthodologique de se centrer sur les pratiques des publics cibles ainsi que sur leur vision des services que devrait proposer une bibliothèque universitaire, et ce dans une logique qualitative (sous la forme d’entretiens semi-directifs en face-à-face), diffère de la pratique plus souvent répandue d’enquêtes d’usages et/ou de satisfaction sous forme d’enquête par questionnaire en sortie de bibliothèque (Renoult, 2006). Au total, une soixantaine de personnes ont été interrogées, dont 18 professeurs, 12 maîtres d’enseignement et de recherche, 14 assistants, 2 chercheurs et 13 étudiants (ces derniers ont été plus difficiles à toucher du fait de la période de réalisation de l’enquête, contrainte par le calendrier du Travail de Diplôme).
Le guide d’entretien proposait un échange autour de quatre principales thématiques, autour desquels nous organiserons la présentation des principaux résultats de l’enquête :
- Les habitudes et lieux privilégiés de travail;
- Les pratiques documentaires personnelles ainsi que la perception des enseignants et des étudiants sur leur propre compétence en matière de recherche d’information;
- L’usage de la bibliothèque et son intégration dans les pratiques personnelles;
- La définition personnelle de la bibliothèque idéale.
Les lieux et les rythmes de travail
Les entretiens montrent la forte mobilité des enseignants mais aussi des étudiants dans leur travail, mobilité dans laquelle la bibliothèque universitaire est repérée comme un des points de chute possibles. Même si des tendances se profilent, il faut noter également la diversité des pratiques, notamment liée aux conditions matérielles de travail disponibles pour les individus.
Les professeurs et assistants possèdent généralement leur propre bureau, salle de travail ou laboratoire. Ils préfèrent effectuer les recherches, lire de la documentation et analyser des données à partir de ce lieu, équipé de tout ce dont ils ont besoin pour leurs activités de recherche. La bibliothèque n’est donc pas utilisée en tant que lieu de travail, mais constitue essentiellement un espace d’accès à l’information papier. « Depuis que l’on trouve pratiquement tout en ligne, il n’y a plus besoin de se déplacer physiquement », déclare un professeur de Physique. « Pour ma part, j’utilise virtuellement la bibliothèque », indique un autre. Cette tendance est générale. Toutefois, certains déclarent se rendre encore occasionnellement sur place afin de consulter et emprunter des ouvrages pour la préparation de leurs cours. « C’est plus pratique d’avoir les livres sur place et comme cela, je n’ai pas besoin de les trimbaler dans mon bureau ! » affirme un physicien. Les enseignants se déplacent énormément pour effectuer leurs activités et travaillent par conséquent souvent ailleurs, voire à l’étranger. Cette mobilité n’a pas véritablement d’impact sur le recours à la littérature scientifique, car ils peuvent accéder aux ressources documentaires de l’université grâce à un accès sécurisé. Dans leurs déplacements, ils peuvent aussi parfois utiliser les bibliothèques locales pour trouver de la documentation.
Les étudiants viennent pour leur majorité utiliser l’espace physique des différentes bibliothèques pour travailler. Bien que certains étudient en priorité chez eux, beaucoup évoquent la distraction à leur domicile : « Je n’arrive pas à travailler chez moi. Il y a le téléphone qui sonne ou je suis souvent tenté de faire autre chose » explique un étudiant. Du coup, « la bibliothèque représente le lieu d’étude par excellence », selon une étudiante en Physique. Les étudiants apprécient le fait de pouvoir venir travailler individuellement à la bibliothèque (ils peuvent même venir avec leur ordinateur portable personnel) mais aussi de pouvoir y retrouver d’autres étudiants. La recherche de contact avec d’autres et le sentiment de solidarité sont ainsi souvent invoqués : « on aime bien se retrouver pour travailler et réviser ensemble… en plus, on a tous les livres sur place». Les périodes d’examens voient également un afflux d’étudiants à la bibliothèque. A l’inverse, on trouvera quelques étudiants qui préfèrent étudier à la maison pour des raisons d’habitude ou parce que la bibliothèque ne leur semble pas assez accueillante (trop bruyante ; pas de véritable salle de lecture).
Le travail à la maison est lié à l’équipement informatique sur place (ordinateur personnel, accès Internet haut débit et imprimante). C’est fréquemment le cas pour les enseignants, qui apprécient également l’isolement possible : « Dans mon bureau, je me fais sans cesse interrompre par le téléphone, des étudiants viennent pour me poser des questions… quand j’ai besoin de calme, je préfère travailler chez moi ». Même si la plupart du personnel enseignant pris en compte affirme ne pas aimer travailler à la maison pour des raisons variées (temps à consacrer à la famille, trop de distractions, etc.), presque tous sont obligés de le faire, le temps à disposition pendant la journée étant parfois insuffisant pour finaliser leurs tâches (lecture et rédaction d’articles, analyse de données ou préparation de cours). En revanche, de manière générale, les étudiants partagent leur temps de travail entre la maison et d’autres endroits, notamment les bibliothèques.
Certains étudiants utilisent plusieurs bibliothèques, celle de leur faculté mais aussi d’autres. Les arguments avancés concernent autant la recherche d’un confort de travail meilleur que la possibilité d’accéder à des collections connexes. On remarquera cependant que plus la bibliothèque est perçue comme bien fournie en ressources documentaires, moins le recours à d’autres bibliothèques est fréquent. Par contre, la qualité du confort de travail devient un critère premier dans les périodes de révision d’examen.
On le voit donc, la bibliothèque n’est plus, et de loin, le seul lieu physique d’accès aux informations et à la littérature scientifique. Les technologies Internet permettent une mobilité des enseignants et des étudiants, mobilité dont ils usent fortement. La tendance est générale. Une étude américaine récente montre que 41,5% de la population académique travaille le plus souvent hors du campus (Friedlander, 2002). Le constat de la forte baisse de la fréquentation des bibliothèques universitaires par les enseignants et les chercheurs est général (Van Dooren, 2006). Une autre enquête auprès de publics étudiants montre en fait deux profils : les assidus, qui fréquentent très régulièrement la bibliothèque pour y travailler sur leurs notes mais aussi exploiter les collections ; et ceux qui utilisent la bibliothèque à distance et ne font qu’y passer pour emprunter voire y séjourner un temps court pour consulter (Maresca, 2005).
Les pratiques documentaires
Les types de documents utilisés
Les articles scientifiques électroniques sont les documents les plus sollicités par les professeurs et assistants interrogés, qui les ont tous cités comme source principale pour la recherche. L’accès aux articles de revues électroniques permet aux enseignants de suivre rapidement l’évolution de leur domaine. Le recours à ce type de document est donc très fréquent pour eux, voire quotidien. Les monographies viennent en second lieu et sont surtout utilisées pour rappeler les connaissances de base ou comme références pour la préparation des cours. Viennent ensuite les actes de conférence. Selon les domaines, certains peuvent avoir recours à d’autres types de documents, par exemple des documents iconographiques ou audiovisuels.
Généralement, les enseignants préfèrent rechercher et effectuer une lecture rapide à l’écran pour des questions d’efficacité afin d’évaluer le contenu du document. Certains professeurs n’aiment pas lire sur écran et impriment systématiquement, le support papier étant plus confortable pour la lecture. D’autres repèrent le titre, lisent l’introduction, l’abstract et la conclusion, puis impriment si nécessaire. Le support papier est donc privilégié pour la lecture approfondie pour des raisons de confort mais aussi pour son côté pratique : il a encore l’avantage d’être transportable et permet de faire des annotations (par exemple l’attribution de mots-clés personnels), des comparaisons, de surligner et reste par conséquent un support de travail très apprécié. Un seul enseignant dit lire à l’écran et utilise pour cela Adobe 7, qui permet de faire directement des annotations.
De leur côté, les étudiants recherchent en priorité les monographies citées dans les bibliographies données par leurs professeurs (dont la valeur prescriptive a déjà été montrée, voir Després-Lonnet et al. 2006). Il s’agit surtout d’ouvrages et de manuels de base, qu’ils privilégient parce qu’il s’agit de document très structurés. La lecture d’un chapitre est généralement préférée à une lecture intégrale de l’ouvrage. Les étudiants préfèrent aller chercher les livres à la bibliothèque, éventuellement les feuilleter avant de les emprunter pour pouvoir les lire ailleurs, notamment à la maison. Ils effectuent aussi souvent des photocopies de parties intéressantes, avec une pratique d’annotation personnelle très répandue. Les articles sont recherchés plus occasionnellement, notamment pour des séminaires et les travaux de fin d’étude. Le reste du temps, les étudiants se basent essentiellement sur les polycopiés distribués par les professeurs pour préparer leurs examens : « Ils sont bien faits, je n’ai donc pas besoin de chercher d’autres informations », déclare un étudiant en Physique. De ce fait, ils connaissent peu les ressources en ligne (périodiques électroniques) proposées par la Faculté des Sciences et une minorité les utilise. La prédominance des polycopies et des ouvrages comme source documentaire première des étudiants a déjà été montrée par des enquêtes plus vastes. Par exemple, un étudiant de sciences humaines de l’Université Paris 4 passe en moyenne deux heures par jour de lecture sur ses polycopiés et notes de cours et autant sur des livres (Singly, 2005).
Il est intéressant de relever que la plupart des personnes interviewées conserve les documents lus, en essayant de suivre une certaine rigueur dans leur classement personnel. Pratiquement tous les étudiants classent ces copies personnelles par cours, alors que les professeurs et assistants semblent plutôt les différencier par thème. L’archivage se fait principalement sous forme papier. L’enregistrement des articles sous forme électronique se répand cependant de plus en plus, souvent d’ailleurs en complément du document papier. Les articles sont enregistrés en format PDF dans des dossiers sous un répertoire personnel. Une minorité de personnes utilise une version étendue d’Acrobate Reader (version PDF Maker) ou un logiciel de gestion de bibliographie comme Endnote ou Reference Manager pour ce type d’archivage. Certains professeurs enregistrent dans un dossier commun les articles électroniques intéressants pour les mettre à disposition du groupe de recherche ou des collègues. On notera aussi que la quasi totalité des enseignants possède une collection personnelle de livres, dont l’ampleur varie beaucoup en fonction du statut et du département de rattachement (dans certains domaines, par exemple en mathématiques, le prix des ouvrages est souvent exorbitant et rend plus difficile une acquisition personnelle). De manière globale, les ouvrages achetés constituent une référence de base dans le domaine de recherche. Ils sont acquis indépendamment du fait que la bibliothèque les possède ou non, les enseignants mettant en avant le besoin d’avoir ces ouvrages sous la main et ce à long terme.
Les sources d’information utilisées
Les professeurs, chercheurs et assistants préfèrent rechercher leur documentation dans les bases de données scientifiques généralistes (ScienceDirect, Web of Science, etc.) ou spécifiques à leur domaine d’activité (par exemple Chemical Abstracts pour la chimie ou MathScinet pour les mathématiques). Très peu d’étudiants consultent régulièrement ce type de source d’information. Bien qu’ils aient la possibilité de découvrir les bases de données relatives à leur domaine en naviguant sur le site web des bibliothèques, ceux qui les connaissent ont découvert ces sources surtout par le bouche-à-oreille entre eux ou dans certains cas grâce aux cours de formations dispensés par les bibliothécaires ou à leurs professeurs.
Certains professeurs et quelques très rares étudiants disent rechercher assez régulièrement des articles dans le catalogue des bibliothèques, sur le portail de périodiques suisses (PSP) ou dans le catalogue collectif suisse des publications en série « RP » (qui n’est pourtant plus actualisé depuis 2002) pour la recherche de documents anciens. Pour la recherche de livres, ils choisissent de consulter le catalogue des bibliothèques de la Faculté, intégré dans le catalogue collectif du réseau documentaire romand RERO. La consultation des catalogues d’autres bibliothèques semble rare. Un seul professeur indique par exemple utiliser de temps en temps le catalogue collectif NEBIS (Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz) ou le site web de la Bibliothèque Nationale de France.
Si la plupart des enseignants semble relativement à l’aise avec la recherche dans les catalogues, ce n’est pas du tout le cas pour l’ensemble des étudiants, dont certains ignorent leur existence ou en ont « juste entendu parler ». Un étudiant parmi d’autres précise : « Quand j’ai besoin d’un livre, je vais me promener dans les rayons. Je sais où se trouve le domaine qui m’intéresse. Si je ne trouve pas, je demande aux bibliothécaires ! ». Généralement, les étudiants repèrent les rayons d’ouvrages relatifs à leur domaine d’étude lors de leur première visite à la bibliothèque ou demandent au personnel de lui indiquer où se trouve ce dont ils ont besoin. Par la suite, ils se rendent directement au rayon correspondant. Au niveau des recherches, on peut constater que très peu de personnes connaissent les fonctions de recherches avancées dans RERO.
Notons aussi que le réseau est très actif dans le milieu scientifique : les chercheurs se transmettent les sources et les références entre eux. Deux maîtres d’enseignement et de recherche déclarent avoir installé un système d’alerte personnalisé sur leur profil afin d’être informés régulièrement des actualités du domaine.
Pour les recherches d’informations plus générales, Google est cité par quasiment tous. Ils se servent de Google surtout quand:
- Ils n’ont pas d’informations précises sur un sujet afin de se faire une idée de base et cherchent ainsi à cibler le domaine de recherche;
- Quand ils ont besoin d’une petite information rapide et simple, notamment la recherche d’une définition sur un dictionnaire en ligne;
- Pour la recherche d’informations génériques, comme par exemple celles figurant sur le site Internet d’un chercheur (ex. bibliographie).
Google Scholar est utilisé par quelques professeurs qui le préfèrent à sa version standard : ils trouvent les résultats beaucoup plus ciblés et s’en déclarent très satisfaits. Cet outil a également été cité par quelques rares étudiants (la majorité d’entre eux ne connaît pas l’outil), tout aussi satisfaits quant aux résultats. Cependant, l’un d’entre eux avoue tout de même « ne pas trop comprendre comment ça marche ».
L’usage de la bibliothèque et de ses services
Un autre thème de l’enquête concernait l’usage de la bibliothèque et sa place dans les pratiques documentaires des enseignants et des étudiants. Le niveau de fréquentation des bibliothèques diffère en fonction des différents départements. Cela peut dépendre du fait que des usagers d’un domaine spécifique ont plus besoin de s’y rendre régulièrement que d’autres, comme par exemple en Mathématiques, où la bibliothèque constitue un outil de travail quotidien et indispensable pour les chercheurs.
En général, les individus interrogés vont à la bibliothèque selon leurs besoins ou leur emploi du temps. Leur taux de fréquentation ne dépend donc pas de facteurs internes à la bibliothèque (par exemple trop de monde). En revanche, le type d’utilisation des bibliothèques varie relativement peu au sein des différents départements. Les activités les plus pratiquées dans les sept bibliothèques sont pratiquement les mêmes : la consultation rapide, l’emprunt et le travail sur place.
Trois usages principaux de la bibliothèque ressortent de l’enquête:
- La consultation rapide sur place et l’emprunt des documents sélectionnés. Une pratique assez commune est celle de se promener entre les rayons pour feuilleter des ouvrages. Les ouvrages retenus sont ensuite le plus souvent empruntés. De manière globale, les usagers connaissent assez bien les ouvrages relatifs à leur domaine et ont une connaissance plus générale de l’intégralité de la collection. Ils vont chercher les livres directement au rayon correspondant. Les personnes qui semblent bien connaître le contenu global des bibliothèques sont à la Faculté depuis relativement longtemps et savent où se trouvent les ouvrages à force d’en emprunter. D’autres affirment mieux connaître les nouveautés ou l’actualité relative aux périodiques. Le fait que les bibliothèques de Physique et de l’Observatoire soient petites facilite aussi la connaissance du contenu.
- La consultation d’ouvrages et de revues sur place sans emprunt, qui est presque toujours le fait des enseignants.
- Le travail sur place avec des documents et outils personnels, essentiellement par les étudiants.
- On voit donc que, de manière générale, outre la zone de travail évoquée précédemment, la zone de stockage des bibliothèques reste bien utilisée par les usagers. La plupart viennent repérer les ouvrages intéressants, voir s’il y a des nouveautés ou chercher des livres dont ils possédaient la référence. Le guichet de prêt est également très sollicité par les utilisateurs pour des raisons liées au prêt des ouvrages ou à la demande de renseignements. D’autres usages de la bibliothèque sont mis en avant :
- Commander des articles : c’est l’une des principales raisons pour lesquelles les professeurs se rendent à la bibliothèque. Cette activité a été citée par l’ensemble des professeurs, chercheurs et assistants.
- Proposer des nouvelles acquisitions : pratiquement tous les enseignants se rendent à la bibliothèque pour soumettre leurs propositions ou envoient leurs demandes par courrier électronique au bibliothécaire. En revanche, les étudiants effectuent moins de propositions d’achat soit parce qu’ils n’ont pas la possibilité de le faire dans certaines bibliothèques, soit parce qu’ils ignorent cette opportunité.
- Demander des renseignements : bien qu’aucune bibliothèque ne dispose de service de référence à proprement parler, plus de la moitié des usagers vient régulièrement ou occasionnellement demander des renseignements aux bibliothécaires. Généralement, les questions des enseignants sont plutôt relatives à l’accès aux ressources électroniques alors que celles des étudiants concernent essentiellement la recherche d’ouvrages.
- Faire des photocopies : cette activité est plus particulièrement citée par les assistants et les étudiants. En Pharmacie, certains y vont aussi pour imprimer des posters, car la bibliothèque de Sciences II possède une imprimante couleur.
- Effectuer des recherches bibliographiques : en plus des recherches électroniques, qui peuvent être faites aussi à distance, la plupart des usagers interrogés effectue aussi de temps en temps des recherches bibliographiques de livres ou d’articles dans des revues sur format papier. Les professeurs cherchent plutôt des monographies spécialisées ou des articles ; les étudiants des livres mentionnés dans les bibliographies distribuées par les professeurs ;
La plupart des usagers interrogés connaît les services de prêt, de prêt inter bibliothèques et de renseignements. Ces trois services sont d’ailleurs ceux qui sont les plus utilisés. Les personnes ne fréquentant pas d’autres bibliothèques ont notamment souvent recours au prêt inter bibliothèques.
On remarque donc que ce sont principalement les services de base, « traditionnels », des bibliothèques, qui sont utilisés. Ainsi, la majorité des professeurs et quelques étudiants sondés connaissent l’existence des cours de formation à la recherche documentaire par bouche-à-oreille, mais un seul étudiant de la section de Chimie en a suivi un. D’autres professeurs savent qu’il existe un service d’alerte qui peut les informer par mail des nouvelles acquisitions de la bibliothèque. Malgré la connaissance de l’existence de ce service, un grand nombre de professeurs néglige ces mails d’avertissement. Ce recours principal aux services de base est aussi mentionné dans d’autres études. Par exemple, une enquête auprès des étudiants de la bibliothèque de l’Université Paris X montre également le poids dominant de la consultation sur place et de l’emprunt des ouvrages et la méconnaissance globale des ressources numériques proposées : plus de la moitié des étudiants utilise les ressources papier de la bibliothèque mais seulement un sur dix consulte les périodiques électroniques (Dupuy, 2006). Une étude récente faite auprès du public étudiant de la bibliothèque de l’Université Paris 8 apporte un éclairage plus précis sur les usages sur place de la bibliothèque. Basée sur un volume important de réponses, elle a permis l’identification statistique de trois principaux profils d’usagers : ceux qui utilisent principalement la bibliothèque comme lieu de travail (50%) ; ceux qui utilisent quasi uniquement le service de prêt (23%) ; et enfin, les gros utilisateurs, qui exploitent l’ensemble de la palette des services proposés (23%) (MV2 Conseil, 2007).
La bibliothèque idéale
Enfin, enseignants et étudiants ont été interrogés de façon très ouverte sur leur vision de la bibliothèque idéale. Pour tous, cette bibliothèque devrait d’abord être confortable et disposer d’un bon équipement ; de places de travail en nombre suffisant avec des tables assez grandes et des chaises confortables ; d’une température adéquate (ni trop chaud l’été ni trop froid l’hiver) ; d’une bonne luminosité. Bien sur, elle doit aussi mettre à disposition des ordinateurs avec accès à Internet, des prises électriques pour les portables et un accès Wifi. Cette bibliothèque devrait également être un endroit calme, convivial et spacieux, où décoration, couleurs et plantes apportent une touche de bien-être.
Un nombre non négligeable de chercheurs et d’étudiants voudrait que la bibliothèque devienne également un lieu de détente avec la présence de canapés pour pouvoir se relaxer par moments, la possibilité de se restaurer (avec par exemple la création d’une cafétéria au centre de la bibliothèque) ou la présence de livres « loisirs » (par exemple des bandes dessinées).
Certains chercheurs souhaiteraient aussi que la bibliothèque ne soit pas qu’un lieu de passage et de consultation, mais au contraire un lieu de rencontre, de renseignements et d’enseignement. Afin de favoriser l’échange et en même temps la tranquillité, quelques personnes suggèrent la création d’espaces cloisonnés pour pouvoir parler sans déranger les autres (par exemple des box fermés pour le travail en groupe) et des coins calmes pour travailler.
Tout le monde voudrait un classement simple des livres, un système d’indexation et de cotation lui aussi simple, clair, efficace afin de retrouver les livres facilement. Les personnes rencontrées semblent insister sur la mise en place d’un « endroit fait pour les gens et non pas pour les livres ».
Souvent, les personnes évoquent aussi le fait que leur bibliothèque idéale devrait bénéficier de moyens financiers suffisants, voire élevés, afin d’acheter le plus d’ouvrages possible et d’assurer les abonnements aux revues électroniques. Les usagers interviewés souhaiteraient ainsi disposer sur place de collections complètes (« pas de trous », acquisition de livres à double, etc.), à jour et surtout en libre accès. Ils aimeraient également avoir accès aux archives des périodiques électroniques antérieurs à 1996. Quelques chercheurs sondés proposent de mieux mettre en valeur les ouvrages anciens. La bibliothèque idéale devrait également avoir beaucoup de personnel et des horaires d’ouverture plus étendus. Certains souhaiteraient même avoir un accès permanent, même en l’absence de personnel, afin de travailler quand ils le souhaitent avec les outils de la bibliothèque.
Dans le même sens, on met l’accent sur le fait que la bibliothèque idéale devrait être virtuelle et en réseau avec un accès permanent aux documents. La numérisation de toute la collection (scannage de livres) et l’archivage à long terme des revues électroniques deviendrait nécessaire afin de gagner du temps dans les recherches. L’accès aux bases de données est également évoqué, mais avec des interfaces de recherche plus simples. A l’inverse, d’autres ne voudraient surtout pas d’une bibliothèque uniquement numérique : les ouvrages sur papier et les périodiques électroniques devraient selon eux coexister, du fait de leur complémentarité.
Les personnes consultées semblent aussi attribuer beaucoup d’importance à la mise à disposition d’un service de revue de presse (certains évoquent l’idée d’un « coin actualité »), de services d’alerte personnalisés et enfin au fait d’avoir la possibilité d’effectuer le prêt de manière automatique (introduction de puces dans les livres). Ils imaginent également avoir à disposition un prêt inter - bibliothèques et un service de référence performants (notamment un personnel qui les aide en ligne dans leurs recherches bibliographiques). Quelques chercheurs aimeraient aussi que leur bibliothèque idéale ait un site Internet qui soit convivial et facile d’utilisation et depuis lequel on puisse transmettre des vidéoconférences. D’autres suggestions sont également faites sur l’aide à apporter aux utilisateurs : la mise à disposition de modes d’emplois (par exemple : comment rechercher un livre) mais aussi l’organisation de recherches bibliographiques assistées à la bibliothèque ou encore la réalisation de bibliographies pendant les heures de cours.
Pistes pour une structuration de l’offre de service en bibliothèque académique ?
Bien que menée sur un petit nombre de personnes, l’enquête qualitative réalisée auprès des publics cibles de Bibliosciences pointe des pratiques et des comportements documentaires soulevés également par d’autres enquêtes (dont nous avons cité quelques unes) : l’importance de la bibliothèque comme lieu de travail pour les étudiants ; le recours aux ressources numériques à distance principalement par les enseignants et les chercheurs ; l’usage premier des services sur place dits traditionnels comme le prêt ou la consultation ; etc. L’interrogation ouverte sur la bibliothèque idéale montre différents axes d’attentes de la part de la communauté académique : autour du confort et des conditions d’accès au lieu ; autour de l’offre documentaire (pour laquelle on pourra cependant constater que les attentes énoncées diffèrent parfois des pratiques : on voudrait l’accès à tous les périodiques électroniques, mais, dans la réalité, pour certains types de public, on les consulte assez peu fréquemment) ; et enfin autour des services proposés par les bibliothèques à leur public. Ce résultat nous semble susceptible d’aider à dresser une cartographie possible de l’offre de service en bibliothèque académique autour de trois axes.
Un espace de travail et de rencontre
La question de la baisse de fréquentation physique des bibliothèques académiques, au profit d’un usage à distance des ressources numériques mises à disposition, revient actuellement comme un leitmotiv dans les revues et les colloques professionnels (certaines études amèneraient cependant à relativiser ce constat : une enquête d’ampleur menée auprès des publics étudiants des bibliothèques universitaires de Paris montrait que, en 2003, encore 67% des étudiants fréquentaient régulièrement leur bibliothèque universitaire. Renoult, 2004 ; dans l’enquête menée à Paris 8, on voit que la moitié des étudiants a encore un usage sur place documentaire de la bibliothèque, MV2 Conseil, 2007). Face à ce constat, une première posture serait de mettre résolument l’accent sur les services à distance proposés par la bibliothèque et de désinvestir les services rendus sur place. Or, les différentes études disponibles, dont celle présentée ici, montrent bien l’importance pour les étudiants de la bibliothèque comme lieu de travail et de socialité (d’autres études montrent également la valeur symbolique que revêt la bibliothèque universitaire pour les enseignants, comme lieu de conservation du savoir). Une approche opposée vise alors à revaloriser la bibliothèque comme point d’attache pour la communauté académique, dans une fonction de centre de ressources mais aussi de lieu de vie universitaire. Des projets se développent ainsi autour de la notion de Learning Center, engagée de façon précursive par la Hallam University de Sheffield (Jeapes, 1996). On donnera ici l’exemple plus proche du projet conduit par l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Ce projet, qui inclut une ambition architecturale forte, consiste à intégrer la bibliothèque dans ses fonctions traditionnelles (accès aux collections papier ou numériques, consultation, prêt, orientation et référence) dans un espace ouvert et modulable plus vaste, incluant aussi une proposition de services (cafeteria, restaurant), une proposition éducative (zones de travail, laboratoire de langues, etc.) et une proposition culturelle (zone d’exposition, de conférences ou de spectacles). Selon les porteurs du projet, la bibliothèque est ainsi repensée dans une logique de création « d’expérience sensible », avec trois missions : « placer ses collections au milieu d’un complexe de vie et de socialisation ; satisfaire les besoins physiologiques de la communauté (détente, alimentation, consommation) ; mettre en scène le savoir de manière spectaculaire » (Aymonin, 2005). Cette tendance s’inscrit dans un mouvement plus global de « re-enchantement des lieux de consommation » qui (re)met en avant la place de la médiation humaine (Ferchaud, 2003).
L’accès assisté 24/7 aux ressources
Le corollaire de la baisse de fréquentation physique est le développement de l’accès à distance aux ressources proposées via la bibliothèque. Là encore, il faudrait peut-être relativiser le propos. L’étude menée auprès des enseignants et étudiants de la Faculté des Sciences a montré que l’usage des périodiques électroniques est essentiellement le fait des enseignants ; et que les bases de données sont très peu connues et utilisées. D’autres observateurs font le même constat : « la faiblesse du taux d’utilisation des outils informatisés en BU est un fait attesté, et, disons-le, compte tenu des enjeux humains et financiers, problématique… » (Renoult, 2006). Un des enjeux clés est celui de la facilité de l’accès à ces ressources. Une étude américaine récente sur l’utilisation des bibliothèques académiques par les chercheurs montre bien que ceux-ci privilégient un accès immédiat à l’information et n’acceptent plus de passer beaucoup de temps en recherche documentaire (Research information network, 2007). Au-delà de la constitution de l’offre documentaire à distance, dont il faut gérer la qualité et la pertinence (et ce le plus souvent dans un contexte de tension budgétaire), trois dimensions de l’offre de service des bibliothèques académiques semblent importantes.
- La garantie de l’accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux ressources numériques gérées par la bibliothèque pour sa communauté d’utilisateurs, où que soit situés physiquement ceux-ci, donc dans une logique d’extranet avec des accès sécurisés. C’est par exemple déjà le cas pour les enseignants de la Faculté des Sciences de l’Uni Genève, qui disposent du système VPN (Virtual Private Network).
- La formation à la recherche et à l’utilisation de ce type de ressource. Pour beaucoup, le développement de cette fonction pédagogique, dans une perspective d’enracinement d’une culture et d’une maîtrise de l’information (Information literacy) devient aujourd’hui une des missions essentielles des bibliothèques académiques.
- L’assistance aux utilisateurs. Dans ce domaine, les bibliothèques investissent aujourd’hui fortement autour des services de référence en ligne (Nguyen, 2006), notamment devant le constat général de la chute des demandes pour les services de références sur place. Pour certains, cependant, il faut sortir de cette logique. Elle est basée sur l’idée selon laquelle l’usager sollicite l’aide de la bibliothèque quand il en a besoin alors que toutes les études faites sur les pratiques montrent aujourd’hui le désir d’autonomie de l’utilisateur. Une autre approche peut se développer dans une logique d’accompagnement direct au niveau du réseau, dans une perspective en quelque sorte « éditoriale » : mettre plus de valeur ajoutée dans le catalogue, proposer des orientations dans les sources, développer les produits documentaires électroniques (Balin et al. 2005). Autrement dit, être dans une logique de « push » et non de « pull » de l’assistance documentaire. Une autre dimension de l’assistance concerne l’assistance technique. Certaines bibliothèques ont fait le constat que l’équipement individuel de l’utilisateur, à la fois en logiciels spécialisés et en compétences techniques pour utiliser ces logiciels, est souvent déficient et constitue un frein important à l’utilisation des ressources documentaires numériques. Il y a là un autre axe d’assistance à développer, à l’exemple de cette bibliothèque universitaire australienne qui a mis au point un kit de logiciels et d’outils utiles pour la recherche et le traitement documentaires diffusé sur cd-rom à l’ensemble des étudiants et de la faculté (Cavanagh, 2001).
Des services personnalisés à forte valeur ajoutée
Un troisième axe de structuration de l’offre de service des bibliothèques académiques pour leur public se situe à l’évidence autour du développement de services à valeur ajoutée, se positionnant en complément de l’accès direct aux ressources documentaires, notamment numériques. Les enseignants et étudiants interrogés dans le cadre de l’enquête pour la Faculté des Sciences de l’Université de Genève émettent de fortes attentes vis-à-vis des professionnels des bibliothèques dans ce sens. Le maître mot est ici celui de la personnalisation du service rendu à l’utilisateur, ainsi bien sûr que sa qualité (Ferchaud, 2006) Toute une gamme de produits et de services, notamment liés à la diffusion documentaire, peut être implantée par les bibliothèques universitaires. La Bibliothèque interuniversitaire de médecine de l’Université de Paris 5 a par exemple investi depuis longtemps déjà sur la mise en ligne de bibliographies et de dossiers, dans une logique de portail documentaire. Les bibliothèques ont aujourd’hui des perspectives ouvertes avec les outils issus du Web 2.0. On pourra citer l’exemple de la Bibliothèque universitaire de Médecine de Lausanne, dont le centre de documentation en santé publique a mis en place un système d’alerte documentaire en utilisant le format RSS (Iriarte, 2006). Cet axe de développement suppose de mettre fortement l’accent sur la dimension service de l’activité des bibliothèques et de prendre en compte de façon beaucoup plus ciblée et adaptée les pratiques des différentes catégories d’usagers en présence (Van Dooren, 2006). Autrement dit, il suppose que la bibliothèque sorte d’une posture de prestataire pour engager une relation de « co-production » avec l’utilisateur.
Pour conclure provisoirement, on voit bien que les évolutions de l’accès libre et direct via la documentation numérique aux publications scientifiques obligent les bibliothèques académiques à un repositionnement dans ce nouveau circuit de l’information (Salaun, 2004). Face à ce constat, les bibliothèques académiques ne peuvent plus se concevoir uniquement comme des lieux de conservation et d’accès au savoir, dont elles ne sont plus les seuls récipiendaires, mais plus comme des prestataires de services autour de l’accès à l’information (Bailin, 2003). La question clé est alors de savoir autour de quelle logique de service doit s’orienter chaque bibliothèque académique. L’enquête menée auprès des publics cibles des bibliothèques de sciences de l’Université de Genève a permis de donner à ces bibliothèques des pistes pour orienter et harmoniser leur gamme de services et fourni l’occasion d’une réflexion sur les logiques de structuration de cette offre. Un travail complémentaire reste à faire pour consolider cette réflexion et y ajouter la perspective institutionnelle (avec certainement un quatrième axe de développement du rôle des bibliothèques universitaires autour de la valorisation des productions académiques et scientifiques de l’institution), non prise en compte dans l’enquête menée auprès des utilisateurs potentiels des bibliothèques.
Références
Aymonin (2005) David.- Vers la bibliothèque du futur : évolution et tendances dans les bibliothèques scientifiques, Séminaire Open Access, 10 ans de la bibliothèque de biologie, Université de Lausanne, 28 avril 2005, En ligne : http://library.epfl.ch/docs/pdf/oa-20050428.pdf
Bailin (2003) Alan, Grafstein Ann.- From place to function : academic libraries in 2012. Online, 2003, 3 p. En ligne: http://alpha.fdu.edu/~marcum/bailin_grafstein.doc<
Bailin (2005) Alan, Grafstein Ann.- The evolution of academic libraries : the networked environment, The Journal of Academic Librarianship, vol 31, n°4, july, p. 317-323
Bui (2006) Céline, Lehner Susanne, Moresi Nadia.- Bibliosciences : étude des pratiques documentaires des usagers : quels services pour la bibliothèque de demain ? Travail de Diplôme réalisé en vue de l’obtention du diplôme HES, Carouge, Haute Ecole de Gestion, novembre, 153 p. En ligne : http://doc.rero.ch/ lm.php?url=1000,41,9,20070315144918-RO/mémoire TD Facult SciencesGE.pdf
Cavanagh (2001) Anthony K.- Providing services and information to the dispersed off-campus student : an integrated approach, un : Casey A.M. Ed. Off-campus library services, New York, Haworth, 2001, p. 149-166
Despres-Lonnet (2006) Marie, Courtecuisse Jean-François.- Les étudiants et la documentation numérique, Bulletin des Bibliothèques de France, tome 51, n°2, p. 33-41
Dupuy (2006) Hubert.- Les étudiants à la bibliothèque universitaire de Paris X : pratiques documentaires, satisfactions et attentes,Bulletin des Bibliothèques de France, tome 51, n°2, p. 10-11
Ferchaud (2003) Béatrice.- Médiation et technologies de l’information : regards croisés. Compte rendu du colloque ADBS-EA¨P-ESCP. Documentaliste – Sciences de l’information, vol 40, n°6, p. 392-395
Ferchaud (2006) Bernadette, Lamouroux Mirelle.- L’impact du numérique sur l’évolution des modes de travail. Documentaliste- Sciences de l’information, vol 43, n°3-4, 2006, p. 242-246
Friedlander (2002) Amy.- Dimensions and Use of the Scholarly Information Environment : Introduction to a Data Set Assembled by the Digital Library Federation and Outsell, Inc., Washington, D.C, Digital Library Federation and Council on Library and Information Resources. En ligne : www.clir.org/pubs/reports/pub110/contents.html
Iriarte (2006) Pablo.- La diffusion de l’information documentaire et des actualités en format RSS : un exemple de mise en place au Centre de documentation en santé publique de Lausanne. In : Document numérique et société, Semaine du numérique, Fribourg, 20-21 septembre 2006, 21 p. En ligne : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00079211
Jeapes (1996) Ben.- Sheffield's Learning Centre : more than a library for the twenty-first century : Libraries and learning, Electronic library, vol 14, n°5, pK. 417-418
Maresca (2005) Bruno.- Enquête sur les pratiques documentaires des étudiants, chercheurs et enseignants-chercheurs de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) et de l’Université Denis Diderot (Paris 7), Paris, Credoc, novembre, 93 p. En ligne : http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=R238
MV2 Conseil (2007). – Enquête auprès des usagers de la bibliothèque universitaire de Paris 8 : pratiques, opinions et satisfaction. Paris, Mv2 Conseil ; Bibliothèque universitaire Paris 8, mars. En ligne:http://www-bu.univ-paris8.fr/web/actualites/Enquete%20usagers%20bilan%20mars%202007.pdf
Nguyen (2006) Claire.- Les services de référence virtuels en bibliothèque universitaire : enjeux, perspectives, débats », Bulletin des bibliothèques de France, n° 3, p. 54-57
Renoult (2004) Daniel.- Les Bibliothèques universitaires et leurs publics : à propos d’une enquête récente, Journée d’étude sur la lecture étudiant, Université d’Artois, 16 mars 2004. En ligne: web.univ-pau.fr/saes/pb/divers/bibliotheques/bu.ppt
Renoult (2006) Daniel.- Enquêtes de publics dans les bibliothèques universitaires, où en sommes-nous ? Bulletin des Bibliothèques de France, tome 51, n°2, p. 5-9
Researchers’use of academic libraries and their services. London : Research Information network ; Consortium of research libraries, 2007, 74 p. En ligne : http://www.rin.ac.uk/files/libraries-report-2007.pdf
Salaün (2004) Jean-Michel.- Libre accès aux ressources scientifiques et place des bibliothèques. Bulletin des bibliothèques de France, n°6, p. 20-30
Singly (2005) François de.- Les étudiants lisent encore, Sciences humaines, n° 1615, juin, p. 28-33
Van Dooren (2006) Bruno.- Pour une analyse prospective des bibliothèques de recherche, Bulletin des Bibliothèques de France<, tome 51, n°2, p. 22-33
Veille marketing: mieux maîtriser les paramètres de son marché
Ressi — 30 novembre 2007
Jacqueline Deschamps, Haute Ecole de Gestion, Genève
Françoise Simonot, Chef du département Information-Communication, IUT de Besançon,
François Courvoisier, Professeur, Haute école de gestion Arc, Neuchâtel
Veille marketing: mieux maîtriser les paramètres de son marché
Compte-rendu de la 4ème journée franco-suisse en intelligence économique et veille stratégique
Le 22 juin 2007 s’est tenue à la Haute école de gestion de Genève (HEG) la quatrième journée franco-suisse en Intelligence économique et veille stratégique, organisée en collaboration avec la Haute école de gestion Arc de Neuchâtel et l’IUT de Besançon en Franche-Comté.
Magali Dubosson, directrice de la HEG de Genève, accueille les participants en rappelant que le thème de l’intelligence économique est porté depuis plusieurs années, de manière interdisciplinaire, par les trois filières présentes à la HEG : information documentaire, informatique de gestion et économie d’entreprise. Le diplôme postgrade « Intelligence économique et veille stratégique », co-organisé par les HEG de Genève et Neuchâtel, vient d’être accrédité en tant que MAS : Master of Advanced Studies HES-SO en Intelligence économique et veille stratégique.
Jacqueline Deschamps, co-responsable du postgrade ouvre la journée en rappelant que la veille, le lobbying et la protection de l’information sont les trois fondamentaux de l’intelligence économique. En Suisse, pays aujourd’hui considéré comme parmi les plus innovants, l’intelligence économique demeure encore embryonnaire. Soumis à un environnement turbulent, pressés par la nécessité d’innover, comment les responsables d’entreprises organisent-ils leurs activités de veille, levier indispensable de la connaissance et de la conquête des marchés ? C’est à cette interrogation que les différentes interventions tenteront de répondre.
Le mind mapping, un outil pour organiser la collecte d’information, par Pierre Mongin
Pierre Mongin, cadre territorial et professeur associé à l’Université Lille-1, présente les avantages du mind mapping pour la collecte et surtout la représentation de l’information. Le mind mapping est un plan de câblage des informations situées dans le cerveau : il s’agit de générer des chaînes d’informations. Sollicitant le cerveau droit, la carte heuristique constitue un mode d’écriture qui révolutionne la manière de penser : elle décuple la créativité et l’esprit de synthèse là où les modes traditionnels (le texte, mais aussi les slides d’une présentation visuelle) nous confinent à la linéarité. Ainsi, une carte heuristique de 140 mots peut rendre compte d’un texte de 900 mots.
Cinq principes permettent de construire une carte heuristique:
- l’idée principale se place au centre;
- des branches qui partent du centre supportent les principales idées secondaires;
- des ramifications complètent l’ensemble;
- la lecture se fait dans le sens des aiguilles d’une montre;
- tous les types de fichiers numériques (textes, photos, liens…) peuvent être agrégés à la carte.
Ce plan de câblage réalisé au moyen d’une carte heuristique permet de générer des mots-clés pour réaliser une veille.
Selon Pierre Mongin, la carte conceptuelle se distingue de la carte heuristique en cela qu’elle comporte plusieurs noyaux, et que les ramifications, qui représentent des liens entre des concepts, sont accompagnées de phrases explicites qui désignent la nature de ces liens. Formidable outil de prise de notes, de créativité à plusieurs, de réflexion et de synthèse, la carte heuristique n’est cependant pas encore lisible par tous, et la prudence s’impose pour une utilisation officielle.
Pierre Mongin nous signale un outil gratuit pour réaliser des cartes heuristiques : Free-Mind, à propos duquel va bientôt paraître son ouvrage « Démarrez tout de suite avec Free-Mind ». Des outils payants ( Mind Manager, Map it, etc.) sont référencés sur le site www.petillant.com.
La pige concurrentielle… ou comment « piger » la stratégie des concurrents, par Josée Bélanger Simko
C’est à une époustouflante réflexion à contre-courant que nous invite Josée Bélanger-Simko, directrice de l’agence Toutmorrow.
Aujourd’hui, l’arme de destruction massive, c’est le surplus d’information. Pour ne pas mourir, il nous faut passer du too much au much better. Pourquoi vouloir à tout prix « automatiser » la pige, autrement dit la veille concurrentielle ? Piger, en Europe, signifie comprendre ; mais au Canada, cela signifie « tirer au hasard » ! C’est donc trouver, dans le chaos, de la cohérence pour construire de la valeur ; a contrario, pour obtenir de la valeur, il faut donc… du chaos.
Vouloir à tout prix automatiser, c’est nous transformer en détectives à la recherche d’un crime. Ce qu’il nous faut pour avoir la capacité d’entrer en concurrence, c’est nous « autonomiser », devenir capable de décider et d’être créatif ; c’est repousser le consensus, qui est l’arrêt de la pensée ; c’est comprendre, adopter une logique de réception plutôt que de stockage, c’est se poser des questions :
- quels sont les éléments qui peuvent m’amener sur le même chemin que les autres? ou sur un mauvais chemin?
- qu’est-ce que je ne prends pas en compte ? et si on ne prenait rien en compte?
- si on parlait des autres industries?
Le jeu de la concurrence est un jeu de billard plutôt que d’échecs : il n’y a pas de cases, il y a plusieurs boules, et c’est aléatoire ; mais plus on a observé le jeu, plus on connaît les règles, et plus on a de chances de gagner.Aujourd’hui, la technologie est accessible à tous ; pour se démarquer, il faut donc donner du sens, potentialiser le chaos, exploiter ses propres erreurs (mais ne pas les reproduire !). Plutôt que d’enrichir le produit, il faut chercher à enrichir la vie du client/consommateur, passer d’une économie de production à une économie de la valeur, faire que 1+1=11… Pour créer l’ampoule, Edison n’a pas analysé la bougie !
Lorsqu’on cherche à entrer en concurrence, il faut déjà savoir contre qui, et contre quoi. Apple n’a que 5% des parts du marché de l’électronique personnelle, mais c’est lui le véritable leader, le créateur de nouveaux designs, de nouveaux objets, tels l’i-phone : 30% des jeunes n’ont déjà plus de montre (leur téléphone portable la remplace), bientôt l’i-phone va faire disparaître l’ordinateur.
Ainsi il ne faut pas tant analyser ce que fait la concurrence que comment elle le fait ; ce qui va faire la force de la concurrence, c’est:
- Le niveau d’activité de l’entreprise, l’énergie qui lui permet d’être toujours synchrone (perfect timing);
- son adaptabilité aux situations nouvelles, sa capacité à anticiper toujours la prochaine étape (next step);
- La qualité de son discours (et c’est pourquoi il est important de savoir quelle est l’agence de pub du concurrent)
- La qualité de la relation qu’elle établit avec le client, et qui doit être marquée par la synchronie et la réciprocité, bien plus, par l’ « accordage affectif » : par exemple, à l’heure où des systèmes logistiques très sophistiqués peuvent être mis en place dans tous les domaines, Rolex fait attendre ses clients neuf mois pour la livraison de ses montres, leur procurant ainsi le plaisir rare de l’attente.
Notre concurrence, elle est d’abord en nous-mêmes : c’est notre inertie, notre inhibition. Pour entrer en concurrence, il faut:
- observer, ne pas rester au bureau, travailler avec des gens à l’extérieur, ou des gens qui pensent comme à l’extérieur;
- accepter la passivité réceptrice;
- ouvrir, casser les choses; ne pas se taire, douter, ne pas être raisonnable;
- conduire le changement plutôt que se le laisser imposer.
Felco, une PME à la conquête du marché chinois, par Patricia Borloz
Felco, installée dans la Watch Valley près de Neuchâtel, produit depuis 60 ans des outils de taille, essentiellement des sécateurs en aluminium matricé, pour une clientèle fidèle de professionnels, horticulteurs et paysagistes. Un million d’outils sont produits chaque année, dont 80% de sécateurs : ce sont des outils légers, démontables, garantis à vie puisque les principales pièces peuvent en être changées. Les valeurs de l’entreprise sont :
- la grande qualité du produit, efficace, durable et écologique, suscitant la fierté des employés et la fidélité des clients;
- son prix élevé;
- la prise en compte de la santé des utilisateurs (pas d’ampoule, pas de tendinite)
Une réussite aussi assise doit rendre encore plus vigilant quant à l’avenir : le matériau spécifique peut disparaître, le besoin auquel il répond peut disparaître (apparition d’espèces ne nécessitant pas de taille, modification de la géographie des cultures, etc.). Patricia Borloz, responsable de la recherche marketing chez Felco, a donc mené une réflexion de fond en partant des caractéristiques de sa clientèle : après avoir vu les clients sur le terrain et les besoins auxquels répondaient les produits Felco, elle a recherché les liens entre les différentes cultures (pomme, vigne) et le pouvoir d’achat, identifié dans le monde les cultures qui rapportent (comme la vigne) et qui occupent des surfaces importantes, sélectionné les pays dans lesquels ces cultures étaient en croissance.
Elle a ainsi découvert que, alors que l’Europe subventionne l’arrachage de vignes sur son territoire, la Chine a augmenté sa surface de culture de la vigne de 53% entre 1999 et 2003, pour atteindre 150 000 ha, et que 40% de la production mondiale de pommes est en Chine… Au même moment en Europe, la surproduction fruticole entraîne une moindre taille des arbres fruitiers et donc la baisse de consommation des outils de taille.
En 2003, Felco se met donc à observer la Chine : un premier voyage dans ce pays permet la création d’un petit réseau de correspondants ; une participation à un salon professionnel offre ensuite l’opportunité d’entrer en contact avec un importateur, et d’amorcer avec lui une relation de confiance. Plus tard l’importateur organise pour Felco un voyage chez des viticulteurs, au cours duquel la société vend directement quelques sécateurs à des passants. Les liens sont renforcés, l’importateur est conquis : à l’automne 2007, Felco participera à une exposition viticole en Chine.Pour asseoir la croissance régulière de l’entreprise, il faut donc en permanence chercher à anticiper les changements de la société mondiale en général, tout en « collant » aux besoins des utilisateurs finaux.
Présentation et démonstration de deux types d’outils de veille, par Lionel Cammarata
Lionel Cammarata, assistant à la HEG de Genève et consultant en intelligence économique, nous présente deux outils gratuits, complémentaires et désormais indispensables pour la veille : les fils RSS et les outils de surveillance automatisée de sites. Les fils RSS (Rich Site Summary, ou Really Simple Syndication) sont des fichiers en XML régulièrement actualisés qui proviennent de contanus de sites éditoriaux gratuits et qui procurent des informations bibliographiques et un lien vers des documents publiés sur le web. Ces fils RSS procurent un gain de temps pour être en permanence alerté sur un domaine intéressant.
Pour les lire, on peut utiliser différents outils en ligne : des agrégateurs qui permettent de rendre lisibles les fils RSS sur sa propre page web (ex Bloglines), des portails personnalisables (Netvibes, Webwag..), certains navigateurs internet (Firefox, IE7), et certains webmails. On peut également installer un lecteur de fil RSS (Newzie, Feedreader) ou un client de messagerie adapté, comme RSSowl, Outlook ou Thunderbird.
Les outils de surveillance tels que Websitewatcher, Wysigot ou encore KBcrawl, procurent une gamme de fonctionnalités plus ou moins sophistiquées, qui vont de la simple alerte lorsqu’une page web monitorée a subi une quelconque modification, à l’alerte combinée avec des filtres de mots-clés, qui permettent de détecter l’apparition ou la disparition d’un mot-clé ou d’une combinaison de mots-clés sur les différentes pages d’un site.
Si les fils RSS concernent surtout l’information de presse, alors que les outils de surveillance sont nécessaires pour toutes les autres sources, Lionel Cammarata nous explique, en prenant l’exemple d’une agence de tourisme, comment une bonne connaissance de ces deux types d’outils et leur combinaison peuvent permettre la mise en place d’une surveillance efficace.
Mais comment trouver le bon fil RSS ? Il existe des catalogues (http://w.moreover.com), parfois sectoriels (cf. le site Veille Info Tourisme), et Google Actualités permet de sélectionner un fil RSS à partir d’une requête.
Comment mettre en place une surveillance concurrentielle efficace ? Websitewatcher permet par exemple de sélectionner, sur les sites préalablement signalés, les annonces promotionnelles sur des voyages à J-4, et de détecter les modifications sur ces annonces, comme les changements de prix.
Comment opérer une surveillance sur des listes de discussion ? Il est possible, avec Newzie, d’acquérir le fil RSS correspondant à la liste de discussion, puis de créer un nouveau fil RSS et d’indiquer les mots-clés de filtre.
En conclusion, Lionel Cammarata résume les avantages et inconvénients de l’utilisation des fils RSS pour la veille : ils ne sont actifs que pendant la connexion (contrairement à Google Alert, qui surveille en permanence), et ils peuvent aboutir à une surabondance d’information. En revanche, ce sont des outils de plus en plus simples à utiliser et de prix abordable.
Comment identifier ses concurrents et anticiper sur leurs marchés, par Franck Tognini
Franck Tognini, directeur général du réseau Vigilances.fr, nous livre un tour d’horizon des meilleures pratiques pour collecter l’information concernant nos cibles et, a contrario, pour protéger l’information sur notre propre entreprise.
Les « sources blanches » sont connues et surveillées par la plupart : ce n’est donc pas de là que surgira l’avantage concurrentiel, mais plutôt d’une exploitation soutenue des sources grises : communiqués de presse, mais aussi annexes des rapports de stages, soutenances, discussions privées, disques durs d’un parc informatique mis au rebut… il faut exploiter l’absence de discrétion de nos concurrents.
C’est d’abord une attitude d’étonnement, personnel puis collectif, qui peut nous mener « de la veille à l’éveil » : en cela, le « rapport d’étonnement », par lequel un collaborateur relate non pas ce qu’il a constaté, mais ce qu’il ne comprend pas, est un outil de veille performant, à condition que l’ensemble des rapports soit exploité régulièrement et que chaque informateur obtienne un retour sur ce qu’il a signalé.
En effet, tout collaborateur (livreur, réceptionniste, ouvrier…) est un capteur potentiel d’information : il faut sortir les personnes de leur rapport habituel au travail, de leur fonction d’exécutant, et les impliquer en leur donnant la parole, comme c’est le cas sur les chaînes de montage de Toyota à Valenciennes.
Marier les contraires, mélanger les cultures peut être aussi un facteur de réflexion et d’étonnement fécond : par exemple, répartir la lecture de revues en faisant lire des revues techniques à des commerciaux et réciproquement, ou encore, envoyer les cadres à des salons dans des domaines inhabituels pour eux.
Pour bien tirer parti des participations de l’entreprise à des salons professionnels, il importe de cibler les salons intéressants, qui peuvent être beaucoup plus divers qu’on le croit : une participation à un « salon du bien être » permettra de sentir les tendances émergeantes en matière de sécurité alimentaire, d’emballage, etc. ; de même, un salon touristique renseignera sur de grands investissements publics en BTP… Il convient ensuite de préparer la liste des informations qu’on souhaitera y recueillir : quelle information, auprès de qui, à quel moment stratégique (pause méridienne, fin de salon…). Enfin, au cours du salon, Franck Tognini préconise de profiter des pauses pendant lesquelles les stands se vident pour discuter avec les stagiaires délaissés, récolter les cartes de visite ou les listes de contacts abandonnées sur les comptoirs…. sans oublier d’écouter les conversations lors des cocktails et du voyage retour.
Bien au fait de ces méthodes « grises » de collecte de l’information, l’entrepreneur soucieux de protéger l’information sur son entreprise doit tout envisager et être particulièrement vigilant sur les points suivants :
- les visites : badger les visiteurs, ne pas les laisser seuls, limiter les accès aux locaux, s’assurer que les fumeurs dehors ne sont pas interrogés par des personnes extérieures, se méfier des visites touristiques de l’entreprise
- les stagiaires et intérimaires : limiter et gérer leurs accès à l’intranet et aux données, contrôler la diffusion des rapports de stage, bien expliquer aux stagiaires de quelles tentatives ils peuvent être l’objet.
- les partenaires et prestataires : s’assurer que les avocats, experts comptables, commissaires aux comptes protègent correctement leur système informatique contre les intrusions.
- les transports : limiter les conversations professionnelles dans les trains et navettes d’aéroport.
- les réseaux : investir dans des réseaux « sociaux » en créant des communautés de confiance, plutôt que dans des réseaux professionnels ouverts aux concurrents.
- enfin, il faut se méfier des accès wifi que nous utilisons hors de notre entreprise !
Veille marketing dans des groupes industriels : quelles méthodes ? par Romuald Messina
Membre du groupe Lafontaine, Romuald Messina a à la fois une pratique de l’Intelligence Economique (IE) dans des cabinets très offensifs et l’expérience de la mise en place d’un service d’IE dans deux grands groupes industriels, Air Liquide et Schneider Electric. Selon lui, le principal enjeu n’est pas tant de capter l’information confidentielle que de savoir correctement l’exploiter. Il expose la démarche de mise en place de l’activité d’intelligence économique au sein d’un grand groupe.
La première préoccupation a été de mener un audit informationnel au sein du groupe, et de clarifier la mission « intelligence économique », qui aujourd’hui, chez Schneider Electric, s’organise selon trois axes :
- détecter les mouvements stratégiques des concurrents et informer la direction sur eux
- analyser, comprendre et anticiper ces mouvements, grâce notamment à des contacts directs
- répondre aux questions urgentes du top management en 24 heures.
La mise en place d’une plateforme de veille est intervenue rapidement et s’est faite avec l’implication des différentes équipes et des filiales ; l’appel d’offres international a abouti à mettre en concurrence deux entreprises françaises (hasard heureux puisque les Américains ne connaissent pas et redoutent les outils français), et c’est Digimind qui a été choisi pour développer un outil dédié et le déployer en moins de trois mois. Aujourd’hui, cette plateforme permet le suivi quotidien, voire horaire, et le recoupement de 1265 sources multilingues. Le fait que tous les acteurs impliqués utilisent une seule et même plateforme de veille permet la standardisation des méthodes de veille, l’échange de bonnes pratiques, et dégage du temps pour l’analyse ; cela facilite aussi la publication diffusion ciblée de l’information.
La cellule de veille est une équipe souple et dynamique : elle comprend une dizaine de personnes, et elle est en relation directe avec le top management : elle doit pouvoir réagir dans un délai de quatre heures. Elle assure la « chaîne de la valeur » de l’information : identification des besoins, collecte, organisation, analyse, vérification auprès d’experts, publication de l’information.
Par ailleurs, elle sensibilise et forme des veilleurs dans les filiales, et anime des communautés de veilleurs selon les thématiques : ces veilleurs interviewent les experts et savent analyser, synthétiser, faire remonter l’information selon les processus établis : ce dispositif, qui comporte aujourd’hui 11 relais et 35 collaborateurs dans les filiales, est plus efficace que de demander à tous les membres du groupe de consacrer du temps à la veille, alors qu’ils ne maîtrisent pas forcément la méthodologie. Les veilleurs sont toujours cités lors de la publication d’informations qu’ils ont fait remonter.Le processus de collecte de l’information est industrialisé : les sources sont réparties entre les veilleurs, qui utilisent les mêmes outils:
- une classification ad hoc, bien pensée, disponible dans toutes les langues du groupe, et qui permet de multiclasser les informations
- un modèle d’analyse des informations
- le recours organisé à des experts internes qui aident à comprendre l’information.
L’information de veille est échangée avec les différentes communautés thématiques concernées dans les filiales, puis entre elles, puis avec des clubs, clients, partenaires : ces échanges d’information se font selon une cartographie très précise des réseaux, où sont représentées les compétences, l’appartenance à tel ou tel club, à tel ou tel conseil, de chaque membre. Chaque information est partagée entre une dizaine de personnes maximum, toujours sur la base de missions précises et ponctuelles, et non publiée à tout vent sur un intranet.Pour résumer, Romuald Messina conseille :
- d’avoir une vision claire de ce que l’on cherche
- de créer son dispositif de veille
- de créer un réseau de correspondants, sur la base d’un échange réciproque : information contre compétence pour la traiter
- d’encourager le partage de l’information, mais bien ciblé et non documentaire.
Les études de marché au service de la veille stratégique, par Frédéric Laforge
Classiquement, l’étude de marché intervient bien après l’étude de veille, et fait appel à la parole du consommateur, ce qui suppose qu’il y ait déjà un produit et des clients pour ce produit. L’approche « veille » n’est donc pas existante dans les cabinets d’études de marché, et il n’existe d’ailleurs pas de produit ainsi labellisé chez GFK. Frédéric Laforge s’est donc posé deux questions :
1° - Les cabinets d’études de marché font-ils de la veille sans le savoir ?
Dans les études classiques, il arrive que certaines questions soient déconnectées d’un produit précis et portent sur ce qui motive le comportement. Par exemple, une étude récente pour l’Oréal s’interrogeait sur le rapport à la peau des Françaises aujourd’hui ; la conclusion était qu’à l’image d’une superposition de couches (endoderme, derme, etc.) s’était substituée l’image d’échanges avec l’extérieur, et donc la question de ce qu’on laisse entrer ou sortir.
Une telle tendance est certes intéressante à explorer dans une optique de veille sociétale très amont. Mais plus généralement, ces études exploratoires sont très longues et très coûteuses, car elles nécessitent d’importants échantillons et de longues analyses.
2° Y a-t-il d’autres outils qui puissent couvrir les besoins de veille à des coûts raisonnables ?
Dans le même type d’approches très « macro », on peut citer les études très générales sur les comportements et les habitudes d’une catégorie de personnes : à quelle heure se lèvent-elles, que mangent-elles, etc. On sait ainsi que les cigarettiers achètent énormément d’études sur le comportement des adolescents. Il faut citer aussi les « observatoires », rapports synthétiques annuels sur l’évolution du monde, établis sur la base de discussions avec des leaders d’opinion. Mais ces études sont très vastes.Sur un plan cette fois « micro », les traditionnels panels de consommateurs et panels d’encaissements dans les grandes surfaces ne concernent que des produits finis : ils permettent de mesurer des parts de marchés, mais non pas de définir une politique : ce n’est donc plus de la veille, c’est de l’autopsie….
Un modèle d’étude plus adéquat semble être le « tracking de marché » : il s’agit de vérifier régulièrement le positionnement d’un produit sur son marché, de vérifier la bonne santé de l’image et des valeurs de la marque. Il s’agit d’une étude simple, composée de trois ou quatre questions, comportant toujours rigoureusement les mêmes items, posées à un petit échantillon de personnes plusieurs fois par an. Le coût peut être inférieur à 10 000 CHF par an. Quelques exemples :
- « Nespresso est-elle pour moi une marque innovante/ une marque en qui j’ai confiance / une marque haut de gamme / une marque pour les gens comme moi ? » ;
- « Fumer, est-ce cher / dangereux / cool / agréable » ?
Ces études permettent de vérifier que la marque est bien au cœur de son marché, et d’anticiper les déplacements de ce marché.
En conclusion, Frédéric Laforge note que, pour mener ces études, certains cabinets utilisent aujourd’hui les forums on line ; ceux-ci sont aussi utilisés pour « casser » des marques par des concurrents qui chargent ces forums de faux messages de mécontentement.
Synthèse de la journée, par Romuald Messina
Pour conclure la journée, Romuald Messina en reprend les points-clés sous forme de conseils :
- Ayons conscience que nous sommes tous observés (Google) : … et utilisons ces mêmes outils, comme Google Trend, pour observer à notre tour;
- Soyons attentifs aux risques de pillage de l’information : mettons en place des salles neutres, limitons les destinataires de nos informations au strict nécessaire, etc.;
- Ayons conscience aussi du risque de manipulation de l’information : par exemple, soyons attentifs aux blogs et aux forums ;
- Accordons toute son importance à la remontée de l’information : par exemple, mettons en place les rapports d’étonnement et les réseaux de veilleurs correspondants;
- Créons de l’intelligence collective : des réseaux de partage, des réseaux d’aide à la compréhension de l’information;
- Soyons créatifs, imaginatifs, mélangeons les gens, pensons autrement, trouvons des « trucs » : par exemple, pour évaluer l’effectif d’une entreprise, comptons les places de parking devant le siège…
- Ne stockons pas l’information, faisons-la circuler, car l’information appelle l’information;
- Utilisons le mapping pour organiser et exploiter l’information, mais aussi pour bien d’autres applications : par exemple, le mapping des salons où un concurrent est présent met en lumière ses liens technologies / marchés / pays;
- Enfin, soyons conscients que tout ce travail se fait dans la durée et que rien ne se fait en un jour…
Caron-Fasan Marie-Laurence, Lesca Nicolas. Veille anticipative - Une autre approche de l'intelligence économique, Paris: Hermès Science, 2006, 281 p., ill.
Ressi — 30 novembre 2007
Yves Berger, Haute Ecole de Gestion, Genève
Caron-Fasan Marie-Laurence, Lesca Nicolas. Veille anticipative - Une autre approche de l'intelligence économique, Paris: Hermès Science, 2006, 281 p., ill.
Anticiper les changements actuels et futurs pour le devenir des entreprises
L’objet central du livre est la veille délibérément tournée vers l’anticipation. Sa particularité est la valorisation d’informations d’origine informelle, collectées au gré des discussions et rencontres avec les acteurs extérieurs. L’approche vise à proposer une complémentarité à la veille technologique perçue par les auteurs comme incomplète et insatisfaisante compte tenu des risques et des menaces de l’environnement mondial actuel. Ils estiment en effet qu’il est désormais urgent que les entreprises soient capables d’appréhender la mondialisation et d’en tirer les avantages stratégiques. Cela passe par une maîtrise des savoirs et des savoir-faire ainsi qu’une capacité de réaction et d’anticipation. Les outils de veille représentent bien sûr un des facteurs de réussite mais l’état d’esprit, l’anticipation et la culture d’intelligence économique dans l’entreprise sont d’autres facteurs cruciaux.
De l’avis de Marie-Laurence Caron-Fasan et Nicolas Lesca, l’intelligence économique est encore un concept flou et mal compris notamment dans les entreprises privées. Leurs constatations se développent autour de la France pour expliquer que l’IE est un vaste chantier et qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir pour sensibiliser l’ensemble des acteurs de l’économie. Sans entrer dans des développements approfondis, le livre se propose donc de faire un tour d’horizon de l’activité de l’IE et de définir son rôle et sa place dans l’économie.
L’une des pratiques associées à l’IE est l’organisation de réseaux d’information et de dispositifs de renseignement pour anticiper les changements. La logique, rappelle les auteurs, est très simple puisque elle veut que plus tôt le changement sera anticipé, plus l’organisation disposera de temps pour réagir et s’adapter. En d’autres termes, si l’entreprise pouvait connaître les changements avant qu’ils ne se réalisent, elle pourrait disposer d’un temps de réaction pour en tirer profit et prendre, par exemple, de l’avance sur ses concurrents. Sur le terrain, cette logique est par contre très difficile à mettre en œuvre car les entreprises ne voient pas toujours l’intérêt d’une telle démarche.
Veille anticipative, où quand l’acte passif de recueil d’information (réaction) devient un des outils d’aide à la décision permettant de détecter le fameux signal faible
En poussant le raisonnement un peu plus loin, l’ouvrage démontre que l’acte d’anticiper ne signifie pas uniquement connaître avec exactitude le futur longtemps avant qu’il ne se réalise, mais également percevoir les germes de changement et imaginer alors plusieurs futurs possibles. L’idée d’anticipation renvoie ainsi à la capacité d’imaginer une situation, un événement, un fait avant qu’il ne se réalise et sous-tend que l’information ne fournit pas seulement des éclairages sur le passé ou le présent, mais aussi sur le futur. Par exemple, l’information d’anticipation devrait permettre de répondre aux questions du type: notre principal concurrent risque t’il de proposer un nouveau produit à nos clients ? Pour désigner ces informations à caractère anticipatif, Marie-Laurence Caron-Fasan et Nicolas Lesca parlent de signal faible, c'est-à-dire des indices imprécis mais précoces susceptibles de se réaliser dans le futur. Une organisation qui souhaiterait ainsi anticiper les changements et les évolutions de l’environnement devrait chercher à développer sa capacité à écouter, percevoir et décoder ces signaux.
Faire de la veille, pour les auteurs, représente le plus souvent une activité ou une pratique informelle et implicite venant s’ajouter au métier principal d’un acteur individuel. Elle renvoie alors pour eux à un ensemble de compétences, de sensibilité et de comportements que chaque employé peut être susceptible de mettre en œuvre dans l’exercice de son travail. A ce stade de leur réflexion, ils se demandent en quoi consiste cette activité et quel dispositif mettre en œuvre. Ils proposent, pour y répondre, d’identifier puis de détailler les différentes phases (ciblage, sélection, circulation, diffusion, etc.) constitutives du processus de veille.
L’ouvrage fournit également des axes d’analyse et d’approfondissement pour étudier et questionner les processus de veille. Enfin, les auteurs proposent d’étudier la veille non plus comme un processus informationnel mais en tant que système cybernétique, c’est à dire un processus structuré et finalisé qui transforme les données en produits. Les composantes du système cybernétique de veille étant les ressources utilisées, les aspects financiers ainsi que les facteurs-clés de succès et d’échecs.
Finalement, c’est la question de la relation entre la veille et la prise de décision qui est abordée dans ce livre, montrant que bien souvent, ce lien n’existe pas de façon aussi mécanique qu’il est dit parfois dans la littérature, voire de la part de constructeurs de logiciels. Ce livre propose aussi des pistes pour stimuler la réflexion et pousser à l’action des acteurs désireux renforcer le lien entre leurs pratiques de veille et de prise de décision. Il contribue donc à faire avancer l’intelligence économique dans une culture où l’information a besoin de se faire une place de référence. Il est aussi destiné aux jeunes chercheurs académiques qui trouveront un ensemble cohérent de bases théoriques concernant la veille et des références d’auteurs de reconnaissance internationale.
Open Access. Chancen und Herausforderungen : ein Handbuch. Deutsche Unesco Kommissison, 2007
Ressi — 30 novembre 2007
Eloi Contesse, Chargé d'inventaire, Département des collections photographiques, Musée historique de Lausanne
Open Access. Chancen und Herausforderungen : ein Handbuch. Deutsche Unesco Kommissison, 2007
Edité par la Deutsche UNESCO-Kommission (1), cet ouvrage a pour but de nourrir le débat sur l’open access en décrivant de manière détaillée tous les aspects touchés par la mise en place d’une stratégie open access. A l’origine de ce manuel, un atelier réunissant vingt-cinq experts politiques (membres des gouvernements de Länder, de l’Etat fédéral allemand, de l’administration européenne), scientifiques, et économiques (éditeurs).
L’intérêt de cet ouvrage tient en deux éléments: l’intervention de spécialistes et la volonté de couvrir tout l’ensemble du spectre touché par la problématique de l’open access. Après une introduction générale (Quo vadis, Wissensgesellschaft ?), cet ouvrage présente en cinq parties tout ce qui concerne l’Open access: 1. Définition et origine de l’open access; 2. Trois modèles de publications open access; 3. Aspects à prendre en compte lors de la réalisation de modèles open access; 4. Perspectives politiques de l’open access, dans la recherche scientifique, les bibliothèques, les éditeurs, la formation, etc. et 5. Le contexte international.
Outre la présentation du modèle hybride Springer Open Choice (permettant à l’auteur de choisir au moment de sa publication dans une revue appartenant au groupe Springer d’être publié en open access ou selon la formule classique usager-payeur), deux études de cas sont présentées: le serveur institutionnel de l’université Humboldt à Berlin et le New Journal of Physics lancé en open access par des universités allemandes et américaines. Ces articles présentent les défis principaux de telles entreprises. Pour le premier cas (serveur institutionnel), la viabilité du système dépend très largement de la sensibilisation auprès des auteurs, pour leur faire comprendre les buts de l’open access ainsi que la différence entre l’auto-archivage dans un serveur institutionnel et la publication dans un journal électronique. Néanmoins, le serveur institutionnel travaille également au développement de services pour les éditeurs scientifiques de publications électroniques. Pour le journal en open access, ses avantages sont importants: il combine une diffusion élargie des articles avec les exigences qualitatives d’une revue scientifique. Les défis d’une telle entreprise concernent principalement la phase de lancement, qui demande une subvention régulière sur plusieurs années pour assurer la viabilité du projet.
Plusieurs chapitres traitent de la réalisation de publications en open access, et décrivent aussi bien les questions du financement, du droit d’auteur, de la garantie de qualité du contenu, de l’archivage à long terme, comme de sujets plus pointus comme la modification des structures de communication de l’information scientifique avec l’open access, ainsi que des questions techniques de traitement des données, des interfaces de recherches et du degré de diffusion du publications en open access dans les divers domaines scientifiques.
E. Bodenschatz et U. Pöschl décrivent de nouveaux moyens de contrôle sur les publications scientifiques tel que le Collaborative peer review. La possibilité de mettre en ligne des pre-print élargit pour ainsi dire le lectorat éditorial et donne la possibilité à l’auteur, sur la base des commentaires qu’il reçoit, d’améliorer sa version publiée (p. 51 et 54).
U. Schwens et R. Altenhöhner de la Deutsche Nationalbibliothek décrivent les deux défis pour la conservation à long terme, à savoir:
- La conservation du contenu des données (Substanzerhaltung der Dateninhalte), impliquant l’intégration de données de sources et de formats hétérogènes dans un réceptacle stable et homogène, avec un contrôle automatique régulier relatif aux supports des données et des nécessaires migrations d’un support à l’autre.
- La conservation de l’accessibilité des ressources numériques. Cette tâche est bien plus complexe puisque l’usager du futur ne sera plus forcément en mesure d’interpréter les formats d’archivage, puisque le contexte technique (système d’exploitation, programmes informatiques) ne sera plus disponible. La réponse à cette difficulté réside dans la mise en place d’expérimentation de maintien du système d’origine (émulation).
De manière générale, ces auteurs notent que la conservation à long terme sera de plus en plus un argument commercial dans le monde très concurrentiel des publications scientifiques (p. 58). L’avantage de l’open access est que le monde de la publication électronique y est plus homogène que dans le monde éditorial classique, avec cet inconvénient cependant du moindre pouvoir de l’éditeur open access face à l’auteur quant aux normes de présentation et de formats.
J. Fournier décrit les changements dans le mode de communication de l’information scientifique. Par exemple, si le choix de l’auteur-payeur résout la problématique de l’accès à l’information résultant de la recherche scientifique, il faut prendre garde que ce mode de diffusion n’exclue pas de la publication des chercheurs sans le sou. Il y a donc un besoin d’institutionnaliser l’open access et de sensibiliser les bailleurs de fonds. Dans le même temps, il s’agit d’accompagner l’auteur scientifique dans son usage de l’open access. Dans ce cadre, J. Fournier met en avant la transformation du rôle des bibliothèques scientifiques au contact de l’open access. De réceptrices et dépositaires des publications, elles vont de plus en plus jouer un rôle d’acteur de la diffusion de l’information scientifique (p. 69).
Si l’arrivée d’Internet et des publications électroniques a bouleversé le paysage de la communication scientifique et détruit le consensus de la publication scientifique traditionnelle (relations entre scientifiques, éditeurs et bibliothèques universitaires), Ralf Schimmer de la Max Planck Digital Library insiste pour ne pas y voir une guerre de tranchées entre scientifiques d’une part, et éditeurs commerciaux d’autre part. D’après son expérience, on trouve un esprit d’innovation, de même que des attitudes défensives et de refus des deux côtés. Il insiste pour montrer que l’impact de l’open access sur le milieu scientifique est tout en nuance, en fonction du domaine dans lequel on se situe (p. 72-76). Cette déclaration est étayée, dans les chapitres suivants, par des descriptions plus détaillées de chaque domaine scientifique (des sciences naturelles aux sciences humaines).
Mettre côte à côte scientifiques, éditeurs et politiques et parvenir à un consensus sur l’open access, c’est le défi que s’est donné ce livre. Il contribue en tout cas à nourrir la réflexion et à donner une vision nuancée des problématiques concernées. Il montre également que l’open access a dépassé le stade de l’expérimentation, du moins en Allemagne, et se dirige vers une institutionnalisation bienvenue. C’est donc un bouleversement complet de la diffusion de l’information scientifique qui est en cours. Ces transformations dépassent le passage de l’analogique au numérique, mais touche au fonctionnement même des institutions publiques impliquées dans la recherche scientifique, appelées à un rôle de plus en plus actif dans la diffusion de l’information qu’elles contribuent à produire ou dont elles sont les dépositaires.
La présence d'attracteurs dans les systèmes informationnels
Ressi — 30 novembre 2007
Résumé
Cet article est basé sur notre pratique de l'information. Elle nous a mené à voir l'entreprise et les systèmes d'information comme des ensembles complexes et vivants dans lesquels les « grappes informationnelles » jouent un rôle important. Pour nous, l'information se caractérise par un phénomène de passages réciproques entre les domaines implicites et explicites de la matière informationnelle et de transformations continues et rétroactives de données en informations et en connaissances. Les « triangles opérateurs »,constitués d'hommes, de machines(techniques) et de structures, sont les agents des transformations et des passages. L'entreprise peut dès lors être vue comme formant un SI. C'est un système complexe adaptatif qui se situe à la frontière de l'ordre et du chaos et dont l'approche doit être globale. L'attracteur informationnel-notion empruntée à la théorie du chaos- explique et détermine le comportement du SI. Il est la résultante des 2 attractions du SI, l'implicite et l'explicite. Cinq variables nous permettent de décrire les domaines du SI, les passages et leur force d'attraction. Nous distinguons trois types d'attracteurs: le partage, la tension et la rupture. L'attracteur du SI permet enfin de mieux comprendre la formation de connaissance et de valoriser les ressources informationnelles.
Abstract
This paper is based on our experience in information management. It has leaded us to see organizations and information systems (IS) as living and complex entities in which « informational grapes » play a significant act. For us information is characterized by two ways passages between the explicit and implicit parts of informational material and by a suite of interactive and continuous transformations of data into information and knowledge. Within the system, the « triangle operators », which are a combination of factors of human, machines (technology) and organizational nature, are responsible of both transformations and passages. An organization can be seen as an IS. It is a complex adaptative system which is at the border between order and chaos. « The informational attractor » explains and determines the behaviour of an information system. We borrow this notion from the theory of chaos. The attractor is the combination of the two attractions of the IS, the implicit and the explicit. Five variables allow us to describe the domain, the passages and the power of their attraction. We identify three types of attractors: sharing, tension and rupture. Finally, the attractor of the IS give us a better understanding of knowledge creation and a tool to improve the efficiency of managing information resources.
« C'était en été dans une petite et ancienne ville de France, traversée par une rivière large et puissante. Je suis resté longtemps sur le seul pont de la cité à la contempler, fasciné par la beauté et la complexité du mouvement de l'eau. (...) (1) ».
L'image de la rivière, avec ses flux et reflux, sa palette de couleurs chatoyant, ses jeux de lumière et ses scintillements constitue sans doute une étrange entrée en matière pour introduire la présence d'attracteurs dans les systèmes informationnels. Pourtant un système d'information (SI) forme aussi un spectacle vivant, naturellement et profondément différent de la somme des éléments qui le constituent. Un SI naît, évolue, disparaît tout comme d'ailleurs les organisations ou entreprises auxquelles il est intimement lié. Ils sont différents de la somme de leurs composants. Un SI mérite d'être vu dans sa globalité, comme un paysage. Nous allons en parcourir quelques aspects remarquables.
Nous expliquerons d'abord les raisons qui ont présidé à cette réflexion et nous soulignerons l'importance de ce que nous avons appelé les « grappes informationnelles ». A travers la dynamique des processus de transformation de la matière informationnelle, nous verrons que l'entreprise peut être considérée en elle même comme un système d'information et qu'il s'agit d'un système complexe dans lequel une tension existe entre information formelle et informelle. Nous déboucherons alors sur l'attracteur informationnel, notion empruntée à la théorie du chaos, en l'illustrant par des exemples et en montrant son rôle dans la création de connaissances pour enfin conclure.
L'information est un domaine qui nous a toujours passionné. La banque fut notre environnement professionnel durant de nombreuses années. L'information y revêt une importance majeure vu les risques liés à l'exercice du métier. Notre passion nous a conduit à exercer des fonctions qui se situaient fréquemment dans le « no man's land » qui sépare les utilisateurs des producteurs d'information, essentiellement les départements de l'IT (Information Technology). Il s'agissait de faire comprendre aux uns et aux autres leurs besoins réciproques et leurs points de vue différents sur l'information.
Notre pratique de l'information, dans la banque puis comme conseil, les observations que nous avons effectuées, les projets que nous avons menés, les nombreuses participations à des séminaires, des séances de formation et des groupes de travail, les échanges multiples et variés avec de nombreux consultants et fournisseurs d'IT (le secteur bancaire en consomme beaucoup!), nos diverses lectures constituent autant de sources auxquelles s'alimente notre réflexion. Dans le même temps, nous avons toujours cherché à comprendre les raisons de 3 phénomènes auxquels nous avons été confronté et dont la permanence nous a frappé.
En règle générale, nous avons pu constater, dans bien des domaines, que la plupart des décisions sont basées pratiquement sur 1/5 de l'information existante et que, bien souvent, il fallait retrouver et reconstituer ces 20% d'informations qui, quoique bien présentes, n'étaient pas disponibles et que, de plus, elles n'étaient pas toujours pertinentes. Le second phénomène a trait aux échecs répétés des grands projets centralisateurs de toutes les informations disponibles sur un sujet donné tels les portraits clients et produits (type data base marketing), crédits, les recueils de compétence, ... Le troisième enfin concerne l'efflorescence des projets informatiques « pirates ». Nous entendons par là les noyaux informatiques constitués par divers services au sein de l'entreprise en dehors du contrôle du département responsable de l'IT, nés de la nécessité de maîtriser et traiter eux-mêmes l'information qu'ils jugent nécessaires à leur activité. Ces phénomènes n'étaient pas propres à une organisation mais on les retrouvaient peu ou prou dans diverses institutions. Les fournisseurs de matériel, de logiciels, les consultants en parlaient dans leurs exposés sans pour autant apporter de solutions convaincantes. Leur persistance était d'autant plus significative que les ressources technologiques des départements IT étaient abondantes.
C'est sur ce substrat que nous avons été amené à développer notre approche concernant la présence d'un « attracteur étrange » dans les systèmes d'information.
Notre pratique de l'information a nourri l'intuition que l'approche habituelle ne tenait pas compte de la nature réelle des systèmes d'information et qu'il devait exister une autre manière de les aborder, plus globale, basée sur ce qu'ils sont dans leur diversité et leur complexité.
La gestion de l'information et des connaissances est le plus souvent envisagée par le biais de projets qui visent à provoquer un effet de levier dans l'utilisation efficiente des ressources dont l'entreprise dispose. L'habitude est mettre directement en avant les technologies d'information et de communication (TIC) qui permettront de gérer les contenus, de maîtriser les cycles de vie de l'information, de classer, d'archiver, de créer des recueils de compétences, des bases de données,de se doter d'outils de recherche, de distribuer et donner accès à tout cet appareil, sans oublier la sécurité, ... . Il faudra définir la nature et les types des documents, les décrire au moyen des méta données et des mots clés, sauver et conserver les connaissances qui risquent de disparaître. L'accent sera mis sur l'explicitation des informations et des connaissances détenues et acquises par chacun, sur la définition et la mise en place des processus et méthodes de transfert des connaissances et sur la mise en réseau de tous les acteurs.
Force est cependant de constater que l'engouement pour les projets de « management » des connaissances a eu tendance à s'éroder pour différentes raisons. Tout d'abord les investissements consentis n'ont pas toujours produit les résultats attendus. Ensuite les « fonctions » créées et les politiques mises en œuvre n'ont pas toujours permis d'améliorer le partage de connaissances au sein des entreprises, ce qui fait naître le découragement (2). Par ailleurs, il n'existe pas de « solutions toutes faites » et « universelles » en matière de systèmes d'information et de management des connaissances car on sous-estime souvent la nature complexe du phénomène information et les réalités des interactions entre les hommes, les technologies et les structures, et entre les multiples dimensions interdépendantes, de nature technologique, organisationnelle, cognitive et comportementale. Enfin les projets et systèmes mis en oeuvre ont l'ambition d'expliciter les 100% des informations et savoirs. Or, ce faisant, ils se limitent au traitement et à la transformation d'informations qui sont par nature exprimables et qui peuvent être codifiées. Le champ des connaissances implicites en est exclu.
De plus l'entreprise n'est pas ce modèle rationnel, ordonné, efficace, qu'on se plaît à décrire et mettre en avant dans les grandes écoles de management. Comme toute communauté humaine, l'entreprise est un lieu où prennent place des luttes de pouvoirs et des combats idéologiques, personnels et collectifs. Les résultats de ces batailles ne contribuent pas toujours, loin de là, aux prises de décisions les plus saines ou au fonctionnement le meilleur. Et même si les comportements de nombreux acteurs restent « rationnels », leur somme ne l'est pas nécessairement. Les « lois de Parkinson » ou « le principe de Peter » (3) paraissent souvent plus pertinents et pragmatiques pour expliquer et comprendre une organisation que nombre de théories du management scientifique. La critique de ces deux auteurs impertinents est d'ailleurs trop souvent évacuée sous prétexte que « bien évidemment, elle ne nous est pas applicable »!
Bien souvent la boutade qui veut « qu'au bord du précipice, ils firent un grand pas en avant » se révèle appropriée. Pourtant le précipice est connu, visible, décrit et d'une dangerosité certaine: comment comprendre, expliquer ce grand pas en avant? Jupiter aveugle ceux qu'il veut perdre! Il existe des oeillères qui forcent le regard, des filtres, au travers desquels une personne, un groupe, une société, une entreprise, ... appréhendent leur environnement. Nous les avons appelées les « grappes informationnelles ». Elles sont formées de trois ensembles: les concepts manipulés, les contextes d'utilisation et les informations qui les accompagnent. Les grappes mélangent des éléments intuitifs, sous-jacents, et des éléments explicites, clairement définis et précisés. Elles représentent finalement l'ensemble des théories, opinions, pré-jugés, clichés, les expériences personnelles et collectives, l'éducation, l'histoire, ... qu'une personne, un groupe, une entreprise, véhiculent avec eux et dont ils se servent, consciemment ou non, pour comprendre la réalité qui les entoure et agir. Elles varient au cours du temps avec les effets de mode, les remises en question, les expériences et le degré de connaissance que nous avons de nous-mêmes comme personne ou collectivité. Elles conditionnent notre vision de la société. Elles peuvent être ouvertes, basées sur l'incertitude, le questionnement, la remise en question, et alors l'évolution et l'innovation sont possibles, ou fermées, fondées sur des certitudes, des croyances et font dès lors obstacle aux changements nécessaires et conduisent droit au précipice.
L'entreprise constitue finalement une entité complexe, vivante qui ne se réduit pas à la somme de ses parties. Les grappes informationnelles y jouent un rôle majeur, tant dans les comportements individuels que collectifs, quant à la manière de voir l'information et son utilisation. Tantôt elles poussent à l'exploration, à l'élargissement du champs informationnel et tantôt à son rétrécissement en n'en retenant que les éléments qui confortent les préjugés. Une approche différente des systèmes d'information demande de prendre conscience de leur existence et de reconnaître leur influence.
La matière informationnelle est très particulière. Elle est expansive et occupe tout l'espace disponible. Elle ne disparaît pas à l'usage alors que le réservoir d'une voiture se vide en roulant. Elle se partage et ne s'échange pas, comme on peut le faire avec des pommes contre des poires. Grâce aux réseaux, on peut la distribuer très rapidement partout dans le monde. C'est aussi , et c'est très important, une matière en évolution permanente, résultat d'une suite d'échanges réciproques et multiples qui, à son tour, évoluera et en produira d'autres.
Ses composantes sont les données, l'information et la connaissance. Une donnée est tout symbole, signe ou mesure qui se trouve dans une forme telle qu'elle peut être capturée directement par une personne ou une machine. C'est la matière brute avec laquelle il est possible de fabriquer information et connaissance.
Il est difficile de s'accorder sur une définition de l'information. Nous la définissons « comme une ou plusieurs données qui, transformées, acquièrent du sens, signifient quelque chose pour une personne, un groupe ou une organisation et deviennent de ce fait utilisables par cette personne, ce groupe ou cette organisation. » (5). L'information est donc directement liée au sens qu'elle possède pour un acteur et aux possibilités d'action.
Comme l'information, la connaissance a trait aux significations, elle est contextuelle et relationnelle. Mais contrairement à l'information, la connaissance concerne les croyances et les engagements et a trait à l'action. La connaissance est l'ensemble des informations qui permet d'agir. Elle émerge avec et par l'action. Elle est en construction permanente et comme, telle elle ne se gère pas.
Ces définitions seraient toutefois incomplètes sans préciser les 2 domaines de la matière informationnelle, l'implicite (ou tacite) et l'explicite.
L'information implicite est hautement personnelle et difficile à formuler. Il n'est pas facile de la communiquer ou de la partager avec les autres. Elle est profondément enracinée dans les actions et les expériences individuelles aussi bien que dans les idéaux, valeurs ou émotions que nous embrassons. Elle réside dans une dimension cognitive globale de l'esprit et du corps humain. Elle forme en fait le substrat des grappes informationnelles.
L'information explicite est codifiée. Elle peut être transmise dans un langage formel et systématique. Elle est individuellement distincte ou digitale. Elle est saisie dans les enregistrements du passé tels que les bibliothèques, les archives et les bases de données. On y accède sur une base séquentielle. Elle peut être exprimée en mots et chiffres et partagée sous la forme de données, formules scientifiques, spécifications, manuels, etc. ... (5)
La notion de transformation est capitale dans la définition des composants de la matière informationnelle. Prenons un exemple. Nous avons deux feuilles de papier, l'une avec une liste de noms et prénoms et l'autre avec des adresses. Chacun peut y voir ce qu'il veut, s'intéresser aux noms, à leur origine, s'interroger sur la dispersion des adresses, ne rien faire du tout. Bref il s'agit de données. Effectuons une transformation en collant les deux feuilles de telle sorte qu'à chaque nom corresponde une adresse et appelons le résultat « liste des prospects ». Les données ont maintenant acquis du sens, par exemple, pour un directeur des ventes. Il peut les utiliser pour mesurer son taux de pénétration dans ce marché. Transformons à nouveau les informations en intégrant des données socio-économiques et comportementales: revenu, profil de consommation, niveau d'études, type de voiture, de maison ... En y ajoutant ses connaissances personnelles et son expérience du marché (qui constituent des informations implicites), le responsable du marketing peut lancer une campagne segmentée de promotion. En tirant les leçons de son action, il va enrichir ses connaissances ce qui lui donnera de nouvelles informations qu'il peut partager avec ses collègues.
Cet exemple nous apprend également que données, information et connaissances sont relatives à leur contexte d'usage. La personne qui encode les données de base valide des données brutes. Grâce à la validation, les noms et adresses sont normalisés, structurés, les doublons éliminés, ... bref les données de base sont enrichies. A son niveau, elle deviennent de l'information. Pour le directeur des ventes, la liste validée représentent des données. Elles ne deviennent de l'information qu'après rapprochement avec les informations relatives à sa clientèle qui lui permettront de mesurer son taux de pénétration. A son tour, le directeur marketing ne s'intéressera qu'aux résultats de la campagne et non aux détails. Ce qui est donnée pour l'un est information pour un autre ou connaissances pour un troisième. C'est toujours de l'information mais ce n'est jamais la même. On remarquera aussi que la transformation met en jeu le domaine de l'implicite avec le savoir faire, l'expérience des acteurs, les leçons qu'ils retirent des actions entreprises. Elle permet ainsi d'opérer des passages réciproques entre les deux domaines de la matière, l'implicite et l'explicite. La transformation elle même peut également n'être qu'implicite. Pour un sculpteur, un morceau de marbre est autre chose que de la matière brute: il y voit déjà la statue qu'il se propose de sculpter.
Chacun possède donc sa vision de l'information, retient ce qui est utile en fonction de son travail et du rôle qu'il exerce, sans oublier les grappes informationnelles, ce qui confère à l'information un caractère éminemment subjectif. C'est la subjectivité d'usage. La production d'information est donc différenciée aux yeux des utilisateurs. La transformation - données information connaissance (6) - est ainsi continue et diffuse dans tout le système d'information. L'approche habituelle, technologique, ne prend en général pas en compte cette dynamique de transformation. La production est brute, indifférenciée ce qui contribue à faire naître et entretenir les informatiques pirates et obère la réalisation des projets centralisateurs mentionnées précédemment.
Le processus général de gestion de toute organisation se résume à trois grands processus génériques dont dépendent les autres (Fig 1). Il faut acquérir les ressources nécessaires, humaines, matérielles, financières techniques et informationnelles, puis les transformer (appliquer un savoir) pour fabriquer produits et /ou services et enfin les vendre, les distribuer aux clients. Ces processus drainent avec eux des masses d'informations tant implicites qu'explicites. On n'acquiert pas seulement des ressources mais toute l'information et le savoir qui les accompagnent: les caractéristiques et les prix des matières premières et des équipements, les descriptions et les comparaisons entre les fournisseurs, les manuels d'entretien des machines, les contrats, les résumés des personnes, ... La transformation entraîne également son cortège d'information: les descriptions des processus, le contrôle de qualité, les règles relatives à la sécurité, à l'environnement, les statistiques de production, l'expérience et le savoir faire des opérateurs ... .
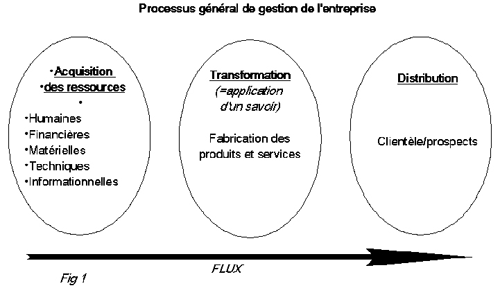
Il en va de même de la distribution avec les études de marché, la description de la clientèle, de la concurrence ou de l'environnement, les intuitions et l'expérience des responsables, ... . Toutes ces informations sont constamment soumises à des transformations. Bref l'entreprise ne peut vivre sans le bain d'information dans lequel elle est plongée. Ce bain est parcouru de multiples boucles de rétroactions: une augmentation des prix oblige à changer de fournisseurs, à rationaliser la production, une nouvelle technologie entraîne des changements dans la fabrication, la pression de la concurrence provoque une autre manière d'approcher les clients, l'apparition de nouveaux produits ou services, ... . On pourrait multiplier les exemples. Ce bain d'information est une véritable soupe de transformations rétroactives, multiples et variées.
Les cuisiniers de la soupe informationnelle, les acteurs ou agents (7) des transformations, sont les « triangles opérateurs ». Ils se composent de trois éléments en interaction: les hommes, les machines (technologies) et les structures (Fig 2). Par exemple, le bureau d'accueil d'une entreprise constitue un triangle: hôtesses et hôtes d'accueil, leurs postes de travail, la place de l'accueil dans l'organisation de l'entreprise. Les triangles sont donc multiples dans une organisation des plus simples (accueil) aux plus complexes (le comité de direction). Ils sont à la fois utilisateurs et producteurs d'information.
Les triangles opérateurs sont responsables des transformations de données en informations et en connaissances ainsi que des passages réciproques entre les champs de l'implicite et de l'explicite. Leur responsabilité est directe ou indirecte. Nous voulons dire par là que si tous les triangles « travaillent » l'information, seuls certains d'entre eux s'y consacrent spécifiquement. Ils opèrent au moyen d'une ou plusieurs de 4 opérations de base: saisie (ou capture des informations), validation (ou vérification de forme et de fonds), agrégation (ou création d'ensembles cohérents) et distribution (ou accès).
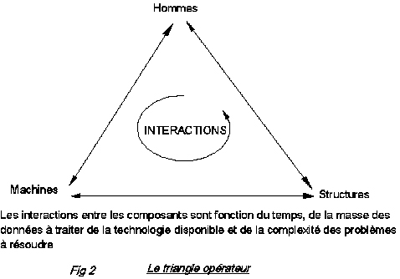
Les interactions, c'est-à-dire les importances relatives, à un moment donné, de chacun des membres de cette relation triangulaire, sont fonction du temps, de la masse des données, de la technologie et de la complexité des problèmes traités. Le facteur humain est plus important dans le cas d'un comité de gestion ou d'un artisan et dominant dans son interaction avec les technologies et les structures. La machine est prépondérante dans la salle de contrôle d'un réseau de distribution d'électricité et domine l'interaction avec les autres éléments. L'apparition du PC, la technologie des réseaux ont profondément transformé notre manière de travailler en interaction avec les hommes et les structures et ouvert quantités de nouvelles potentialités dans tous les domaines.
La technologie a d'ailleurs bouleversé notre façon de gérer le processus global de l'entreprise. Avant, il fallait capturer l'information dont les ressources et les processus étaient porteurs pour la traiter et pouvoir agir, maintenant ils sont capables de communiquer directement au système l'information qu'ils contiennent et le système est en mesure de réagir immédiatement sur l'information reçue. Le temps de réaction est singulièrement raccourci et le rôle des intermédiaires remis en question. Pour prendre un exemple, le simple passage de la carte de paiement aux caisses du supermarché déclenche non seulement les écritures de débit et de crédit, mais aussi la mise à jour du profil client, celle des stocks du magasin avec les ré-approvisionnement éventuels voire celle des commandes de fabrication. C'est en gérant désormais directement l'information encapsulée dans les ressources et les processus qu'il est possible d'améliorer leur efficience et, par conséquent, celle de l'entreprise et du business lui-même.
Mais la technologie contient aussi sa propre Némésis. La rigueur apparente d'une base de données, d'un tableur, d'un processus automatisé cachent bien souvent des hypothèses cachées, des suppositions. Déchets à l'entrée, évangile à la sortie! L'ordinateur n'a-t-il pas toujours raison? Par ailleurs la technologie rassure le management. Elle permet de modéliser l'entreprise et de lui en présenter une image compréhensible, rationnelle, bref un bel objet dont il possède la maîtrise. Les non dits, le complexe, l'incertitude pourtant bien présents dans l'entreprise, sont exclus. « Les systèmes d'information sont des outils pour simplifier le complexe,( ... )(qui) masquent la nature dynamique, chaotique de l'organisation (8) ». En plus de cette vision réductrice, elle favorise également une efflorescence informationnelle qui a pour conséquence un entropie de l'information: essentiel et accessoire finissent par se confondre, d'où la non pertinence relative des 20% utilisés dans les processus décisionnels.
La technologie est indispensable et réussit très bien pour tout ce qui concerne les opérations de masse, simples, standardisées structurées, répétitives (par exemple les systèmes de paiement nationaux et internationaux, les traitements en masse des adresses). Mais comme telle, elle échoue bien souvent dès que la complexité apparaît: les systèmes d'information restent alors en reconstruction permanente. Le cas des projets centralisateurs est éclairant à cet égard. Leur nature transversale met en jeu bien d'autres éléments que la technologie, interactions humaines, structures, ... Finalement, il existe entre nous et les technologies une relation ambiguë « ... nous ne pouvons pas vivre sans elles mais nous luttons pour vivre avec elles dans un environnement harmonieux (9) ».
L'entreprise forme donc en elle-même un système d'information. Nous le définissons comme une suite de transformations (10) multiples, interactives et rétroactives, effectuées par des triangles opérateurs à l'aide d'une série de quatre opérations qui s'appliquent indifféremment à des données, des informations ou des connaissances. Ces transformations génèrent des passages entre les champs implicites et explicites de la matière informationnelle et leur suite forme un processus. Un système est composé d'un ensemble de sous systèmes génériques et générés, selon la taille de l'organisation.
De plus, « l'entreprise/SI » « ... est un système adaptatif complexe (11). Il comporte de très nombreux agents passifs et actifs(les triangles opérateurs), liés dans un réseau qui produisent, utilisent, communiquent et transmettent données, informations et connaissances. Le contrôle est dispersé, car on ne peut pas isoler un centre de contrôle particulier, un peu à l'image d' Internet. Les agents servent de blocs de construction à l'organisation du système et sont en réorganisation constante, le long de transformations (données en informations et en connaissances) et d'opérations interactives (saisie, validation, agrégation et distribution). Ils anticipent, par exemple, la demande, l'acceptation ou le refus d'un changement induit par la concurrence, par une nouvelle technologie... Enfin, il se forme des niches dans le système que les agents occupent directement. Tel est le cas avec la création et l'occupation de circuits informationnels informels nécessités par la défaillance ou l'insuffisance des canaux de communication existants ou la formation et le développement de systèmes informatiques dits « pirates » parce qu'ils se situent « en dehors » des structures autorisées et sont créés à leur insu. ». De tels systèmes sont difficilement décomposables car « négliger une partie du système détruit des aspects essentiels de son comportement et de sa structure » (12).
Telle est la réalité, beaucoup plus difficile à saisir, qui se cache derrière la façade lisse, rationnelle, ordonnée et stable que se donnent volontiers les organisations.
En questionnant l'approche habituelle des systèmes d'information, nous sommes arrivés à voir l'entreprise comme un SI et à le situer résolument à la frontière de l'ordre et du chaos, dans le champs de la complexité. Les grappes informationnelles, les transformations, les triangles opérateurs, les domaines implicites et explicite de la matière informationnelle ne suffisent pas seuls à expliquer le fonctionnement global du SI.
Lorsqu'on contemple une rivière ou lorsqu'on « regarde » la soupe informationnelle bouillonnante, chaotique d'un SI, des comportements, des formes similaires finissent par émerger. On les dirait attirés par quelque chose, comme si, derrière le désordre, il existait une force attirant le mouvement, un « attracteur ». Un SI possède un « attracteur informationnel », notion empruntée à la théorie du chaos, « moteur » des séquences de transformations à l'œuvre en son sein. En quelle que sorte, il agit en « attirant » dans la masse grouillante des informations, celles qui passent à sa portée, pour leur donner un sens déterminé, permettre l'action et engendrer de la connaissance. L'attracteur rend compte du comportement du SI.
Pour mieux comprendre, faisons un bref détour par la théorie du chaos (13). Voyons d'abord un système simple formé par un pendule. Celui-ci perd son énergie par frottement et finit par s'immobiliser. En représentant les mouvements du système sur un graphe (Fig. 3), nous voyons les trajectoires converger en spiralant vers un point. C'est l'attracteur du pendule, il « attire » vers lui le mouvement du système.
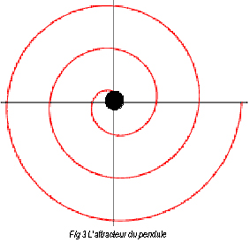
Prenons maintenant un système complexe, non linéaire, tels la météo ou un certain type de roue hydraulique (14) étudiés par Edward Lorenz (15). Ce sont des système apériodiques qui tendent à se reproduire sans jamais y parvenir. En visualisant leur comportement, on obtient une courbe qui, pour citer James Gleick à propos de l'attracteur de Lorenz (16) (Fig. 4), est « d'une complexité infinie. Elle restait contenue dans certaines limites sans déborder de la page ni repasser sur elle-même. Elle décrivait une forme étrange, très particulière, une sorte de double spirale à trois dimensions, comme les ailes d'un papillon. Cette forme signalait la présence d'un désordre à l'état pur: aucun point ou groupe de points n'y paraissaient deux fois. Pourtant elle signalait également la présence d'un ordre insoupçonné ». Un tel système forme un « attracteur étrange », comme une face de hibou, objet bizarre, entrelacé à l'infini.
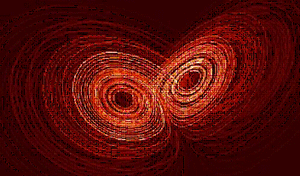
"Fig 4 Attracteur de Lorenz
Tel que nous l'avons défini, un système d'information est semblable à un système complexe, non linéaire et l'attracteur de Lorenz convient bien pour le représenter. En effet un SI tourne autour de deux domaines ou points d'ancrage, l'implicite et l'explicite. Chacun forme un « bassin d'attraction » et les transformations provoquent des passages continuels de l'un vers l'autre. En se combinant les deux attractions forment l'attracteur informationnel qui engendre l'orientation générale du système d'information.
L'ancrage implicite prend en compte l'importance du non dit, les visions, les souhaits, les demandes des différents agents de l'organisation, leurs échanges informels au sein de groupes de travail, leurs capacités de réaction et leurs possibilités d'initiative face à l'environnement, c'est-à-dire celles d'amorcer des boucles de rétroaction. L'ancrage implicite se rapproche de la créativité, de l'innovation.
L'ancrage explicite concerne l'information codifiée, celle qui peut être transmise dans un langage formel et systématique. L'ancrage explicite exprime le degré de formalisation et d'explicitation de l'information atteint par l'entreprise. L'ancrage explicite englobe l'ensemble des technologies mises en oeuvre par l'organisation, la stratégie explicite, le contrôle, la gestion quotidienne et opérationnelle, la description des processus, les procédures, la communication structurée.
Les étendues et les forces des bassins d'attraction vont générer des passages, des zones de tension et de partage entre les deux attractions. Elles se « répondent » l'une à l'autre comme un écho. Ainsi les besoins implicites des agents vont provoquer un appel vers la composante explicite pour obtenir de nouveaux moyens de travail via le développement de technologies existantes ou l'acquisition de nouvelles technologies. La demande va générer un supplément d'explicitation dans le système informationnel avec l'analyse et la mise en place d'un projet destiné à la satisfaire. Il y a passage, en quelque sorte, d'un bassin à l'autre. Mais il y aura aussi apparition de tensions au cas ou la réponse donnée est trop limitée, insatisfaisante, ou s'il en résulte la domination d'une attraction sur l'autre. Tel serait ainsi le cas d'agents qui refusent d'accepter de réelles contraintes technologiques ou, à l'inverse, qui imposent une forme de technologie au détriment des besoins.
L'analyse des attractions va permettre de connaître l'attracteur informationnel du SI et d'en montrer le comportement. Pour ce faire, nous utilisons cinq variables interdépendantes qui caractérisent les bassins d'attraction et rendent compte de leurs interactions. Dans chaque domaine, elles varient entre deux pôles ou valeurs extrêmes propre au domaine considéré.
- La variable temps détermine la sensibilité du SI par rapport à la durée, c'est-à-dire les espaces de temps dans lesquels il évolue. Dans l'implicite, elle varie entre le court et le long terme, selon l'horizon temporel vécu par l'organisation. En simplifiant, une entreprise dont la préoccupation majeure des dirigeants est en fait fixée sur l'évolution de son cours en bourse se situera dans un espace temporel restreint, quelque soit par ailleurs son discours explicite. Dans le domaine explicite, la variation se situe entre temps réel et temps différé. Un contrôle aérien doit impérativement travailler en temps réel contrairement à une cellule d'analyse stratégique.
- La variable espace concerne l'étendue spatiale du SI. Elle s'étire, dans les deux domaines, d'un espace limité à un espace non limité. Celui ci peut être géographique ou virtuel ou les deux. L'implicite de l'organisation sera très différent selon que son approche fondamentale est locale ou globale, en d'autres termes s'il s'agit de tenir compte d'une ou de plusieurs cultures et environnements différents. Au plan explicite, une entreprise globale ne peut opérer efficacement sans mettre en œuvre la technologie des réseaux.
- La variable fonction mesure l'adéquation du système à la prise de décision. Dans l'attraction implicite, la variation passera de la verticalité (le cadre de référence décisionnel, même complexe, est défini et connu, par exemple un responsable de la production) à l'horizontalité (nécessité d'intégrer de larges espaces d’incertitudes, par exemple un acheteur qui doit « sentir » la mode de la prochaine saison). La variable exprime aussi la manière dont sont vécues les différentes fonctions dans l'entreprise (les degrés de liberté, les possibilités d'initiatives, le droit à l'erreur ... ) et la force des réseaux relationnels internes, là où se construit la connaissance implicite.
Dans l'attraction explicite, la variable fonction varie entre deux pôles. L'un baptisé « exécution » fait référence à des systèmes structurés qui servent à l'exécution des tâches au moyen de procédures bien définies. L'autre pôle, la « conception », indique la présence de systèmes ouverts et adaptables (systèmes ou outils de conception et de recherche). - La variable usage est liée à l'exhaustivité et à la pertinence. Le système d'information fournit-il les données et informations nécessaires et suffisantes à l’accomplissement des tâches de l'organisation? Dans l'attraction implicite, elle varie de l'analyse à la synthèse en relation avec le contenu des tâches dont les agents sont responsables. Ainsi un manager ne sera pas toujours satisfait de la synthèse qu'il reçoit parce que, implicitement, il attendait plus, ... ses collaborateurs devraient en fait se mettre dans sa tête. Dans l'explicite, la variation s'étendra de l'exhaustivité à la synthèse. Un système de contrôle aérien doit donner en temps réel la totalité des informations sur tous les appareils évoluant dans sa sphère de contrôle. Une synthèse des factures suffit au trésorier.
- La variable contexte est la plus complexe des cinq. Elle mesure la sensibilité du SI aux différentes cultures qui peuvent exister au sein de l'entreprise qu'il s'agisse des comportements innés dans l'organisation ou dans tel ou tel de ses départements ou des diverses chartes qui ont été établies.
Dans l'attraction implicite, elle englobe la culture de l'entreprise et les sous cultures, son histoire et les valeurs qu'elle véhicule ainsi que le style de management. On y retrouvera les grappes informationnelles véhiculées dans l'organisation. Le « contexte implicite » synthétise les comportements collectifs et individuels des agents. Un des pôles de la variable sera le comportement collectif (dauphin) qui met l'accent sur des valeurs et concepts connus et partagés par tous, sur la collaboration et le désir que tous les partenaires soient gagnants. L'autre pôle sera marqué par une composante où les intérêts et les vues personnelles priment sur l'intérêt collectif de l'entreprise (requin).
L'attraction explicite concerne la manière dont les technologies sont comprises et utilisées par les agents de même que l'histoire technologique de l'entreprise avec les différentes couches qui se sont superposées au fil du temps. La variation s'étend sur un mélange de systèmes et de technologies allant de l'opérationnel à l'intégration en passant par les systèmes de communication.
Le tableau ci après donne la synthèse des variables.
Tableau 1 : synthèse des variables
| variables | dimensions | implicite | explicite | ||
|---|---|---|---|---|---|
| pôles | pôles | ||||
| temps | temporelle | court terme | long terme | réel | différé |
| espace | spatiale | limité | non limité | limité | non limité |
| focntion | prise de décision | vertical | horizontal | exécution | conception |
| usage | information nécessaire et suffisante | analyse | synthèse | exhaustivité | synthèse |
| contexte | culturelle | individuel (requin) | collectif (dauphin) | opérationnel | communication intégration |
La force ou la faiblesse des variables par rapport aux pôles se marque par des séries de + ou de - selon la convention suivante:
| Force | Faiblesse | |
|---|---|---|
| Faible | + | - |
| Moyenne | ++ | -- |
| Forte | +++ | --- |
| Très forte | ++++ | ---- |
Pour illustrer le mécanisme du tableau, prenons l'exemple de la variable fonction d'un SI dans lequel les tâches à accomplir sont bien définies et connues des agents et où il s'agit avant tout de suivre les processus existant. On aura
Tableau 2 : fonctionnement
| variable | dimensions | implicite | explicite | ||
|---|---|---|---|---|---|
| pôles | pôles | ||||
| fonction | prise de décision | vertical | horizontal | exécution | conception |
|
variation |
++++ | -- | +++ | - | |
Chaque variable peut par ailleurs être représentée sur un axe (Fig. 5). Les pôles sont situés à égale distance du centre de l'axe. Le milieu de l'axe traduit le passage d'un pôle de variation à l'autre. Chaque variable prendra donc deux valeurs, une de chaque côté du milieu de l'axe, dont la combinaison traduit son influence, dans l'exemple choisi, l'importance de l'exécution sur la conception. Chaque variable représente ainsi une « tension » entre les pôles.
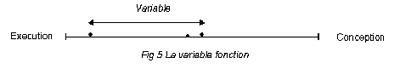
On peut donc « visualiser » un attracteur informationnel, ses deux attractions, leurs variables et les pôles entre lesquels elles oscillent. Il y aura deux groupes de cinq axes chacun, l'un pour l'attraction implicite et l'autre pour l'attraction explicite. Ils se croisent chacun en leur centre. Sur chacun des axes, nous reportons les valeurs attribuées aux variables. En rejoignant les points obtenus pour les valeurs des variables, l'attracteur émerge formé de deux polygones, un pour chaque bassin d'attraction. La figure 6 (voir plus loin) montre un exemple d'attracteur.
La valeur des variables dans un SI donné n'est pas le résultat de mesures précises. C'est la traduction d'une croyance vraie et justifiée quant à l'importance de la variable sur une échelle allant d'un pôle à l'autre: du temps réel au temps différé, de l'exécution à la conception, du vertical à l'horizontal, etc. Ce travail, essentiellement qualitatif, repose d'abord sur de nombreux débats avec les acteurs clés de l'entreprise et sur la lecture des chartes et documents de base de manière à bien comprendre la stratégie, la manière dont elle est élaborée et mise en pratique. Il faudra revenir souvent vers eux afin de valider constamment les résultats des observations et les hypothèses formulées. Il s'agit aussi d'acquérir une bonne compréhension des processus de décision, des activités exercées par l'entreprise et des technologies employées pour produire et utiliser les informations. Il existe incontestablement une part de subjectivité dans les valeurs attribuées aux variables d'un SI.
Nous avons appliqué le concept d'attracteur à l'analyse des systèmes informationnels de plusieurs entreprises. Les exemples que nous présentons sont construits à partir des résultats d'observations et d'expériences effectuées au cours de nombreuses incursions dans divers systèmes d'information. Ils s'inspirent d'entreprises précises mais n'en reflètent pas nécessairement la réalité actuelle, surtout pour les exemples de tension et de rupture. Ils ne préjugent en rien de l'efficacité des entreprises concernées. L'objectif est de concrétiser l'attracteur en montrant qu'il permet de penser autrement les systèmes informationnels, d'en percevoir la nature profonde et de différencier plusieurs types d'attracteurs informationnels.
Le partage
Le premier exemple concerne l'attracteur du système d'information d'une organisation non gouvernementale internationale. La synthèse des observations montre que l'information y joue un rôle indispensable pour la réalisation de ses missions. Pour répondre aux urgences, elle doit connaître précisément les contextes dans lesquels elle opère, anticiper et identifier ses domaines d'intervention, en préciser le périmètre et réutiliser constamment les résultats des expériences vécues. Elle utilise l'information pour informer et sensibiliser l'opinion, faire pression sur les pouvoirs public, motiver les donateurs pour ses campagnes de collectes de moyens financiers et documenter ses appels aux bailleurs de fonds institutionnels. L'organisation produit donc en abondance des informations de qualité. Malgré cette quantité d'information, elle se sentait fréquemment dans la situation de devoir « réinventer » ce qu'elle connaissait déjà, sans pouvoir tenir compte des expériences vécues. De plus, les technologies utilisées (courrier, disques partagés, système de gestion des documents) contribuaient à nourrir un certain chaos informationnel. Il fallait remédier à cette situation.
La culture de l'entreprise est très forte caractérisée par la motivation et la personnalité des acteurs, leur sens d'une communauté d'action et leur aisance à bien se situer dans le court terme et dans la durée. Les échanges d'information s'effectuent facilement et les capacités de rétroaction sont très élevées. Le débat est fréquent et s'exprime au travers de documents largement diffusés et commentés. Le non dit, l'implicite de l'organisation est particulièrement développé. Chaque document important est la résultante d'une somme de discussions, de savoir-faire et d'expériences. Les technologies utilisées sont simples et maîtrisées et, malgré l'effet pervers mentionné plus haut, elles favorisent l'échange et la communication. La structure de l'organisation est matricielle et assez bien intégrée.
L'observation des variables du SI confirme l'analyse globale.
- Les variables espaces et temps
- La variable Fonction
- La variable usage
- La variable contexte
Tableau 3 : partage - temps et espace
| variable | pôle | implicite | explicite | pôle |
|---|---|---|---|---|
| variations | ||||
| temps | court terme | +++ | +++ | réel |
| long terme | +++ | +++ | différé | |
|
correspondance |
||||
| espace | limité | +++ | +++ | limité |
| non limité | +++ | +++ | non limité | |
|
correspondance |
||||
Les variables « espace » et « temps » sont équilibrées autour des points d'ancrage. Dans l'implicite, toute action à court terme se situe naturellement dans une perspective à long terme et l'entreprise intègre bien les différences culturelles. Dans l'explicite, les réseaux de communication et les systèmes de rapport mis en œuvre par l'organisation, de même que le rythme d'utilisation lui permettent d'obtenir et d'échanger les données et les informations nécessaires, là et quand il le faut. Il y a correspondance entre les 2 domaines.
Tableau 4 : partage - fonction
| variable | pôle | implicite | explicite | pôle |
|---|---|---|---|---|
| variations | ||||
| fonction | vertical | + | +++ | exécution |
| horizontal | +++ | + | conception | |
|
correspondance faible |
||||
La variable « fonction » est marquée dans l'implicite par l'esprit d'initiative et une grande capacité à intégrer l'incertitude ce qui est conforme à la culture de l'entreprise. La valeur de l'« horizontal » est donc élevée. L'attraction explicite montre que les outils nécessaires sont disponibles pour l'accomplissement du travail (valeur de l'« exécution » de la variable « fonction ») mais leur potentiel conceptuel reste faible par rapport à la forte demande qui résulte du niveau élevé atteint par la valeur « horizontal » dans l'attraction implicite. Il y a correspondance entre les domaines mais elle est plus faible.
Tableau 5 : partage - usage
| variable | pôle | implicite | explicite | pôle |
|---|---|---|---|---|
| variations | ||||
| usage | analyse | +++ | +++ | exhaustivité |
| synthèse | +++ | + | synthèse | |
|
correspondance |
||||
Les fortes capacités d'analyse et de synthèse des acteurs caractérisent le domaine implicite dans la variable « usage ». Elles peuvent certes s'appuyer sur l'importance de l'« exhaustivité » dans l'attraction explicite, mais les systèmes utilisés manquent de moyens pour synthétiser (faiblesse de la valeur « synthèse »). Et quand la production d'informations explicites est très abondante et indifférenciée, l'exhaustivité peut devenir envahissante. Il y a cependant correspondance entre les 2 domaines.
Tableau 6 : partage - contexte
| variable | pôle | implicite | explicite | pôle |
|---|---|---|---|---|
| variations | ||||
| contexte | individuel (requin) | - | +++ | opérationnel |
| collectif (dauphin) | +++ | - | communication intégration | |
|
correspondance faible |
||||
Dans l'attraction implicite, la variable « contexte » est très nettement marquée par la culture de l'organisation. La communication entre les agents, à tout niveaux, est naturelle et facilitée par la structure de l'entreprise. La valeur « dauphin (collective) » est élevé et contribue à rendre harmonieux le fonctionnement d'un rassemblement de fortes personnalités. Dans l'attraction explicite, le poids de l'intégration est trop faible en regard de l'appel provoqué par le niveau atteint par la valeur collective de la variable « contexte » dans l'attraction implicite. Le pôle opérationnel qui permet quant à lui la production et le partage d'informations est très fort. Il y a correspondance entre les domaines mais elle est plus faible.
En conclusion, l'intelligence collective existe bien dans l'entreprise mais elle reste dans la part implicite du système informationnel. Elle n'apparaît pas explicitement car elle n'est pas modélisée, synthétisée vu la faiblesse de la valeur « intégration » de la variable « contexte » dans l'attraction explicite et le déficit d'outils de synthèse (variable « usage ») et de conception (variable « fonction »). L'organisation doit souvent reconstruire à partir des données existantes et de nombreuses discussions une information par ailleurs potentiellement disponible mais « cachée », c'est-à-dire consacrer du temps et des efforts à rechercher, collecter et synthétiser. Les correspondances entre les variations des dimensions des variables dans les deux ancrages sont cohérentes et le passage de l'un à l'autre se fait facilement: il existe un bon écho entre les deux. Les bassins d'attraction occupent des surfaces similaires et le recouvrement de leurs bassins respectifs marque la présence d'une zone de partage entre les deux domaines.
La figure suivante représente l'attracteur informationnel de l'organisation, obtenu en reportant sur les axes les valeurs des variables. On remarquera le creux dans l'attraction explicite (faiblesse de l'intégration dans la variable « contexte ») ainsi que la faible valeur de la synthèse dans la variable « usage » et de la conception dans la variable « fonction ».
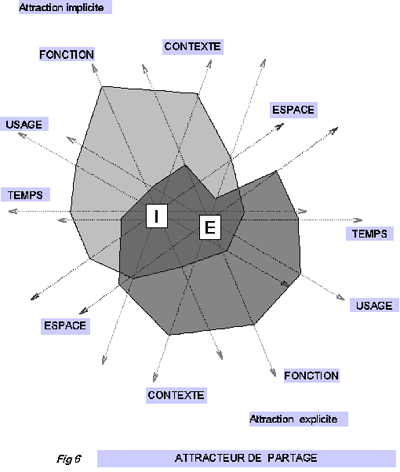
Cette analyse a eu des conséquences pratiques. En effet, la première réaction eût été de se procurer et mettre en place la technologie manquante pour pallier le manque d'outils de conception et d'intégration et de se lancer dans une démarche d'explicitation de toute l'information. Mais avec l'attracteur présent à l'esprit, la solution consista dans l'amélioration de la valeur « intégration » de la variable « contexte », point faible du SI, empêchant l'expression de l'intelligence collective, en travaillant à la fois les domaines culturels, organisationnels et techniques et en réfléchissant à la nature de l'information, à son utilisation et à sa signification pour l'entreprise. L'investissement technologique fut insignifiant: l'organisation a réussi « à faire plus avec moins ».
La tension
Le second exemple d'attracteur est une reconstruction. Il concerne l'attracteur d'un sous système d'information dépendant du système global assurant la gestion opérationnelle et comptable d'une institution financière de grande taille, tel qu'il avait été construit aux débuts de l'informatisation des services bancaires, fin des années 60 du siècle dernier. Avec le développement des activités internationales dans la décennie qui a suivi, et notamment celles de la salle des marchés, les besoins en matière de contrôle de gestion se sont faits de plus en plus pressants et exigeants.
Le sous système d'information dont il est question servait à ce moment des départements aux responsabilités différentes, les uns concernés par la gestion globale et les autres par les activités internationales dont une branche très particulière et spécifique, la salle des marchés.
Le tableau 7 donne la synthèse des observations sur les variables du système.
Tableau 7 : attracteur de tension - synthèse des variables
| variable | pôle | implicite | explicite | pôle |
|---|---|---|---|---|
| variations | ||||
| temps | court terme | +++ | --- | réel |
| long terme | +++ | +++ | différé | |
|
opposition |
||||
| espace | limité | + | +++ | limité |
| non limité | +++ | --- | non limité | |
|
opposition |
||||
| fonction | vertical | - | +++ | exécution |
| horizontal | +++ | -- | conception | |
|
opposition |
||||
| usage | analyse | ++ | +++ | exhaustivité |
| synthèse | +++ | ++ | synthèse | |
| correspondance | ||||
| contexte | individuel (requin) | ++ | +++ | opérationnel |
| collectif (dauphin) | +++ | -- | communication intégration | |
| opposition faible | ||||
Dans l'ancrage implicite, l'accent sur le « long terme » et le « non limité » des variables « temps » et « espace », ainsi que le poids des valeurs « collective » et « synthèse » dans les variables « contexte » et « usage », traduisent la volonté de maîtrise spatio-temporelle et globale de la rentabilité dont le contrôle de gestion est le gardien. Le poids du « court terme » traduit le fait que le marché bouge tout le temps. L'importance relative de « l'horizontalité » dans la variable « fonction », reflète l'insécurité liés aux activités de marché.
L'attraction explicite est entièrement dominée par le système opérationnel et comptable, travaillant en temps différé, dans un espace national et donc limité. Il y a opposition, car les valeurs atteintes par ces mêmes variables dans l'implicite auraient exigé du temps réel et un espace non limité. Les variables « fonctions », « usage » et « contexte » vont toutes dans le sens de l'exécution, de l'exhaustivité et de la gestion opérationnelle. Là encore, l'attraction implicite aurait demandé pour ces variables, un meilleur répondant explicite, avec des valeurs plus marquées en « conception », en « synthèse » et en « intégration ». La figure 7 représente l'attracteur du système.
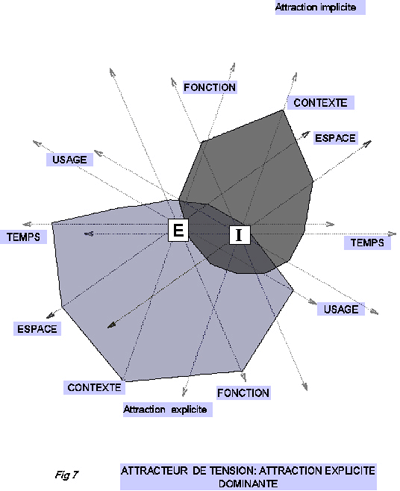
Les ancrages implicite et explicite sont déséquilibrés. L'ancrage explicite est dominé par un système informatique bien conçu et efficace pour traiter des besoins strictement opérationnels et comptables. Pour ses utilisateurs, ce système détient, en quelque sorte, l'unique vérité de l'entreprise. C'est un facteur psychologique important. L'ancrage implicite est faible, axé sur de nouvelles activités et marqué par deux tendances opposées dans le management. Les uns veulent démontrer la rentabilité des nouvelles activités, mais aussi couvrir leurs responsabilités vis à vis de l'institution. Les autres, au contraire, s'efforcent de prouver que la rentabilité est exagérée, incertaine, et qu'elle ne couvre pas les risques pris. Enfin beaucoup de responsables éprouvaient des difficultés à comprendre la nature même des opérations de la salle des marchés.
Il existe une zone commune entre les bassins d'attraction. Elle tient au fait que, malgré l'inadéquation du système explicite aux besoins, il restait la seule source d'informations officiellement reconnue par la comptabilité, les commissaires et réviseurs aux comptes et les autorités de contrôle prudentiel. Il fallait donc partir de ces informations, les analyser et les ré-interpréter dans une optique « salle de marché ». Cet effort se traduit par les poids de la synthèse et de l'exhaustivité de la variable « usage » dans les domaines implicites et explicites. Les deux attractions ne se correspondent que sur ce plan et s'opposent sur le reste. Les surfaces des bassins d'attraction sont différentes. L'attraction explicite est plus étendue, plus forte et domine l'attraction implicite.
Il existe une tension entre les deux bassins d'attraction: même s'ils possèdent une zone de recouvrement, le partage ne se fait pas réellement. L'attraction explicite domine.
Historiquement, cette tension dans l'attracteur explique que les responsables (gestion et salle des marchés) aient développé séparément des systèmes propres, conçus comme des excroissances du système comptable. Mais la dominance de l'attraction explicite les a entraînés à vouloir que les informations sorties des trois systèmes (comptable, gestion, salle) soient identiques. Malgré la dépense en temps et ressources, les résultats n'ont jamais donné satisfaction. Ce type d'attracteur explique la persistance des trois phénomènes qui ont présidé à notre réflexion.
Les différences entre l'attraction réelle explicite et l'attraction explicite, telle qu'elle eût été souhaitée en fonction de l'attraction implicite, étaient trop grandes. L'attracteur, dominé par l'attraction explicite, « attirait » constamment le système la gestion opérationnelle et comptable. Il n'était pas possible de changer l'attraction et rapprocher les domaines en conservant les mêmes hypothèses de base. Il eût fallu construire un autre système, complémentaire, en partant d'hypothèses différentes tout en gardant la cohérence finale des informations avec le système comptable.
La rupture
Le troisième exemple analyse l'attracteur informationnel d'une entreprise, issue d'un institut de recherche, travaillant dans le génie logiciel et développant les services qui les accompagnent. Les deux secteurs d'activité appartenaient à deux entités distinctes. Avec le temps, l'évolution des marchés et des besoins des clients, la production de logiciels et les services ont fini par se spécialiser chacun de leur côté. Ils se sont mis à diverger d'autant plus qu'une volonté de croissance a poussé l'entreprise à en racheter d'autres dont les activités étaient plus ou moins similaires à la sienne.
Du fait de ses origines historiques, la culture de l'entreprise est restée relativement forte, caractérisée par un esprit pionnier. L'attraction implicite en témoigne, avec les valeurs « synthèse », « horizontale » et «collective » des variables « usage », « fonction » et « contexte ». (Voir le tableau 8 pour la synthèse des observations)
Cependant, en raison de l'évolution de l'entreprise et de son type de croissance par acquisitions successives, l'attraction implicite fut progressivement dominée par une orientation très marquée par le court terme, engendrée par la recherche du résultat immédiat et par un style de management très individuel. Les changements de management et les modifications de structure sont d'ailleurs nombreuses. Les valeurs « court terme » et « individuel » des variables « temps » et « contexte » ont fini par déterminer le caractère de l'attraction implicite.
Tableau 8 : attracteur de rupture - synthèse des variables
| variable | pôle | implicite | explicite | pôle |
|---|---|---|---|---|
| variations | ||||
| temps | court terme | ++++ | indéterminé | réel |
| long terme | -- | indéterminé | différé | |
|
opposition |
||||
| espace | limité | +++ | indéterminé | limité |
| non limité | +++ | indéterminé | non limité | |
|
opposition |
||||
| fonction | vertical | +++ | ++++ | exécution |
| horizontal | (++) | ---- | conception | |
|
opposition |
||||
| usage | analyse | ++ | ++++ | exhaustivité |
| synthèse | + | ---- | synthèse | |
|
opposition |
||||
| contexte | individuel (requin) | ++++ | ++++ | opérationnel |
| collectif (dauphin) | (++) | -- | communication intégration | |
|
opposition |
||||
L'attraction explicite est orientée vers la production et le développement des logiciels fournis par l'entreprise. C'est dans cette optique que doivent être considérés les poids des variables explicites « contexte », « fonction » et « usage », marqués par les valeurs élevées de l' « opérationnel », de l'« exécution » et de l'« exhaustivité ».
Pour le reste, il existe des systèmes et outils de travail et de communication individuels que chaque agent utilise au gré de ses envies et de ses besoins: le système informationnel est « a-structuré ». L'intelligence collective existe sous différentes formes dans l'implicite mais elle est très fragmentée selon les cultures d'origine et les activités des personnes.
Dans l'attracteur du système (voir figure 8), les attractions ne se répondent pas et restent dans leurs bassins respectifs. Les centres des systèmes d'axes sont éloignés. Ils ne possèdent qu'un point de tangence qui marque simplement le fait que l'attraction explicite prend la main lorsqu'il s'agit de fournir à un client un des produits ou service de l'entreprise, et que l'attraction implicite domine, quant à elle, la gestion de l'organisation. L'attracteur bascule d'un bassin à l'autre selon le problème à résoudre. Pour « visualiser » l'attracteur, il faut regarder sa représentation comme si les surfaces d'attraction passaient constamment de l'avant à l'arrière plan. Avec ce type d'attracteur, la matière informationnelle reste dans un état de quasi-déshérence.
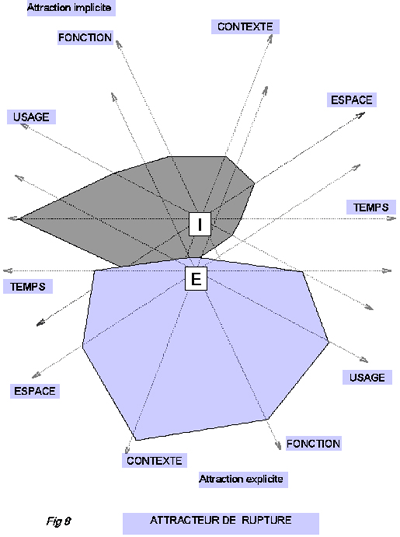
Il faut toutefois souligner que cette situation du système informationnel n'empêchait pas l'entreprise d'être efficace et de réaliser de très bons résultats. L'information mal ou non gérée n'empêche pas une entreprise d'être efficace.
Les différents exemples montrent différents archétypes d'attracteurs informationnels. Il en existe 3 selon qui différentient les situations d'attraction: le partage, la tension et la rupture.
L'attracteur de partage (Fig 9) (18) est celui où les bassins d'attraction sont globalement équilibrés et dans lequel les processus de transformation convergent vers la zone de partage des bassins d'attraction. Avec un attracteur de partage, lorsqu'un besoin est exprimé, il trouve directement sa traduction dans la mise en place de nouveaux outils, dans l'amélioration de processus existant, ... qui ont un effet de levier sur les potentialités de l'organisation. La créativité peut dès lors se traduire en projets concrets. Il y a cohérence et adéquation entre la culture de l'organisation, les besoins, les informations et les outils disponibles. Le SI de l'entreprise est géré et cette gestion tend à faire évoluer l'attracteur vers un partage optimal. Comme on l'a vu dans l'exemple de l'ONG, les problèmes informationnels trouvent plus facilement une solution.
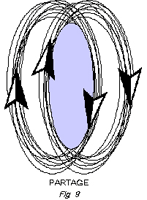
Dans les attracteurs de tension (Fig 10), l'une des deux attractions est dominante. Les processus de transformation divergent et la zone commune des bassins d'attraction est l'enjeu d'une lutte. Lorsque l'attraction implicite domine, il n'y a pas de lieu pour l'apprentissage et le retour d'expérience. L'entreprise ne parvient pas à valoriser son potentiel de créativité, les projets ne décollent pas. Dans le cas inverse, la domination de l'attraction explicite étouffe les facultés d'innovation et laisse les besoins réels de l'entreprise sans réponse. On a vu dans l'exemple de la banque qu'il fut pratiquement impossible d'obtenir une réponse satisfaisante quant à la rentabilité des activités internationales. Dans les deux cas, technologies et procédures ne répondent pas de manière adéquate aux besoins. La gestion du SI de l'entreprise est dispersée entre les agents avec le plus souvent une trop grande prégnance de la technologie. L'évolution du SI passe par une remise en question des hypothèses sur lesquelles il est construit.
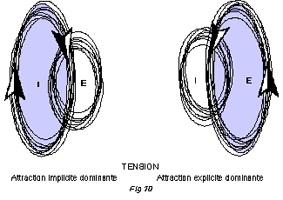
Le troisième type d'attracteur (Fig 11) concerne les attracteurs de rupture. Il n'existe ni cohérence ni adéquation entre les domaines implicites et explicites. Cela se marque essentiellement dans l'inadéquation du SI à la prise de décision et à l'exécution des tâches ainsi que dans une culture très individualiste. L'information est en complète déshérence et l'efficience du SI est nulle si pas négative. Les ressources informationnelles ne sont pas gérées. Il faudra des changements progressifs, systématiques et constants dans les deux attractions pour se diriger vers plus de partage ce qui suppose un changement de culture dans l'organisation.
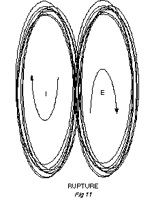
Une remarque importante s'impose. Cette typologie ne préjuge en rien de l'efficacité des organisations. En effet nombre d'entreprises dégagent de très bons résultats alors que leur information ou d'autres ressources sont très mal gérées. Ces organisations sont efficaces mais inefficientes. L'efficacité mesure le résultat tandis que l'efficience mesure le rapport entre les moyens consacrés et les résultats obtenus. On peut donc être très efficace sans être efficient. Les résultats pourraient être cependant supérieurs avec un meilleure gestion des ressources informationnelles.
L'attracteur donne une vue globale d'un système ou sous système d'information et en décrit le comportement. Il donne ainsi la possibilité d'agir sur le SI afin d'arriver à une meilleure utilisation des ressources informationnelles.
La présence d'un attracteur de partage est la situation optimale. Elle permet de distinguer les zones de faiblesse du SI et de voir ce qu'il faut faire pour les renforcer. Comme on le verra plus loin, ce type d'attracteur est le seul qui facilite l'émergence d'une spirale de connaissance. Avec les attracteurs de tension, l'amélioration du SI passe d'abord par le changement des hypothèses de base qui ont présidé à son élaboration. Cette démarche n'est pas facile à faire admettre et accepter par les acteurs concernés. Les attracteurs de rupture, à notre avis les plus nombreux, présentent pour le SI un défi considérable car il s'agit d'opérer un changement dans la culture de l'organisation.
Améliorer un SI en présence d'attracteurs de tension ou de rupture se heurte donc à des barrières psychologiques considérables. Outre la résistance au changement, la plupart des managers veulent obtenir, en matière d'information, des résultats immédiats et ne retiennent que les produits technologiques « clés sur porte ». Or l'approche par les attracteurs nécessite une réflexion de fonds sur l'information.
Comme nous l'avons déjà mentionné, les valeurs attribuées aux 5 variables d'un SI sont le résultat d'une croyance vraie et justifiée dans l'importance donnée à la variable. Elles résultent du travail d'observation que nous avons esquissé en décrivant les variables. Ce travail s'apparente à une maïeutique informationnelle. Il s'agit d'amener l'entreprise elle-même à « accoucher » du système informationnel dont elle est porteuse. Il a pour objectif de cerner domaines, transformations et passage et de faire émerger l'attracteur. Pour ce faire, il s'appuie sur une cartographie du SI qui démontre sa sensibilité aux cinq variables. Il peut être individuel ou collectif. Dans le premier cas, l'observateur utilise l'attracteur comme outil d'analyse afin de trouver la solution à un problème (l'exemple de l'attracteur de partage). L'autre approche consiste à former un petit groupe de personnes motivées, connaissant bien l'entreprise et de dresser ensemble les cartes du SI.
Il existe bien sur bien des nuances entre ces deux extrêmes. Des contraintes sont cependant à respecter. Dès l'abord, il faut toujours conserver la vision d'ensemble. L'échelle des cartes ne sera ni trop grande, pour ne pas se perdre dans les détails, ni trop petite pour conserver les points de repère significatifs. Ensuite il est indispensable de valider en permanence les hypothèses et les résultats. Enfin il faut éviter de tomber dans trois pièges: détourner le travail pour entreprendre soit un travail de ré-ingénierie du SI , soit un projet de gestion des connaissances, c'est-à-dire faire expliciter par les acteurs la part tacite de leur savoir, soit se livrer à un choix de technologies.
Nous mentionnons brièvement les trois jeux de cartes utilisés dans la cartographie (19). Le premier est celui qui permet de parcourir les processus génériques de l'entreprise et certains processus générés, spécifiques et essentiels, sans lesquels elle serait incapable de fonctionner. Le second jeu est celui des usages informationnels qui associe à chaque carte du premier jeu les informations, implicites et/ou explicites, que le processus utilise et produit lors de son exécution. C'est un agrandissement des cartes des processus vues sous l'angle informationnel. Le troisième jeu de cartes montre les suites de transformations de données en informations, leurs agrégations et les différentes vues des triangles opérateurs sur les informations. Les trois jeux de cartes sont complétés les technologies avec leurs historiques, les objectifs de départ et la description de l'utilisation réelle qui en est faite.
Nous avons vu que dans un système informationnel les champs de l'implicite et de l'explicite sont liés. Il existe dans l'attracteur un lieu commun- quelle que soit par ailleurs sa « surface »- dans lequel les forces d'attraction entrent en compétition. Ce mélange des attractions caractérise l'attracteur et lui donne sa force. Cet espace est un lieu de partage, de tension ou de rupture.
Considérons maintenant le modèle (20) SECI (Fig. 8) de Nonaka et Takeushi (21) qui décrit la création d'une spirale de connaissance par les passages de la connaissance implicite vers la connaissance explicite. Très brièvement, les échanges informels devant « la machine à café » (connaissance sympathique) se transforment progressivement en concepts (connaissance conceptuelle). Ceux ci sont combinés pour former un système (connaissance systémique) qui est alors opéré, intériorisé- c'est le retour vers l'implicite (connaissance organisationnelle)- et on se retrouve finalement devant la machine à café. Mais c'est une nouvelle machine et le café est meilleur. La boucle recommence et la spirale de connaissance est amorcée. Chaque cadrant forme un « ba », concept que Nonaka et Konno (22) ont introduit en poursuivant leur réflexion sur la formation de connaissances dans l'entreprise et mieux l'expliquer. Le « ba » pourrait se traduire grossièrement en français par « lieu » ou « espace », un espace partagé pour des relations émergentes.
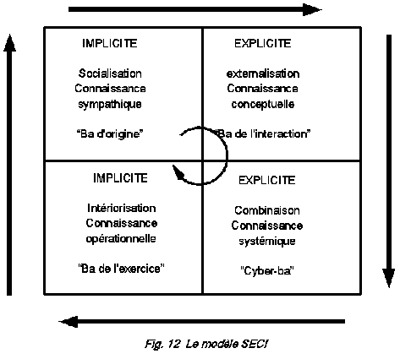
Nous avons défini la connaissance comme l'ensemble des informations qui permettent d'agir. Elle émerge donc du SI qui constitue la source où la spirale prend naissance. L'attracteur informationnel est alors la force qui déclenche et entretient le mouvement de la spirale.
L'espace commun partagé des bassins d'attraction forme un « ba », un lieu virtuel d'échanges entre les deux attractions de l'attracteur. Le passage d'une étape de la connaissance à l'autre ne peut se faire harmonieusement que si l'attracteur du système d'information est du type partagé. Dans ce cas, la partie commune des bassins d'attraction forme comme un « ba de synthèse », ou « ba d'intégration », un espace à partir duquel le processus dynamique de création de connaissances peut se déployer et amorcer sa spirale créative. Cette dernière exerce une rétroaction sur l'attracteur informationnel par le biais des changements résultant d'une accumulation de nouvelles informations via l'intériorisation.
Les autres types d'attracteur auraient comme effet de déséquilibrer la création de connaissances soit en donnant trop d'importance à certains processus de transformation (attracteur de tension) soit en les dissociant complètement (attracteur de rupture) et en empêchant par-là les passages de l'implicite à l'explicite. Autrement dit, la spirale ne « couvrirait » pas les passages d'un domaine à l'autre mais se diviserait, une pour chaque domaine.
On admet volontiers que l'information est une ressource et qu'elle exerce un effet de levier important sur toutes les autres ressources de l'organisation. Notre pratique nous montre qu'en général l'information n'est pas gérée au même niveau de responsabilité et d'importance que les ressources financières, humaines, technologiques, ...
Optimaliser l'information demande une bonne connaissance du SI qui constitue un système complexe adaptatif. Mais il y a un refus de cette réalité. Trop souvent le système est décomposé et géré par morceaux ce qui, nous l'avons vu, détruit des aspects essentiels de son comportement et de sa structure. La technologie exerce également son emprise trop prégnante qui rassure les managers mais génère une vision réductrice du système. On confond également connaissance et information, sans bien réaliser que la connaissance est issue du SI et qu'il ne sert à rien de tout vouloir expliciter. Le domaine de l'information implicite reste toujours présent et résistera à toutes les tentatives pour le faire disparaître tout simplement parce qu'il constitue une part intime de l'expérience tant individuelle que collective des acteurs de toute société ou organisation.
Il faut saisir un système informationnel dans son ensemble pour pouvoir en comprendre le comportement, rendre compte de l'entrelacs des passages, des transformations et des rétroactions entre les composants et domaines de la matière informationnelle et mesurer sa sensibilité aux cinq variables dont il dépend.
C'est ici qu'intervient l'attracteur informationnel. Il explique le SI. En caractérisant l'attraction du système, il donne les raisons pour lesquelles telle ou telle évolution est possible ou non. Son analyse indique les motifs et la nature des changements à effectuer et leur direction. C'est par la connaissance de l'attracteur qu'on peut valoriser au mieux les ressources informationnelles. C'est une autre approche, différente, qui exige une réflexion de fonds sur l'information.
Notre dernière conclusion aura trait à l'importance du facteur humain dans les systèmes d'information. C'est l'acteur essentiel, irréductible à la technologie. Le savoir, la connaissance résident toujours en dernier ressort chez les femmes et les hommes. Seuls ils possèdent la capacité de les faire émerger.
Notes
0) Alain Tihon est consultant en stratégie d'information et gestion des connaissances et en ré-ingénierie des processus. Il est diplômé en économie appliquée (ICHEC Bruxelles). Il possède une longue expérience dans le management de l'information dans le secteur bancaire où il a exercé de nombreuses fonctions de management dans des secteurs variés. Il a crée Spin out en 1997 pour conseiller les entreprises et les ONG dans leurs choix stratégiques en matière de systèmes d'information et de connaissances. Il a publié différents articles: « L’intelligence économique dans la PME : visions éparses, paradoxes et manifestations », Coordonné par Alice Guilhon, L’Harmattan 2004 (En collaboration avec Marc Ingham, professeur IUM), « L’attracteur informationnel » Cahier de la Documentation 2005/1, Mars, « A different approach to information and knowledge management » publié sur :« http://www.knowledgeboard.com/lib/3493 » Il est l'auteur du livre, « Les attracteurs informationnels » publié par les éditions Descartes & Cie, Paris, 2005.
1) Les attracteurs informationnels, Alain Tihon, Descartes & Cie, Paris, Collection Interface-économie 2005
2) Byosiere P., Ingham, M. « Création de connaissances et innovations », Revue française de gestion, mars-avril-mai 2001
3) La loi de Parkinson énonce que «Une tâche nécessite toujours tout le temps dont on dispose pour l'effectuer». Si un manager dispose de 10 personnes pour effectuer une tâche qui en demande normalement 5 pendant un mois, il réussira toujours à occuper les 10 à cette même tâche pendant un mois ». In « 1 = 2 ou les règles d'or de Mr. Parkinson », Parkinson C. Northcote, Robert Laffont, Paris, 1957. Le principe de Peter: « Dans une hiérarchie, chaque employé tend à s'élever jusqu'à son niveau d'incompétence » et certains le pulvérisent, ajoutent les mauvaises langues. In « The Peter Principle » Dr Laurence J. Peter and Raymond Hull, Pan Books 1970.
4) « Les attracteurs informationnels » op cit. Nous suivons l'explication donnée par Rafael Capurro dans « ON THE GENEALOGY OF INFORMATION » , papier publié pour la première fois dans: K. Kornwachs K. Jacoby Eds. « Information. New Questions to a Multidisciplinary Concept », Akademie Verlag Berlin 1996, p. 259-270.
5) Tiré de Ikujiro Nonaka, Noboru Konno, The Concept of "Ba’: Building Foundation for Knowledge Creation. California Management Review, Vol 40, No.3 Spring 1998.
6) Dans la suite, le terme information couvre en fait le triplet donnée, information, connaissance.
7) Par agent, nous entendons soit une personne, soit un ou plusieurs groupes, formels, par exemple un groupe de travail pour un projet, ou informels, soit un morceau de la structure ou d'un système de l'organisation.
8) Neil McBride in « Chaos Theory and Information Systems », Department of Information Systems, Faculty of Computing Sciences and Engineering, De Montfort University, Leicester, GB.
9) In « Chaos Theory and Information Systems ». Op cit.
10) Une transformation est une fonction d'opérateurs et d'opérations.
11) « Les attracteurs informationnels » pp 80, op cit. Voir “Complexity , The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos”, le chapitre consacré à John H. Holland pp 144 et suivantes.
12) In « Management et complexité: Concepts et théorie » R.A. Thiétart, Cahier n°282 Avril 2000 CENTRE DE RECHERCHE DMSP, Dauphine Marketing Stratégie et Perspectives.
13) Ces exemples sont tirés de « La théorie du chaos. Vers une nouvelle science » , James Gleick, Albin Michel 1989
14) Des seaux percés sont accrochés à la jante de la roue. L'eau se déverse en haut de celle-ci. A un certain niveau de débit, la roue se met à tourner car le poids du seau supérieur déclenche un mouvement régulier. En augmentant progressivement le débit, il arrive un moment où le mouvement devient chaotique. Il n'est plus possible de prévoir le sens de la rotation.
15) Edward Lorenz est un mathématicien et météorologue américain qui a travaillé au Massachussets Institute of Technology d ans les années 60. C'est en travaillant sur la météo qu'il a découvert l'attracteur.
16) L'attracteur de Lorenz, « La théorie du chaos. Vers une nouvelle science » p 50, op cit.
17) Les comportements « dauphin » et « requin » caractérisent les dimensions collectives et individuelles de la variable. Ils sont expliqués dans « La Stratégie du Dauphin », Dudley Smith et Paul Kordes, les Editions de l'Homme, 1994.
18) Les polygones donnent une vue « statique » de l'attracteur d'un SI. En fait l'attracteur est un objet complexe et dynamique. Il faut l'imaginer dans l'espace. Les ellipses donnent , mutatis mutandis, une représentation générale plus conforme à l'attracteur de Lorenz.
19) Voir « Les attracteurs informationnels » op cit, pp 127 et suivantes.
20) S= socialisation, E = externalisation, C = combinaison et I = intériorisation.
21) In Nonaka I. Takeuchi H. ( avec des contributions de M. Ingham). « La connaissance créatrice : la dynamique de l’organisation apprenante », De Boeck, Collection management, Bruxelles, 1997
22) Voir Ikujiro Nonaka, Noboru Konno, op. cit.
Bibliographie
Information processing. In Encyclopædia Britannica, 2007
ANDREU R.,CIBORRA C., « Core Capabilities and Information Technology: an Organizational Learning Approach” dans Moingeon B., Edmondson A.,(Eds) “Organizational Learning and Competitive Advantage”, Sage Publications, 1996
BAUMARD PHILIPPE, « Les paradoxes de la connaissance organisationnelle », dans Emmanuel Josserand & Véronique Perret, « Les paradoxes de la connaissance », Paris, Ellipses, juin 2002.
BRUNDTLAND GRO HARLEM, « Shifting Attitudes in a Changing World », Special report, Encyclopædia Britannica, Year in Review 1997
BYOSIERE P., INGHAM, M., « Création de connaissances et innovations », Revue française de gestion, mars-avril-mai 2001
CAPURRO RAFAEL, « On the genealogy of information », Paper presented at the international conference: « Information. New Questions to a Multidisciplinary Concept », organized by the German Society for System Research. First published in: K. Kornwachs K. Jacoby Eds. « Information. New Questions to a Multidisciplinary Concept », Akademie Verlag Berlin 1996, p. 259-270.
CHURCHMAN WEST, « The Design of Inquiring Systems », Ink Publishers, 1971.
CLARKE ROGER, « Fundamentals of 'Information Systems' », Principal, Xamax Consultancy Pty Ltd, Canberra Visiting Fellow, Department of Computer Science, Australian National University.
DAVENPORT THOMAS H., « Privilégier l'information sur la technologie », article paru dans le Supplément des Echos : L'art du management de l'information, 1er et 2 octobre 1999, p. III.
DAWKINS , « Journal of Memetics » (http://jom-emit.cfpm.org/) et « Société francophone de mémétique » (« http://www.memetique.org »), 1976
DITLEA STEVE, « Applying Complexity Theory to Business Management » by Technology Cybertimes, 1997.
GALBRAITH J.K, SALINGER NICOLE, « Tout savoir ou presque sur l’économie », Seuil, 1978
GUILLAUME MARC, « L'empire des réseaux », Editions Descartes & Cie, 1999.
HAMMERS MICHAEL, CHAMPY JAMES, « Réinventons l'entreprise », Dunod, 1993
INGHAM M., DELMEIRE C. , « Balancing Technological and Organizational Platforms to Create Knowledge. », Academy of Management Meeting, Denver, 2002
JAMES GLEICK, « La théorie du chaos. Vers une nouvelle science », Albin Michel, 1989
JARROSSON BRUNO, « Conseil d'indiscipline. Du bon usage de la désobéissance », Editions Descartes & Cie, 2003
KINGSOLVER BARBARA, « Petits miracles et autres essais », Rivages, 2002
LESCA H., LESCA E., « Gestion de l’information, », Litec, 1995.
MCBRIDE NEIL, « Chaos Theory and Information Systems », Department of Information Systems, Faculty of Computing Sciences and Engineering, De Montfort University, Leicester, GB.
MéTAIS & MOINGEON, 2001, Cross & Baird 2000
NONAKA, I., TAKEUCHI H., “The Knowledge Creating Company” Oxford University Press, 1995
NONAKA I. TAKEUCHI H. ( avec des contributions de M. INGHAM). « La connaissance créatrice : la dynamique de l’organisation apprenante », De Boeck, Collection management, Bruxelles, 1997
NONAKA IKUJIRO, KONNO NOBORU, « The Concept of « Ba »: Building Foundation for Knowledge Creation », California Management Review, Vol 40, No.3, Spring 1998.
PARKINSON C. NORTHCOTE, « 1 = 2 ou les règles d'or de Mr. Parkinson », Robert Laffont, Paris, 1957.
PETER DR LAURENCE J., RAYMOND HULL, The Peter Principle », Pan Books,1970
POLANYI, M. , « The Tacit Dimension », London, Routledge & Kegan Paul, 1966
ROSZAK, « The Cult of Information », Pantheon 1986, cité in « Fundamentals of Information Systems», Roger Clarke,Principal, Xamax Consultancy Pty Ltd
SANTOSUS MEGAN, « Simple Yet Complex », CIO Enterprise Magazine, April 15 1998 et Wizards and CEOs:The Oz Factor » A story from JOHN R. KOPICKI, President and CEO, Muhlenberg Regional Medical Center.
SHANNON CLAUDE E., « A Mathematical Theory of Communication » Warren Weaver, University of Illinois Press, 1963.
SMITH DUDLEY, KORDES PAUL, « La Stratégie du Dauphin », les Editions de l'Homme, 1994.
STIGLITZ JOSEPH E., «La grande désillusion», Fayard, 2002
STIGLITZ JOSEPH E., «Quand le capitalisme perd la tête», Fayard, 2003
THIéTART R.A., « Management et complexité: Concepts et théorie », Cahier n°282, CENTRE DE RECHERCHE DMSP, Dauphine Marketing Stratégie et Perspectives, Avril 2000
WALDROP M. MITCHELL, « Complexity , The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos », A Touchstone Book, 1992. Consulter également le site du SANTA FE INSTITUTE, institut dédicacé à l'étude de la complexité. (http://www.santafe.edu/)
« Fontaines de connaissance » ou « musées du livre » ?... Les bibliothèques municipales selon leurs non-usagers
Ressi — 30 novembre 2007
Olivier Moeschler, OSPS Observatoire Science, Politique et Société, Université de Lausanne
Résumé
Dans toutes les grandes agglomérations, environ la moitié de la population, voire plus, ne fréquente pas les bibliothèques municipales. C’est notamment le cas à Genève, où une étude compréhensive a été menée sur les pratiques et les représentations des non-usagers de bibliothèques municipales, afin de mieux comprendre les logiques de non-fréquentation de ces établissements.
Mis à part le degré de notoriété des bibliothèques municipales ou le rapport des personnes au livre et à la lecture, ce sont les images positives et négatives associées aux bibliothèques et aux bibliothécaires qui s’avèrent être un obstacle important pour les non-usagers (qui sont souvent des ex-usagers) et qui les empêchent de réintégrer la fréquentation de ces établissements dans leurs habitudes.
L’étude, menée avec la collaboration d’une volée d’étudiants futurs bibliothécaires, procède à une radiographie sans fard de cet imaginaire qui n’échappe pas à certaines caricatures, tout en proposant des pistes pour transformer ces « ennemis symboliques » des bibliothèques en alliés et réinscrire ces établissements au cœur de la Cité.
Les bibliothèques municipales à Genève, ce sont 7 bibliothèques (espaces adultes et jeunesse), une médiathèque, un établissement dédié au sport, deux discothèques et un service de bibliobus (5 véhicules en tout), incluant un service à domicile et un service de prison, avec 190 collaborateurs au total. Pas moins de 620'000 documents sont disponibles en libre accès, et l’on dénombre 50'000 inscrits, 500'000 visites et 1'600'000 prêts annuels (7'600 prêts par jour) ainsi que 270 animations culturelles par an (1).
Toutefois, une partie considérable de la population genevoise – environ la moitié, selon un sondage récent – ne profite pas de cette offre impressionnante (2). Pourquoi ces personnes ne fréquentent-elles pas les bibliothèques municipales ? Comment devient-on un non-usager de bibliothèques ? Et qu’est-ce qui pourrait faire (re-)venir ces personnes dans ces établissements ?
Pour répondre à ces questions, une étude exploratoire a été menée par le soussigné, dans le cadre du cours « Sociologie des publics » qu’il dispense à la HEG Haute école de gestion, Filière information documentaire, en collaboration avec la Cellule étude et projets du Service des bibliothèques et des discothèques municipales, au Département des affaires culturelles de la Ville de Genève. Elle s’inscrivait dans le « Projet accueil » mené par la Cellule, dont le but est l’élaboration d’une nouvelle stratégie d’accueil – et notamment d’une Charte d’accueil – au sein des bibliothèques municipales à Genève (3). Cette démarche, inédite dans la Cité de Calvin, se base sur les résultats de trois enquêtes :
- dans un premier temps, une investigation a été menée à l’interne, auprès des équipes des différentes bibliothèques municipales à Genève. Celles-ci ont été priées de remplir un questionnaire portant sur des thèmes tels que les valeurs fondatrices, les missions et les satisfactions du métier de bibliothécaire, les compétences mobilisées, l’accueil des usagers ou encore la fonction des bibliothèques. Les conclusions de cette première enquête ont servi de base à la rédaction d’une première version de la Charte ;
- dans un deuxième temps, deux enquêtes « externes » ont eu lieu, respectivement auprès des usagers et des non-usagers des bibliothèques municipales genevoises. Ces deux études ont été menées par des professeurs de la HEG, dont le soussigné, dans le cadre de travaux pratiques d’étudiants de la Filière information documentaire. Les résultats de ces deux enquêtes ont également eu une influence sur la Charte d’accueil puisqu’ils ont été diffusés au sein des établissements au moment de la consultation interne de la première mouture de cette dernière.
Cette contribution présente les résultats issus de l’un des deux volets de l’enquête externe, portant sur les non-usagers des bibliothèques municipales à Genève. Car, si elle s’inscrit dans le contexte d’une démarche spécifique et locale, cette étude voudrait également contribuer, au-delà des frontières genevoises, à combler une lacune concernant une population assez peu connue et difficile à étudier.
On sait à travers les statistiques nationales que la majorité de la population ne fréquente pas, loin s’en faut, les bibliothèques : en France, selon la dernière édition des Pratiques culturelles des Français, en 1997, pas moins de 69% – ou sept personnes sur dix de la population française de 15 ans et plus – n’avaient pas fréquenté, dans les douze mois, de bibliothèque ou médiathèque. Cette étude nous rappelle que la fréquentation de ces établissements est directement liée à l’âge (seul un peu plus d’un tiers des 15-19 ans n’a pas fréquenté d’établissement dans les douze mois, contre 85% des 65 ans et plus), mais aussi à la catégorie socioprofessionnelle des personnes concernées : en effet, les cadres, les professions intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires ont bien plus de chances de fréquenter une bibliothèque ou médiathèque que des ouvriers, des employés, des artisans ou encore des agriculteurs (Donnat, 1998 : 241-244) (4). De plus, cette étude révèle que si la part d’usagers a augmenté entre 1989 et 1997 en France (de 23% à 31%), ces chiffres portent en fait, on l’a dit, sur les « bibliothèques et médiathèques » ; surtout, la part d’usagers non-inscrits a augmenté elle aussi entre ces deux années, et ce plus fortement, suggérant une utilisation de plus en plus variée – pas forcément liée au prêt de supports – de ces établissements, une tendance à la diversification des usages par ailleurs confirmée récemment par une enquête du CREDOC (Maresca, 2006) (5). Les usagers des bibliothèques municipales sont par ailleurs assez bien connues : une étude menée il y a quelques années à l’échelle nationale en France en a décrit dans le détail les caractéristiques, les habitudes et les opinions (Bertrand et al., 2001).
Mais peu de choses sont connues au sujet d’une population qui, par définition, est moins facile à cerner, pour la simple raison que, précisément, elle ne se trouve pas entre les murs des établissements qu’elle ne fréquente pas, et où il aurait été aisé de les interroger. Pourtant, lors d’un colloque de sociologues de la réception tenu il y a quelques années et dont les actes viennent de paraître, l’importance de l’étude des « non-publics de l’art » – le pluriel est, on le verra, important – a été réaffirmée (Ancel et Pessin, 2004). Pour le domaine des bibliothèques, un spécialiste des publics a récemment relevé un manque de connaissances en la matière : selon cet auteur, il « serait intéressant de pouvoir disposer de travaux compréhensifs auprès des non-usagers, de façon à mieux connaître cette population et la manière dont elle perçoit l’offre des bibliothèques » (Poissenot, 2002 : 20). La présente étude s’inscrit dans la droite ligne de cette exigence de plus d’analyses qualitatives, à l’image de l’enquête du CREDOC déjà citée, menée en 2005 également auprès de focus groups.
Réalisée à Genève dans le cadre d’un travail pratique d’étudiants de première année en Information documentaire – de futurs bibliothécaires donc – à la HEG, l’étude dont on rend compte ici ne peut bien sûr remplacer une démarche qui nécessiterait, pour produire des résultats tant soit peu représentatifs, des moyens autrement plus importants. Mais elle peut fournir quelques premiers éléments de réponses aux questions posées et, partant, des pistes pour des recherches plus systématiques à entreprendre à l’avenir, à Genève ou dans d’autres agglomérations urbaines.
Comment interroger des non-usagers de bibliothèques municipales, où les trouver ? En accord avec la Cellule étude et projets, mais aussi en relation avec les possibilités données, on a opté pour une approche relativement ouverte et exploratoire : le but de cette enquête menée « hors les murs » était moins de récolter un grand nombre d’informations quantifiables sur les non-usagers que d’être à l’écoute ce ces derniers, de recueillir leur parole. La méthode choisie était donc résolument qualitative et compréhensive : c’est moins la représentativité que l’on cherchait à obtenir qu’une variété de témoignages. Ceci afin de décrire, dans le détail, les craintes et les freins, mais aussi les attentes et les désirs des non-usagers en matière de bibliothèques, et plus généralement de comprendre plus précisément les raisons de leur non-fréquentation ce ces établissements.
Un bref questionnaire-grille d’entretien a été élaboré en collaboration avec la Cellule ainsi que suite à un brainstorming des étudiants concernés, qui se sont montrés enthousiastes à l’idée d’interroger cette population à la fois peu connue et potentiellement centrale dans leur future pratique de bibliothécaires. Outre la problématique générale de la démocratisation culturelle et l’inégalité de l’accès aux lieux de culture, les thématiques et aspects suivants nous ont intéressés :
- la question de l’accueil était au centre des interrogations : les personnes ont-elles eu par la passé des (mauvaises) expériences avec l’accueil dans les établissements ?
- Plus généralement, il s’agissait de décrire les pratiques – il faudrait dire non-pratiques dans ce cas – et les représentations des individus en matière de bibliothèques : pour quelles raisons ne fréquentent-ils pas, ou plus, ces établissements ? Pourquoi n’ont-ils pas le « réflexe bibliothèque » ? Comment les personnes perçoivent-elles les bibliothèques et les bibliothécaires ? Quelle est la fonction, quels sont les avantages ou les désavantages de ces établissements à leurs yeux ?
- Au sein des répondants, on a tenu à pouvoir distinguer les non-usagers « absolus » du groupe un peu particulier des ex-usagers : en effet, les professionnels se rendent compte que, venu un certain âge, bon nombre de personnes, pourtant inscrites en bibliothèque, cessent de les fréquenter.
- On a également travaillé dans l’optique de ce qu’on appelle le « deficit model », postulant une méconnaissance de l’offre, voire de l’existence même des bibliothèques municipales : quel est leur degré de notoriété dans le quartier, et des autres bibliothèques municipales genevoises ? Les personnes connaissent-elles l’éventail de supports qui leur est proposé dans ces établissements ?
- La question des loisirs médiatiques en général des personnes nous a également intéressés ; parmi les différents supports utilisés (médias, DVD, Internet…), la question de la lecture, mais aussi du rapport à l’objet « livre », nous a particulièrement occupés : comment les personnes se procurent-elles des livres, si elles ne les empruntent pas ? Trouvent-elles important de posséder un ouvrage et pourquoi ?
- Le thème des enfants – de la non-fréquentation des bibliothèques par des parents de jeunes enfants – a aussi été considéré.
- On s’est enfin intéressé en outre à l’usage potentiel des établissements : que devrait proposer une bibliothèque selon les non-usagers, qu’est-ce qui pourrait éventuellement les faire (re-)venir en bibliothèque ?
- Les questions de profil portaient sur le sexe, l’âge, la formation, la profession, la langue, la nationalité, le domicile et les raisons de la présence dans le quartier.
Au final, le questionnaire comportait une vingtaine de questions, très souvent ouvertes, ainsi que les questions sociodémographiques. Le lecteur intéressé le trouvera annexé à ce texte.
Adaptée aux possibilités en termes de temps (l’ensemble de l’enquête devait se faire sur un semestre) et de personnel disponible (les deux classes concernées comptaient une quarantaine d’étudiants, répartis en groupes), la démarche choisie impliquait que l’on découpe la ville en une douzaine de zones, correspondant en gros aux bibliothèques et discothèques municipales existantes (plus un quartier sans bibliothèque, comme « groupe de contrôle », et un groupe s’occupant des quartiers traversés par le bibliobus), dans lesquels des « micro-échantillons » de la population étaient à interroger (6).
Dans chacune des ces zones, une vingtaine d’individus environ ont été interviewés par les étudiants (5 répondants par enquêteur) en avril et mai 2006 ; ces derniers avaient reçu l’instruction de choisir les personnes de manière aussi aléatoire que possible, tout en veillant au mieux à l’équilibre de leur échantillon de quartier (notamment en termes de sexe, d’âge et de nationalité) (7). Des tris effectués sur des données obtenues auprès de l’Office cantonal de la statistique genevois avaient permis d’avoir une image globale de la population des quartiers concernés en termes d’âge et de nationalité, ce qui pouvait servir de repère aux étudiants dans leurs enquêtes. Toute personne de 15 ans ou plus entrait en ligne de compte pour l’interrogation, pour autant bien sûr qu’elle réponde par la négative à la première question : celle de savoir si elle avait fréquenté une bibliothèque municipale genevoise dans les douze derniers mois (8). Il ne s’agit donc pas forcément d’échantillons d’habitants des quartiers concernés : en effet, vu la mobilité des personnes à l’intérieur d’une ville et la possibilité qui en découle de s’inscrire et d’emprunter dans des établissements se situant ailleurs que dans son quartier d’habitation, on a renoncé à se limiter aux seules personnes domiciliées dans la zone en question. Les échantillons concernent donc des personnes qui habitent, travaillent, font leurs courses, se promènent ou qui se trouvent pour quelque autre raison que ce soit dans les espaces publics (rues, places) du quartier concerné aux heures de pointe, à savoir à midi ou en fin d’après-midi, un jour de semaine (et c’est dans ce sens que l’on parlera dans la suite de « leur » quartier) ) (9).
Les données recueillies dans les quartiers ont fait l’objet d’un double travail de la part des étudiants. Dans un premier temps, des portraits individuels ont été réalisés pour chacune des personnes interrogées : rédigés à partir de prénoms fictifs selon des directives uniformes, le but de ces petits textes (d’une demi page environ) était de transformer en un récit et, par là, de rendre lisibles et communicables les informations récoltées au cours du mini-entretien conduit (10). Cette opération impliquait donc une mise en ordre et, déjà, un premier choix parmi les réponses des individus ; avec notamment la question de savoir quelles réponses ouvertes – jugées particulièrement révélatrices, originales, drôles ou inquiétantes – inclure comme citation dans le portrait. Puis, dans un deuxième temps, chaque groupe d’étudiants a rédigé une synthèse des réponses de son quartier, sur la base de la mise en commun et confrontation des informations recueillies par chaque membre du groupe.
Les chapitres qui suivent présentent d’une certaine manière la « synthèse des synthèses », ou un résumé des synthèses d’étudiants et des principales tendances qui se dégagent du kaléidoscope d’informations et de témoignages aussi riches que parfois inattendus recueillis auprès des non-usagers de bibliothèques municipales dans les différents quartiers de Genève. Le rapport final complet est disponible auprès de l’auteur.
La première image qui se dégage des données récoltées est celle d’une grande hétérogénéité : à lire la douzaine de synthèses de quartier et les quelque 200 portraits confectionnés par les étudiants, « le » non-usager de bibliothèques municipales – au sens d’un individu au profil typé – n’existe pas !
Sans doute qu’une analyse statistique révélerait, au sein de l’échantillon des personnes interrogées, une surreprésentation de certains groupes (socialement défavorisés) et une sous-représentation d’autres (les catégories socioprofessionnelles supérieures, dont on a dit qu’elles ont plus de chances de fréquenter les bibliothèques). Mais les réponses récoltées montrent surtout que dans tous les milieux sociaux, toutes les professions, toutes les nationalités et tous les âges, les individus ont de « bonnes » raisons – ou pensent du moins en avoir – de ne pas fréquenter les bibliothèques municipales. A l’image des pratiques culturelles elles-mêmes, très éclectiques et individualisées (Donnat, 1994 ; Lahire, 2004), le non-public des bibliothèques est, en définitive, pluriel, la non-utilisation de ces établissements prenant des formes multiples.
Le profil des personnes interrogées est donc, par définition, très hétérogène ; de fait, tout le monde peut être, ou devenir, un non-usager de bibliothèques municipales. Un des groupes d’étudiants a décrit l’échantillon très bigarré des personnes abordées comme suit : « trois étudiants, dont un qui travaille à 40% à côté de ses études, un cameraman, une femme qui travaille dans le domaine social, un ‘SDF en plus sain’, une esthéticienne, un cuisinier, un éducateur, une commerçante, un garagiste, une nettoyeuse, un rédacteur, une employée de commerce et une retraitée ». Mais dans les échantillons de certains quartiers, des tendances sont perceptibles, notamment en termes de nationalité – au moins autant en lien avec la composition de la population du quartier qu’avec des tendances concernant la population globale des non-usagers. Ainsi, dans le quartier de la Servette, l’échantillon interrogé était, selon les étudiants, « principalement de nationalité suisse » ; aux Pâquis par contre, quartier où, selon les statistiques disponibles, les personnes de nationalité étrangère sont majoritaires, les étudiants n’ont rencontré que trois Suisses sur 15 répondants, et ont décrit ce quartier comme « extrêmement cosmopolite » ; un multiculturalisme qui constitue à ne pas en douter un défi pour les bibliothèques, sur lequel nous reviendrons par la suite.
Autre tendance qui se dégage : les raisons pour ne pas, ou plus, fréquenter de bibliothèques municipales sont nombreuses et variées ; elles ne sont en aucun cas réductibles à la question de l’accueil. En effet, en règle générale, l’accueil dans les établissements ne constitue, selon les souvenirs des non-usagers (qui sont très souvent, c’est un autre résultat de cette étude, des ex-usagers), pas un problème, l’accueil étant même en majorité loué comme ayant été très bon (rappelons que les étudiants avaient reçu l’instruction de ne pas mentionner le fait qu’ils allaient eux-mêmes devenir des bibliothécaires). Seule une petite minorité de répondants avait un mauvais souvenir de l’accueil en bibliothèques, le décrivant comme « froid », « peu sympathique », « trop scolaire » ou encore ressemblant à « une corvée ». Pour le reste – et à l’image de cet étudiant guinéen à Genève de 24 ans qui décrit l’accueil dans les établissements comme « génial » –, la grande majorité des personnes interrogées ne critique pas l’accueil de la part des professionnels. Le problème est donc ailleurs.
Les raisons pour ne pas ou plus fréquenter les bibliothèques municipales qui sont le plus souvent invoquées par les non- (ou ex-) usagers sont le manque de temps, la pratique d’autres activités (le sport a plusieurs fois été mentionné), mais aussi le fait d’avoir terminé sa formation et de ne plus avoir besoin de s’y rendre, le manque d’intérêt pour la lecture mais aussi très souvent, on y reviendra, le fait de préférer posséder les livres. A noter que la question du « temps » possède deux dimensions : outre celui qui manque aux personnes, il renvoie aussi au problème, souvent relevé par les répondants, des horaires des bibliothèques, qui peuvent se superposer avec les horaires de travail des personnes, rendant matériellement difficile pour ces dernières le fait de se rendre en bibliothèque.
Un certain nombre de non-usagers font référence plutôt aux bibliothèques elles-mêmes pour justifier leur non fréquentation – on y reviendra quand il s’agira de l’image des établissements : on les trouve trop silencieux, fermés, ou dotés d’une classification des livres trop difficile à comprendre. L’éloignement du domicile est aussi évoqué, de manière intéressante par les extrêmes en termes d’âge: les personnes âgées, souvent à mobilité réduite, et les plus jeunes, qui voudraient pouvoir commander ou, au moins, choisir les ouvrages depuis chez eux, par Internet. L’argument d’un possible manque d’hygiène de livres en circulation permanente n’a été entendu qu’une fois au cours de l’enquête.
Mais en définitive, c’est en général un ensemble de facteurs, lié à un style de vie, aux habitudes de tous les jours, qui fait que l’on arrête de fréquenter les bibliothèques. Comme écrit un des groupes d’étudiants, « la plupart des personnes qui ne vont plus en bibliothèque municipale ont eu un changement dans leur vie qui fait qu’elles n’ont soit plus le temps de s’y rendre, soit qu’elles préfèrent avoir leur propre collection de livres ». Ce « changement » est, souvent, l’entrée dans la vie professionnelle : un certain nombre de répondants ont d’ailleurs explicitement renvoyé au fait qu’ils n’avaient « plus besoin » d’aller en bibliothèque, parce qu’ils ne sont plus en formation et/ou parce qu’à présent, ils disposent de moyens suffisants pour s’acheter des livres.
Un point mérite d’être relevé ici : le manque de livres dans sa langue est également souvent évoqué, par définition principalement par les personnes de nationalité étrangère mais qui représentent, on l’a dit, une proportion importante de la population, jusqu’à être majoritaire dans certains quartiers. Ici, le problème de « Culture » souvent relevé concernant les bibliothèques – au sens de la culture légitime ou classique qu’elles représentent – se cumule avec un problème de « culture », au sens anthropologique du terme cette fois : le fait qu’une partie de la population ne parle pas (encore), ou pas assez bien, la langue de la grande majorité du fonds des bibliothèques, constitue sans nul doute l’un des grands défis qui se pose aux bibliothèques, à une époque où les migrations et le brassage des populations ne cessent d’augmenter.
Autre élément important, le degré de notoriété des bibliothèques municipales genevoises et de leur emplacement. En règle générale, environ la moitié des non-usagers interrogés par les différents groupes ne savent pas qu’il y a une bibliothèque municipale dans leur quartier ; l’autre moitié en connaît le nom, mais pas toujours l’emplacement. De fait, passé la Bibliothèque de la Cité, la plus grande et la plus centrale, assez largement connue, les bibliothèques municipales genevoises ne sont pas très familières de la population et/ou ne sont pas identifiées comme telles (on peut citer le cas, étonnant, de cet écrivain et député local interrogé qui, habitant la Jonction, ne savait vraisemblablement pas que s’y trouvait une bibliothèque, et ne peut que citer l’« établissement de la Madeleine » comme bibliothèque municipale). C’est davantage le cas dans certains quartiers : ainsi, à Vieusseux, sur les vingt personnes interrogées, aucune ne connaissait la discothèque du quartier, sauf une qui en avait entendu parler mais qui n’en connaissait pas l’emplacement. Cela dépend aussi du type d’établissement : une bibliothèque spécialisée comme celle des sports, qui est de plus excentrée, est quasi inconnue: seule une personne sur les dix interrogées dans ce secteur en avait entendu parler ! Cette dernière est d’ailleurs quasi introuvable aussi : le chemin pour atteindre cet établissement, situé au milieu d’un parc somptueux, n’est, semblerait-il, signalé par aucun panneau (si bien que l’une des personnes croisées par les étudiants dans le parc cherchait la Bibliothèque des sports depuis plus d’une heure, en vain !). Le problème semble toutefois général : les étudiants ont eux-mêmes souvent constaté la situation cachée et/ou mal signalée de certains établissements (comme à la Servette, où la bibliothèque est, selon leurs témoignages, un peu en retrait, dans un bâtiment discret et à peine signalé ; la Discothèque de Vieusseux, non signalée et avec une entrée peu claire, serait presque introuvable ; la Bibliothèque des Pâquis est difficile à identifier car proche d’un bâtiment scolaire, avec lequel elle se confond ; de fait, même la Bibliothèque de la Cité, invisible depuis les rues commerçantes, est difficile à trouver pour un néophyte). D’autres bâtiments sont visibles mais souffrent d’un entretien négligé (c’est le cas de la Bibliothèque des Minoteries, dont l’extérieur défraîchi ne semble correspondre en rien à l’intérieur). Quant au bibliobus, il semblerait qu’il soit – peut-être aussi par sa localisation et ses horaires variables – très peu connu: par exemple, à Champel, seule une personne sur quinze savait que le quartier est desservi par ce bus. Bref, en termes de signalisation et de visibilité – au sens tout à fait premier du terme – des bibliothèques municipales, il y aurait sans doute, déjà, des choses à faire ; ou, comme conclu un groupe d’étudiants : « il est temps que les bibliothèques municipales se fassent connaître ! ».
Notons enfin aussi dans ce contexte que l’offre des bibliothèques est souvent mal connue des non-usagers de ces établissements. Si certains non-usagers pensent que les bibliothèques ne renferment que des ouvrages documentaires, pour ce qui est des livres, la multiplicité des titres disponibles et des domaines représentés semble grosso modo connue (comme de cette étudiante en ostéopathie, qui décrit le contenu d’une bibliothèque comme suit : « encyclopédies, romans, autobiographies, médecine, histoire, biologie, manuels, philosophie, poésie, etc. »). Mais souvent, on en reste aux livres, les services plus récents – disques, DVD, Internet – étant souvent mal, voire pas du tout connus (notamment dans certains quartiers ; ainsi, sur la vingtaine de personnes interrogées à Vieusseux, seules quatre connaissaient l’offre audiovisuelle des bibliothèques municipales). A noter aussi que le concept même de « discothèque » était inconnu d’une partie des répondants. Pourtant, les personnes interrogées utilisent la plupart de ces supports à domicile, certes moins pour les plus âgéees ; comme le dit ce groupe d’étudiants, « on remarque que les gens utilisent beaucoup les moyens de culture mis à leur disposition mais ne savent pas forcément que tous ces documents sont dorénavant disponibles dans la plupart des bibliothèques ».
Parmi les grandes tendances qui se dégagent des résultats, il y a la question des représentations des non-usagers en matière de bibliothèques. Tout d’abord la fonction des bibliothèques en général ; elle est le plus souvent décrite comme fondamentale, centrale : les bibliothèques sont là pour rendre la culture ou le savoir accessibles à tous (on parle également d’instruire ; quelqu’un a même dit « cultiver les gens »), et ce gratuitement ou à moindre frais, et donc indépendamment du niveau social des individus. Avec quelques belles images ou slogans à la clé : la bibliothèque a pu être appelée une « fontaine de connaissances » ; quelqu’un d’autre la décrit tout entière comme « un ouvrage de référence » ; de manière plus ambivalente, un répondant a parlé d’un « musée du livre », renvoyant certes à quelque chose de précieux, mais aussi de figé, de passé, voire d’inaccessible. L’aspect « historique » ou de conservation est par ailleurs également mentionné par certains. Une fonction élargie est évoquée quand il est question pour la bibliothèque d’« offrir des loisirs » voire du « divertissement ». Parfois, c’est à un rôle civilisateur plus général que l’on pense : la bibliothèque est alors décrite comme un lieu sans violence, qui vient en aide aux personnes.
La fonction sociale ou de sociabilité de ces établissements est également perçue par certains non-usagers : quand il s’agit de décrire les avantages des bibliothèques, elles sont décrites comme « espace de rencontres ». Le calme, propice au travail et à l’étude, voire simplement le fait d’avoir un moment pour soi, sont également relevés comme positifs ; comme aussi le fait de trouver les livres qui ne sont plus dans le commerce, de pouvoir feuilleter un livre avant de l’acheter en magasin, ou encore tout simplement de « trouver tous les livres qu’on veut » (quelqu’un a dit : « livres pour chacun, culture pour tous »). Un endroit plein d’avantages en somme : un répondant pense même qu’« il n’y a pas de désavantages, et c’est ça l’avantage ». A noter que parmi les personnes interrogées, les personnes de nationalité étrangère avaient souvent une meilleure image, une plus haute estime des bibliothèques que les Suisses.
Car un certain nombre de désavantages des bibliothèques sont également relevés par les répondants, qui ne sont souvent d’ailleurs que le pendant des avantages cités – ce qui rend bien sûr la tâche difficile pour toute personne qui voudrait les éliminer ! Outre les délais, les contraintes, l’attente à l’accueil ou le fait de devoir se déplacer, on critique – alors que le côté historique est relevé comme important – le fait que les nouveautés et/ou les best-sellers ne soient pas disponibles, ainsi que le choix restreint ou alors parfois à l’inverse le manque de livres dans un domaine très pointu. L’ambiance studieuse, silencieuse dérange certains – par exemple cet employé de commerce, qui dit : « les bibliothèques, c’est ‘mort’ pour moi » (quelqu’un d’autre parle d’une « ambiance de vieux ») ; on estime qu’il y a trop peu de monde, un manque d’animation, ou à l’inverse qu’il y aurait parfois foule. On se réjouit de la gratuité mais quelqu’un a fustigé les coûts des bibliothèques pour la collectivité. Si l’offre abondante a été louée, la classification et la difficulté à la comprendre sont plusieurs fois évoquées comme désavantages. Très souvent, on y reviendra, c’est l’impossibilité de garder les livres qui est regrettée.
Le premier mot qui vient à l’esprit des non-usagers en pensant aux bibliothèques reflète les aspects – ceux positifs comme ceux négatifs – évoqués : la grande majorité des personnes pense, bien sûr, à « livre » (mais nous interrogerons ce lien qui semble naturel dans la suite de cette contribution), parfois aussi à « lire », « lecture », ou encore à « bouquin » (une personne a pensé à « journaux »). Mais les répondants renvoient aussi à « silence », « renfermement », « institution », voire « vieillot », « pénible », « obligation », « chercher », « rapporter » ; un retraité, ancien gestionnaire de banques, pense d’emblée aux quatre mots suivants en songeant aux bibliothèques : « obligations, délais, chercher, rapporter » ! On pense enfin également à des mots tels que « connaissance », « savoir », « recherche », « culture » ou encore « histoire ».
Un autre élément important ici est la question de l’image des bibliothécaires auprès des non-usagers. Cette image s’avère « mitigée », selon le mot de l’un des groupes d’étudiants. Assez étonnamment si l’on songe au fait qu’il s’agit de personnes qui ne fréquentent pas, présentement, de bibliothèques, la grande majorité des enquêtés produit sans difficultés une image des bibliothécaires, sans doute un doux mélange de souvenirs d’enfance et de stéréotypes véhiculés par les films (cf. Chaintreau et Lemaître, 1993). L’image de la profession – ou des personnes qui l’exercent – qui se dégage des réponses oscille, comme peut-être le livre lui-même (qualifié par un enquêté de « loisir rigide »), du plus positif au plus négatif. Premier constat : dans la quasi totalité des cas, c’est sous les traits d’une femme qu’on imagine un – ou en l’occurrence une – bibliothécaire ; comme s’étonne ce groupe d’étudiants : « à entendre les gens, on a l’impression qu’il n’y a que des femmes dans le domaine bibliothécaire ». D’une certaine manière, tant la bonne que la mauvaise image dont jouissent les bibliothécaires est alors liée aux ambivalences des caractéristiques associées à la femme en général. Les qualificatifs positifs ne manquent pourtant pas : les bibliothécaires sont sérieuses, cultivées, avides de savoir, intellectuelles, lisent beaucoup et inspirent le respect ; elles sont sympathiques ou, du moins, attentives, serviables, disponibles ; elles ont également été décrites comme « modernes », « jolies filles »... Ne craignant pas les clichés, certains ont aussi parlé de « rats de bibliothèques », voire de « petites souris méticuleuses et méthodiques ». Les bibliothécaires sont « des personnes à la fois passionnantes et passionnées », estime quant à elle une enquêtée.
Mais, parmi les non-usagers interrogés, ce sont bien les qualificatifs négatifs qui prévalent. Dans les portraits, on ne compte pas les adjectifs tels que « sévère », « austère », « stricte », « vieux et poussiéreux », et des expressions telles que « vieilles femmes à lunettes », « femmes âgées, maigres et avec chignon très serré » (le chignon et les lunettes étant des éléments récurrents dans cette imagerie), ou encore « vieilles filles à tendance religieuse » voire « frileuses, cul-serré, enveloppées dans de grosses jaquettes »… A en croire les répondants, les bibliothécaires seraient toutes des « psychotiques du rangement », des « femmes n’ayant rien réussi dans leur vie », « frustrées par la vraie vie » qui « sont trop dans leurs livres » ! Des enquêtés ont raconté leur sentiment d’être en permanence surveillés par les bibliothécaires, certains disent même pour toute réponse : « chut ! ». Bref, on ne peut que suivre cette répondante qui, conseillère en image de profession, pense que les bibliothécaires souffrent d’« une image un peu vieillotte qu’il faudrait dynamiser ».
Un autre grand thème qui se dégage des résultats est le rapport à la lecture. On constate tout d’abord qu’une grande partie des non-usagers lit, même si les livres lus sont souvent peu nombreux et le sont prioritairement pour le travail. De fait, rares sont ceux qui admettent ouvertement ne pas lire, ou ne pas aimer le faire – comme cette jeune étudiante interrogée, qui déclare haut et fort : « lire, ça m’gave ! ». Dans la grande majorité des cas, ne pas aller en bibliothèque ne veut nullement dire ne pas lire : comme l’ont constaté les étudiants, « malgré le fait que les gens lisent beaucoup, cela ne fait pourtant pas d’eux de grands utilisateurs de bibliothèques municipales ». En majorité, les personnes qui lisent achètent leurs livres ; certains pratiquent l’échange en famille, vont au marché aux puces voire, plus rarement, les récupèrent dans la rue. La grande majorité des personnes trouve en effet – même quand elles ne lisent pas – qu’il est important de posséder ses livres. Posséder un livre donne une certaine liberté : on peut le relire, s’y replonger quand on veut (« quand on possède un livre on peut le lire pendant 100 ans et on n’est pas limité dans le temps comme c’est le cas lorsqu’on l’emprunte à la bibliothèque », a dit quelqu’un) ; on peut aussi le prêter, l’user, écrire dedans ; on l’a toujours à disposition : c’est, dans les mots des étudiants, un peu « le savoir à portée de main ».
Un grand nombre de réponses renvoient moins à la lecture qu’au rapport au livre comme objet, qui semble plus important pour les personnes que ce que l’on pouvait imaginer. Certains enquêtés évoquent l’importance des livres comme une sorte de culture accumulée : un répondant a désigné les ouvrages chez soi comme de la « culture indestructible », quelqu’un d’autre parle de « pérennité », on parle de se constituer un « patrimoine » ; les étudiants ont même rencontré quelqu’un qui, affirmant posséder près de 5'000 ouvrages à son domicile, pourrait presque prétendre rivaliser avec une petite bibliothèque publique ! Un groupe d’étudiants a rencontré une personne qu’ils qualifient de « bibliophile » puisqu’elle « aime simplement posséder des livres », d’autres enquêtés évoquant l’importance de pouvoir avoir chez soi les livres que l’on a aimés. Certains parlent de « l’attachement » aux livres (« on s’y attache », dit un retraité) et de la « relation particulière » qu’ils entretiennent à l’objet « livre » – ce qu’un groupe d’étudiants a appelé un « instinct de thésaurisation » (une enquêtée parle d’ailleurs de ses « trésors » en parlant de ses livres ; une autre dit : « j’aime avoir mes livres dans une armoire mais pas les lire »). Nombreux sont par ailleurs les témoignages qui évoquent l’importance de posséder des livres chez soi pour « décorer son appartement », « impressionner ses invités » ou, simplement, pour « faire joli ». Cet attachement au livre comme objet – que l’on aime et/ou que l’on montre – constitue bien sûr un véritable casse-tête pour les bibliothèques, lieu où la possession des ouvrages est par définition impossible, ou seulement éphémère.
Enfin, une dernière question à laquelle on a cherché à répondre est celle de l’offre qu’une bibliothèque devrait proposer aux yeux des non-usagers, et qui pourrait, peut-être, les faire (re-)venir dans ces établissements. Comme le remarquent des étudiants : « les non-usagers, loin de se désintéresser du sort des bibliothèques, expriment de nombreuses suggestions ou propositions » ; seule une minorité des répondants n’a rien su ou voulu répondre à cette question. Les propositions faites – elles sont de fait souvent déjà réalisées dans les établissements – concernaient, en vrac :
- davantage de nouveautés, un fonds plus complet, une offre plus large (presse, nouveautés, supports électroniques, livres d’images ont été cités), ou encore plus de journaux ; certains souhaitaient plus de livres en langue étrangère ;
- la possibilité de livraison à domicile, de commander à distance (« que la bibliothèque vienne à moi »), ou au moins la possibilité d’effectuer des recherches à la maison, sur l’Internet (surtout de la part des jeunes) ;
- des horaires plus flexibles, notamment une ouverture à midi, plus de souplesse concernant les délais de retour, une classification plus facile à comprendre (ces points sont des classiques) ;
- concernant l’accueil : plus de convivialité, donner davantage envie d’y entrer et d’y rester, être moins austère, proposer un lieu plus vivant, une décoration plus joyeuse, plus de disponibilité du personnel pour aider dans les recherches ;
- un coin café, un coin café-lecture, voire un « bistrot-bibliothèque » où l’on pourrait « boire un verre et échanger ses impressions sur les livres » (demandé aussi par des personnes âgées), ou au moins une machine à café, un distributeur, mais aussi un coin canapé, voire un coin fumeur (plusieurs personnes ont évoqué le fait qu’ils aiment fumer en lisant) et un cybercafé (ou encore un tea-room) ont été demandés ;
- certains désirent des salles où l’on peut parler à haute voix, d’autres une « ambiance feutrée » ;
- on souhaite des expositions plus variées, des petites expositions en relation avec le livre ; des débats, des lectures, par exemple par des personnalités ; des invitations d’auteurs ; des journées à thème, ou alors des nocturnes ; voire de la musique, des concerts ou encore des films (notamment des films tirés de romans – le cinéma, dont on a vu qu’il est en partie responsable de l’image stéréotypée dont souffrent les bibliothécaires, pourrait donc s’avérer une passerelle précieuse vers les bibliothèques) ;
- la possibilité d’acheter sur place les livres qui ont plu ;
- une garderie, un « coin où l’on peut parquer les enfants et choisir tranquillement » ;
- des jeux vidéo (notamment pour attirer les jeunes) ;
- une affiliation gratuite ;
- mieux cibler le public ;
- d’une manière générale, prendre plus en compte les besoins des usagers ;
- certains ont parlé de la visibilité, qui est à améliorer ; faire de la publicité, notamment dans les écoles, mais aussi plus largement.
Reste à savoir jusqu’à quel point les bibliothèques municipales seraient d’accord de s’ouvrir, d’intégrer les desiderata des (non-)usagers, sans avoir l’impression de se dénaturer ou de faillir à leurs missions, qui font toutefois sans cesse l’objet de redéfinitions et, partant, d’extensions. A noter aussi qu’une partie de ces propositions (nouveautés, presse, supports électroniques, expositions, invitations d’auteurs, nocturnes...) concerne des éléments qui font, déjà aujourd’hui, partie de l’offre des bibliothèques – ce qui renvoie du même coup à un problème d’information et de communication manifeste. En tous les cas, quelle que soit la solution choisie, les étudiants ont sans doute raison en disant que « les bibliothèques ont un bel avenir devant elles à condition qu’elles sachent s’adapter et rester à l’écoute ».
L’analyse du non-public des bibliothèques s’avère intéressante, et ce à au moins deux égards. Tout d’abord, elle est une manière de mieux comprendre son double étudié d’habitude, à savoir le public des bibliothèques ; ou, comme l’a récemment dit un auteur dans un des rares textes qui porte, précisément, sur les non-usagers de bibliothèques : « la fréquentation ne se comprend que par l’analyse de la non fréquentation » (Poissenot, 2003). Ensuite et surtout, elle seule permet de mieux comprendre les logiques de la non-fréquentation des bibliothèques municipales et, par là, d’esquisser des voies pour que les non- et les ex-usagers (re-)deviennent des usagers de ces établissements.
Sur le plan macrosociologique et statistique, les raisons pour lesquelles certains groupes de la population ont moins de chances de fréquenter des établissements tels que des bibliothèques sont connues. On a déjà évoqué l’importance du profil sociodémographique. Il est également établi que les habitudes de lecture ont une influence sur le fait de se rendre ou non dans ces établissements ; récemment, lors d’une controverse qui a animé la recherche sur les publics des bibliothèques, l’importance également du niveau de diplôme – et, à travers lui, de la ressemblance ou, souvent, dissemblance entre les non-usagers et le personnel des bibliothèques – a été relevée, amenant une touche supplémentaire au tableau (11).
Le but de cette brève étude, menée dans un cadre pédagogique, n’était pas – ne pouvait pas être – de confirmer ou contredire ces résultats, ne serait-ce parce qu’elle s’en distinguait d’emblée de par sa méthode. Celle-ci a été décrite comme à la fois qualitative et compréhensive, attachée à appréhender les pratiques et, surtout, les représentations en matière de bibliothèque du dedans, du point de vue de ses non-usagers. Dans cette cartographie mentale des personnes qui ne fréquentent pas les bibliothèques municipales, ce qui semble avoir été révélé par la démarche entreprise ici, c’est un problème d’image – ou, plutôt, d’images, au pluriel – qu’ont les bibliothèques aujourd’hui pour une grande partie de la population.
Tout d’abord, image au sens premier du terme. Les bibliothèques municipales sont mal connues : leurs noms, leurs emplacements restent obscurs pour une part non négligeable des personnes. L’enquête a montré que la localisation des établissements, la signalétique et, parfois, l’image donnée par les bâtiments eux-mêmes, peut poser problème. Mais c’est aussi plus généralement l’identité des établissements et leur inscription dans un réseau comptant, à Genève, plus d’une dizaine d’unités, qui n’est que peu, voire tout simplement pas perçue pas les non-usagers. Il y aurait là peut-être une réflexion et, partant, un effort à faire pour renforcer, voire créer une identité collective, un « label », une ligne graphique commune. Celle-ci serait, pour les non-usagers comme d’ailleurs pour les usagers, aussi une garantie de trouver un certain standard et un certain nombre de services au sein des établissements ainsi désignés (au delà de la spécificité locale de chaque succursale, qui reste sans doute un atout précieux), voire, à terme, de pouvoir profiter d’une fluidité des supports entre les établissements, une possibilité qui ne pourrait qu’être perçue comme un avantage à l’ère de la mise en réseau généralisée.
Image ensuite au sens des représentations qui structurent l’imaginaire des personnes autour des bibliothèques : il est apparu que ces dernières s’inscrivent, pour les non-usagers, dans ce que l’on pourrait appeler une chaîne de significations qui, trop souvent, éloigne ces établissements de leur pratiques et envies de tous les jours. Les résultats l’ont montré, les bibliothèques municipales ont une série d’« ennemis symboliques » qu’il s’agirait de combattre si l’on veut augmenter le nombre d’usagers de ces établissements (cf. Tableau ci-dessous). Le fait même que les livres soient – selon l’étymologie du mot bibliothèque – réunis en un « coffre », donc en un seul lieu, et les déplacements ainsi que la confrontation avec d’autres personnes (attente, etc.) que cela occasionne, est souvent relevé comme négatif par les non-usagers ; c’est l’une des raisons pour lesquelles on n’a pas le temps – un autre adversaire redoutable des bibliothèques, semblerait-il – de fréquenter ces établissements. Le silence, le côté studieux et (supposément) austère du lieu ont également été mentionnés par les non-usagers, comme aussi les contraintes imposées par le prêt. Un autre de ces ennemis symboliques semblent être les bibliothécaires eux- ou elles-mêmes : généralement représentées sous les traits d’une femme aigrie avec des lunettes et un chignon, la bibliothécaire semble pour beaucoup réunir certains des traits les plus « posés » que les stéréotypes courants attribuent aux femmes (tendance au rangement et à l’ordre, application stricte des règles, circularité et répétitivité, etc.) qui, du coup, entrent en collision avec les composantes plus « débridées » que l’on se plaît à accorder à ces mêmes femmes (imagination, irrationalité, irrégularité, beauté, etc.) et qui feraient tache – aux yeux des non-usagers – dans l’univers des bibliothèques.
Un autre obstacle majeur est, de manière étonnante, le livre lui-même, du moins en tant qu’objet : l’enquête a démontré l’importance pour les personnes – même, voire surtout, quand elles ne lisent pas ou peu – de posséder un livre, de pouvoir le montrer, ou simplement le conserver chez soi. Les bibliothèques en tant que lieu où, par essence, il est impossible de posséder un ouvrage, posent alors problème. Ici, on peut se demander s’il ne vaudrait pas la peine de tenter une redéfinition de la bibliothèque : d’un lieu de livres, elle deviendrait ce qu’elle est avant tout, à savoir un lieu de lecture, qui facilite le fait de lire – bien plus que d’avoir – des livres. L’envie de posséder des livres – sans doute encouragée aussi par des impératifs consuméristes – est répandue à un point que l’on peut d’autre part se demander si une connexion, une collaboration ponctuelle entre ces mondes à la fois si distants et si proches des bibliothèques et des librairies ne devrait pas être tentée. Le fait de pouvoir prendre connaissance d’un livre avant de l’acheter – l’absence de l’obligation d’achat – a été relevé comme avantage de la bibliothèque ; on pourrait imaginer un système de recherche et de renvoi qui permettrait ensuite à chaque personne qui a aimé un ouvrage emprunté en bibliothèque de le retrouver facilement chez un libraire et de l’acheter.
Enfin, c’est plus généralement la « Culture » elle-même, avec un grand « C », qui est apparue comme un ennemi potentiel des bibliothèques : sa force (et, peut-être, son essence) de « distinction » (Bourdieu, 1979) valorise bien sûr ces lieux de savoir et d’histoire que sont les bibliothèques, mais les affaiblit aussi, dans le sens que, « musées du livre » (comme exprimé de manière révélatrice par un répondant), ils paraissent aussi nécessaires que finalement inutiles ou, du moins, inutilisés – voire inutilisables – aux yeux d’une trop grande part de la population. A en croire certaines publications récentes, les bibliothèques ont tout à gagner à déplacer leur centre d’activité de la culture classique et essentiellement livresque à la diffusion et à l’échange de l’information en général : d’un « coffre à livres », la bibliothèque deviendrait alors plus généralement un dispositif de redistribution, voire de transformation, des savoirs inscrits (Bazin, 2000).
En bibliothèque, certaines améliorations peuvent sans doute être entreprises par des mesures spécifiques relativement simples : les horaires, les règles régissant le prêt et les amendes, les formalités d’inscription, les tarifs, la classification et sa présentation ou explication, enfin l’accueil et l’attente en bibliothèque, tous ces aspects doivent probablement faire l’objet d’une réflexion et de quelques ajustements. Mais c’est plus profondément d’une transformation de leur image, au sens fort du terme, qu’ont besoin les bibliothèques. Actuellement, rien n’oblige les non-usagers de fréquenter les bibliothèques et de s’y approvisionner en livres ; du moins le pensent-ils. L’enjeu est donc de les convaincre du contraire, autrement dit : de convertir les « ennemis symboliques » évoqués en « alliés » : autrement dit, de persuader les non-usagers que les désavantages rattachés aux bibliothèques peuvent, précisément, constituer des avantages (cf. Tableau) (12).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La nécessité de se déplacer et d’être confronté à d’autres usagers deviendrait ainsi une possibilité d’échange, de sociabilité ; le temps que ça prend et que l’on perd, du temps que l’on se prend, que l’on a pour soi, que l’on gagne ; le silence, du calme ; les contraintes de l’institution, des règles claires, prévisibles et, par là, rassurantes ; les bibliothécaires « aigries et renfermées », du personnel accueillant et sympathique ; le fait de ne plus devoir être en formation et d’aller en bibliothèque, la possibilité de pouvoir à nouveau apprendre ; la gratuité et l’impossibilité d’acheter, la possibilité de ne pas acheter, le privilège de ne pas devoir le faire ; enfin, la possession d’un ouvrage, sa lecture et donc l’appropriation de son contenu plutôt que du livre comme objet.
Au final, c’est toute la relation à la culture qui est mis en branle dans l’usage et le non-usage des bibliothèques municipales. De par la multiplicité à la fois des supports qu’elle recèle et des domaines qu’elle recouvre, la bibliothèque pourrait être le lieu d’une redéfinition de ce rapport à la « culture », non plus seulement au sens étroit de culture légitime (Grignon et Passeron, 1989), mais plus large de loisirs et de pratiques culturelles, voire au sens plus anthropologique d’identité sociale et d’appartenance à un groupe. De « musées du livre », les bibliothèques deviendraient alors en quelque sorte des laboratoires où s’expérimentent des nouveaux liens au savoir et, partant, à la société. Les propositions d’amélioration faites par les non-usagers de bibliothèques à Genève, qui peuvent parfois sembler naïves ou farfelues, sont probablement à prendre dans ce sens : comme des incitations à (re-)mettre les bibliothèques au centre de la Cité et de la vie de ses habitants. Si cette étude peut contribuer un tant soit peu à proposer des pistes dans cette direction, elle aura atteint l’un de ses buts les plus chers.
Notes
(1) Informations tirées de la brochure Bibliothèques et discothèques municipales de la Ville de Genève (Cellule étude et projets, 2006). Dans cet article, les mots se référant à des personnes ne sont pas féminisés mais se réfèrent aux hommes et aux femmes.
(2) Enquête sur les pratiques culturelles dans le canton de Genève, sondage mené par MIS Trend, Lausanne, en juin-juillet 2004, sur 800 personnes de 15 à 74 ans dans le Canton de Genève. Selon le graphique 6, 47% de l’échantillon n’a jamais fréquenté une « bibliothèque » (au sens général n.b.) dans les douze mois.
(3) Une Charte d’accueil, qui a d’abord été diffusée d’abord à l’interne (fin 2006), et qui le sera auprès du large public (en 2008), en constitue l’aboutissement le plus visible.
(4) A noter que, portant sur l’ensemble du pays avec les zones rurales, le chiffre de fréquentation français est logiquement moins élevé que celui de l’agglomération genevoise. Pour Paris intra-muros, la part de public récent des bibliothèques se monte par contre à 49%.
(5) La même remarque peut être faite pour le cas de Genève : en recoupant les chiffres cités en introduction, avec un public récent des bibliothèques (certes toutes catégories confondues) de 47% et seulement 50'000 effectivement individus inscrits sur une population de plus de 300'000 habitants, la part d’usagers non-inscrits doit être importante.
(6) Les quartiers et établissements genevois couverts par l’enquête de terrain étaient les suivants : autour des bibliothèques de la Cité, des Eaux-Vives, de la Jonction, du Pâquis, de la Servette, de Saint-Jean, de la bibliothèque et discothèque des Minoteries, de la discothèque Vieusseux, de la Bibliothèque des Sports, du Bibliobus (Plan-les-Ouates et Grand-Saconnex), enfin à Champel-Florissant (quartier sans bibliothèque).
(7) Afin d’éviter l’« effet de l’enquêteur » bien connu des sociologues, les étudiants avaient reçu l’indication de ne pas préciser au départ la nature exacte de leur formation (le fait qu’ils sont de futurs bibliothécaires, ce qui aurait sans aucun doute dirigé les réponses dans un sens non voulu).
(8) Pour des questions juridiques et pratiques, il a été décidé de ne pas interroger de personnes de moins de 15 ans et notamment des enfants ; on a préféré thématiser la question des enfants dans le questionnaire adressé aux adultes ou jeunes adultes.
(9) Si les touristes et autres personnes de passage en Suisse ont été exclues pour des raisons évidentes, les frontaliers ont par contre été inclus, puisque la possibilité existe pour ces derniers d’emprunter – via une démarche à effectuer auprès de la bibliothèque de leur lieu d’habitation – des livres à Genève.
(10) Les portraits contenus dans un ouvrage récent de Bernard Lahire sur les pratiques culturelles, quoique bien plus longs, nous ont servi de modèle (Lahire 2004).
(11) Voir Poissenot, 2001, ainsi que les réactions et la réponse de Poissenot in BFF, 2002, t. 47, n. 1.
(12) L’idée d’explorer les « alliances » - en l’occurrence symboliques – des bibliothèques est inspirée de la « sociologie de la traduction » développée par Bruno Latour ou Michel Callon (voir de manière emblématique dans Callon, 1986).
Bibliographie
Ancel, P. et Pessin A. (2004). Les non-publics. Les arts en réceptions. Paris, L’Harmattan.
Bazin P. (2000). « Bibliothèque publique et savoir partagé ». In BBF, t. 45, n. 5, pp. 48-52.
Bertrand A.-M., Burgos M., Poissenot Cl. et Privat J.-M. (2001). Les bibliothèques municipales et leurs publics. Pratiques ordinaires de la culture. Paris, Bpi / Centre Pompidou.
Bourdieu P. (1979). La Distinction. Critique sociale du jugement. Paris, Ed. de Minuit.
Callon M. (1986). « Eléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins pêcheurs de la baie de Saint-Brieux ». In L’Année sociologique, n. 36, pp. 170-208.
Cellule étude et projets (2006). Bibliothèques et discothèques municipales de la Ville de Genève. Genève, Département des affaires culturelles, Ville de Genève.
Chaintreau A.-M. et Lemaître R. (1993). Drôles de bibliothèques. Le thème de la bibliothèque dans la littérature et le cinéma. Paris, Ed. du cercle de la librairie.
Donnat O. (1994). Les Français face à la culture. De l'exclusion à l'éclectisme. Paris, La Découverte.
Donnat O. (1998). Les pratiques culturelles des Français. Enquête 1997. Paris, La Documentation française.
Grignon Cl. et Passeron J.-Cl. (1989). Le savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature. Paris, Gallimard / Le Seuil.
Lahire B. (2004). La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi. Paris, La Découverte.
Maresca B. (2006). « La fréquentation des bibliothèques publiques a doublé depuis 1989 ». In CREDOC Consommation et modes de vie, n. 193, mai.
MIS Trend (2004). Enquête sur les pratiques culturelles dans le canton de Genève. Lausanne.
Poissenot Cl. (2001). « Penser le public des bibliothèques sans la lecture ? ». In BFF, t. 46, n. 5, pp. 4-12.
Poissenot Cl. (2002). « Le réel et ses analyses ». In BBF, t. 47, n. 1, pp. 19-20.
Poissenot Cl. (2003). « Non-publics des bibliothèques et missions des BDP : réflexions à partir du cas de la Meuse ». Journées d’étude de l’ADBDP Association des directeurs de bibliothèques départementales de prêt (www.adbdp.asso.fr/association/je2003/poissenot.htm).
| Nom de l'étudiant-e : | Date : | Quartier : |
QUESTIONNAIRE NON USAGERS BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES A GENEVE
Bonjour, je suis un-e étudiant-e de la Haute école de gestion, à Genève. Nous menons actuellement une enquête auprès de la population genevoise. Une question : avez-vous fréquenté, ces 12 derniers mois, une BM à Genève ? Si OUI, alors REMERCIER, PAS D’ENQUETE ! Si NON : Auriez-vous une dizaine de minutes à me consacrer ?
Etes-vous inscrit-e dans une BM à Genève ? Non Oui :
Quel est le 1er mot qui vous vient à l’esprit en pensant à une bibliothèque ?
Avez-vous fréquenté une des BM genevoises par le passé ?
| Si oui : Pour quelle(s) raison(s) ne fréquentez-vous plus de BM ? (depuis quand ; événement précis ?)
Comment était l’accueil de la part des bibliothécaires ? Si non : Vous n’avez jamais fréquenté de BM à Genève. Pour quelle(s) raison(s), qu’est-ce qui vous en empêche ? |
Fréquentez-vous une bibliothèque publique dans une autre ville ? Non Oui
Quelle(s) fonction(s) remplit d’après vous une bibliothèque dans une ville ?
D’une manière générale, quels sont les avantages et les désavantages d’une bibliothèque, pour vous ?
Av. :
Désav. :
A votre avis, que peut-on se procurer ou consulter dans une BM ?
Quelle image avez-vous des bibliothécaires ?
Et pourquoi ?
Saviez-vous que dans ce quartier, il y a une BM (ou discothèque) : (dire le nom) ?
Oui, connaît nom et localisation Connaît nom mais pas localisation Non, ni l'un ni l'autre
Pouvez-vous citer d’autres BM à Genève ?
A propos de vos habitudes de lecture. Lisez-vous des livres, quel que soit le genre et quelle que soit la raison pour laquelle vous les lisez ?
0 1-4 / an 5-9 / an 10-19 / an 20+ / an
Quelle proportion de ces livres lisez-vous dans le cadre de votre travail ?
tous la majorité moitié moitié une minorité aucun
Comment vous procurez-vous des livres (achat, échange…) ?
Le fait de posséder un livre est-il important pour vous ?
Et pourquoi ?
Que devrait proposer une bibliothèque, qu’est-ce qui pourrait faire que vous y alliez ?
Avez-vous des enfants de moins de 10 ans ?
Non Oui :
Vos enfants lisent-ils ou regardent-ils des livres ?
Non Oui :
Pourriez-vous vous imaginer leur chercher des livres en bibliothèque (si non, pourquoi) ?
Quelques questions sur vos loisirs.
Lisez-vous des journaux ou des magazines ? Non Oui
Regardez-vous chez vous des films sur k7 ou DVD ? Non Oui
Ecoutez-vous chez vous de la musique sur k7 ou CD ? Non Oui
Utilisez-vous chez vous des CD-ROMs (sur l’ordinateur) ? Non Oui
Avez-vous chez vous la possibilité de surfer sur Internet ? Non Oui
Pour terminer, quelques informations générales.
Age. Quelle est votre année de naissance ? Sexe (noter) : Non Oui
Formation. Quel est votre niveau de formation le plus élevé terminé ou en cours (év. équivalent) :
école oblig. CFC, maturité prof. gymnase école prof. sup. université, EPF, HES
Profession. Quelle est votre profession actuelle ?
Langue. Dans quelle(s) langue(s) lisez-vous d’habitude ?
Nationalité. Quelle est votre nationalité ?
Domicile. Dans quel quartier de Genève (ou : ville) habitez-vous ?
Présence dans quartier. Pour quelle(s) raison(s) venez-vous en général dans ce quartier ?
MERCI d’avoir participé à l’enquête ! Elle permettra d’améliorer l’offre des BM de Genève !
(Remarques)
Editorial n°5
Ressi — 29 mars 2007
Editorial n°5
Première livraison de l’année 2007, voici le numéro 5 de la Revue électronique suisse de science de l’information. Le fait même de pouvoir vous présenter ce cinquième numéro prouve que nous n’avons pas créé notre revue pour satisfaire à une mode ambiante mais bien parce qu’elle répond à un réel besoin de diffusion des travaux.
Dans la rubrique Etudes et recherches, Isabelle de Kaenel et Pablo Iriarte du Centre Hospitalier universitaire vaudois, nous proposent une étude de synthèse sur les nouveaux champs d’application possibles des catalogues et analysent les conditions de base pour obtenir un « Open catalog ». Les nouveaux usages et les nouveaux outils tendent à faire un rapprochement entre utilisateurs et catalogues en ligne et dans leur étude, les auteurs étudient les conditions qui font que l’on s’achemine vers un catalogue qui n’est plus un outil isolé du monde mais également une ouverture aux services web externes.
Dans les Compte-rendu d’expériences, Anne-Christine Robert, Tamara Morcillo et Michel Maillefer de l’Université de Genève, relatent une expérience de partenariat entre la Faculté de Médecine, la Faculté des Sciences et la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève. La collaboration a montré des problématiques de gestion similaires dans les trois institutions et les auteurs nous démontrent les avantages d’une démarche collective pour un appel d’offre de périodiques. Réjean Savard, de l’Université de Montréal nous fait part d’une expérience de pédagogie de projets menée par les étudiants de l’Ecole de bibliothéconomie et des sciences de l’information visant à comparer les bibliothèques publiques du Québec et celles de Suisse romande.
Sous la rubrique Evénements, Danielle Mincio, membre du Swiss Librarians for International Relations (SLIR) se pose la question de savoir en quoi le Sommet mondial sur la Société de l’information peut être utile au développement des bibliothèques ? Après les Conférences de Genève en 2003 et de Tunis en 2005, peut-on voir l’effet des recommandations sur les bibliothèques ? Ariane Rezzonico de la Haute école de gestion de Genève, nous donne un aperçu du 31ème Congrès Online Information 2006 qui s’est tenu à Londres en décembre dernier sur le thème : Se préparer à l’information 2.0. Congrès mondial avec environ 700 délégués de tous pays, cette manifestation est l’occasion d’observer les tendances dans le domaine de la gestion, du traitement et de la diffusion de l’information.
Claire Peltier, de la Haute école de gestion de Genève, nous propose une recension de l’ouvrage coordonné par Niklaus Butikofer relatant le colloque organisé par les Archives fédérales suisses en octobre 2004 à Berne, dans le cadre du projet ERPANET (Electronic Resource Preservation and Access Network).
Nous remercions tous les auteurs qui ont contribué à ce numéro.
Nos forces ne nous permettent pas actuellement une publication plus fréquente mais, dans un souci de donner plus de dynamisme à RESSI, Benigno Delgado, de la Haute école de gestion de Genève, vous propose une nouvelle maquette basée sur un « portail » de type CMS (Content Management System). Celle-ci permet une simplification de la gestion des articles soumis, possède des fonctionnalités de recherche et une plus forte interaction avec les lecteurs et avec l'actualité. Ce numéro apparaît donc en deux versions simultanément. La nouvelle mouture de notre revue, dont l’adresse provisoire est http://www.otracuba.org/ressi, est encore en construction et des améliorations aussi bien dans l’interface que dans la gestion seront effectuées. Nous souhaitons que le lecteur n’hésite pas à employer l’interactivité pour nous communiquer ses réactions, ses critiques et ses propositions.
Bonne lecture
La revue Ressi
- N° Spécial DLCM
- N°21 décembre 2020
- N°20 décembre 2019
- N°Spécial 100ans ID
- N°19 décembre 2018
- N°18 décembre 2017
- N°17 décembre 2016
- N°16 décembre 2015
- N°15 décembre 2014
- N°14 décembre 2013
- N°13 décembre 2012
- N°12 décembre 2011
- N°11 décembre 2010
- N°10 décembre 2009
- N°9 juillet 2009
- N°8 décembre 2008
- N°7 mai 2008
- N°6 octobre 2007
- N°5 mars 2007
- N°4 octobre 2006
- N°3 mars 2006
- N°2 juillet 2005
- N°1 janvier 2005
