Publiée une fois par année, la Revue électronique suisse de science de l'information (RESSI) a pour but principal le développement scientifique de cette discipline en Suisse.
Présentation de la revue
Contenu du site
Se connecter
Publié par Ressi
Demain sera mieux qu’aujourd’hui : évolution des rôles et missions du bibliothécaire
Ressi — 20 décembre 2018
Matthieu Cevey, Haute Ecole de Gestion, Geneve
Michel Gorin, Haute Ecole de Gestion, Geneve
Résumé
Cette contribution est le reflet d’une intervention faite par ses auteurs lors du Congrès des professionnels de l’information, organisé du 12 au 14 novembre 2018 à Montréal (http://congrescpi.com/programme-cpi/). Le thème du congrès était : « Les professionnel-le-s de l’information, actrices et acteurs de changement ».
Partant de la situation suisse actuelle, les auteurs font le constat des changements à venir dans le monde des bibliothèques publiques et de la nécessité d’adaptation des bibliothécaires, soutenus par les associations professionnelles et les institutions formatrices. En tirant un parallèle avec l’initiative « No Billag », ils font état de l’importance des bibliothèques en tant que garantes de la démocratie. Un modèle inédit de bibliothèque comme plateforme issu du travail de Bachelor de Michael Ravedoni est présenté comme solution possible en fin d’article.
Demain sera mieux qu’aujourd’hui : évolution des rôles et missions du bibliothécaire
Préambule
Que cela soit en Suisse ou dans le reste du monde, les habitudes des usagers évoluent, l’utilisation des bibliothèques n’est plus la même qu’il y a dix ans, et elle sera certainement différente dans le futur. A elles, par conséquent, de se réinventer, de s’adapter à de nouveaux usages, souvent très variés. Partant du concept de « modèle des quatre espaces » développé par nos collègues danois de l’Ecole royale de bibliothéconomie et des sciences de l’information de Copenhague (Jochumsen, Rasmussen et Skot-Hansen, 2012), nous avons eu comme objectif de croiser nos regards sur le rôle-clef des bibliothécaires comme acteurs de changement, afin de voir si les vingt-huit années qui séparent les deux auteurs génèrent ou non des divergences.
La bibliothèque de demain sera donc celle où l’on vient apprendre, où l’on peut bénéficier d’un programme de médiation culturelle étendu, où l’on séjourne et se rencontre, où l’on crée et conduit des expériences stimulantes, enrichissantes. Si le bibliothécaire est aujourd’hui aussi bien gestionnaire que créateur, double casquette parmi d’autres, il devra devenir un « homme-orchestre » en développant tout à la fois des compétences relationnelles, pédagogiques et informatiques, mais aussi en matière de communication, de marketing, de médiation (culturelle et numérique), et de lobbying.
Dès lors, quels sont les rôles actifs que les institutions formatrices ainsi que les milieux associatifs liés seront appelés à jouer dans ce contexte, tout particulièrement en lien avec la fonction des bibliothécaires et des bibliothèques publiques dans le cadre d’une démocratie vivante ? Quelles sont les missions traditionnellement assumées par ces acteurs qui devront être réinterprétées à la lumière des mutations en cours ? Quels sont les défis qu’ils devront relever ?
Autant de questions auxquelles il existe une multitude de réponses, raison pour laquelle nous nous proposons d’apporter un regard croisé sur l’évolution des compétences des professionnels de l’information en bibliothèque publique, regard croisé puisqu’issu d’une concertation intergénérationnelle.
Mutations, interrogations
Le monde de l’information évolue : des technologies aux publics, des besoins aux processus de traitement de l’information, chaque révolution, chaque progrès technique apporte son lot de nécessaires adaptations. Les pratiques culturelles, informationnelles et en termes de loisirs ne sont plus les mêmes qu’hier et seront encore différentes demain. Les technologies évoluent plus vite que leurs usagers, et les transformations sociétales continuent de nous surprendre : individualisme croissant, pratiques culturelles et informationnelles changeantes, sans oublier des mutations démographiques qui, au niveau politique, divisent plus que jamais.
Idéalement, la bibliothèque, qui se trouve presque malgré elle influencée par tous ces facteurs, devrait pouvoir jouer un rôle de pilier garant d’une démocratie véritablement au service de tous, mais elle est de plus en plus régulièrement confrontée à des formes de concurrence : directe avec Internet, mais également indirecte avec plusieurs acteurs du monde socio-culturel (ateliers d’insertion professionnelle, centres d’intégration pour réfugiés, clubs en tous genres, etc.). De nouveaux acteurs bouleversent évidemment la configuration dans laquelle prenaient place les bibliothèques publiques, ce qui fait dire à certains :
« Jusqu’à présent, les bibliothèques n’ont fait que rassembler des informations pour des gens. Ce concept ne fonctionne plus de nos jours. Il y a Internet. Celui qui cherche des contenus n’a plus besoin de bibliothèques […] Les bibliothèques sont surévaluées. Si une bibliothèque communale ferme, tout le monde prétend que c’est la fin du monde. On craint que les gens deviennent plus sots et arrêtent de lire s’il n’y a plus de bibliothèques. Ceci est complètement faux. » (Traduction libre) (Furger, 2012)
Rafael Ball est pourtant le directeur de la bibliothèque de l’une des hautes écoles suisses les plsu réputées, la Eidgenössische Technische Hochschule de Zürich (ETHZ). De tels propos sont courants à l’heure actuelle, mais rarement dans la bouche de bibliothécaires… Comment en sommes-nous arrivés là ? Mutations de la société, redistribution des cartes au niveau géopolitique et montée de l’individualisme expliquent en partie certaines prises de position proches de l’obscurantisme, mais il revient tout de même aux bibliothèques de s’adapter à un monde qui pense pouvoir se passer d’elles, de réinterpréter leurs missions encore très (trop ?) ancrées sur leurs collections.
Un exemple flagrant : « No Billag »
La SSR (Société suisse de radiodiffusion et télévision) est une « association privée régie par le droit des sociétés anonymes, qui exploite une entreprise média. Elle remplit un mandat sociétal découlant de la Constitution, de la loi et de la Concession et touche, pour ce faire, une partie des recettes issues de la redevance radio-tv » (SSR, 2018). Il s’agit donc d’un service public, comme les bibliothèques, soumis à la concurrence, comme les bibliothèques. Une société, Billag jusqu’au 31 mars 2018, est chargée de percevoir auprès des citoyens la redevance audiovisuelle de réception de radio et de télévision.
En mars 2018, une initiative populaire proposait de supprimer cette redevance bénéficiant également à 13 chaînes de télévision régionales et 21 chaînes de radio locales, pour un montant total et annuel de 67,5 millions de francs. Concernant quelques 13'500 emplois, le mandat de prestation octroyé par l’Office fédéral de la communication (Ofcom) vise à garantir un service public complet contre une part de la redevance. Si ce système a été mis en place, c’est que la Suisse, petit pays aux multiples langues, ne dispose pas de bassins d’audience suffisants pour permettre à une chaîne de télévision de subsister par ses propres moyens ; il a toutefois été jugé fort important de garantir la pluralité des opinions grâce à un paysage audiovisuel varié.
Gilles Marchand, le directeur général de la SSR ayant pris ses fonctions juste avant le lancement de l’initiative, résume bien la situation : « La Suisse est un petit marché extrêmement compétitif et entièrement couvert par les acteurs internationaux. Dans ce contexte, il y a une tension grandissante entre acteurs privés et publics. On aborde ici les questions de subsidiarité : le public ne devrait s’occuper que de ce que le marché ne peut pas financer. Une approche très compliquée dans un petit pays comme le nôtre, partagé en différents marchés linguistiques de puissance inégale. » (Guillaume, 2018a).
Le fait que le pays se partage en quatre langues nationales (français, allemand, italien et romanche) n’en fait pas un terrain propice à des entreprises audiovisuelles privées, ce d’autant plus que chaque bassin linguistique profite des infrastructures télévisuelles et radiophoniques des pays avoisinants. Dans un tel contexte, il est quasiment impossible de rassembler suffisamment d’audience pour assurer la survie économique d’une chaîne de télévision ou de radio. A cela s’ajoutent, comme déjà relevé, des pratiques culturelles en pleine mutation, de nouvelles habitudes de consommation et de nouveaux canaux de diffusion de l’information.
Un aspect parfois sous-estimé d’un service public national, surtout dans le cadre helvétique, est cette propension à rassembler, justement, des populations très différentes, de cultures parfois profondément dissemblables. L’organisation politique suisse, sous couvert de fédéralisme, laisse une très grande liberté à chaque canton, à chaque commune, mais offre quand même, sous la Coupole du Palais Fédéral, un sentiment d’unité que relève la devise (non-officielle) du pays : « Unus pro omnibus, omnes pro uno ».
L’on voit donc que par bien des aspects, les missions d’un service public audiovisuel rejoignent celles des bibliothèques publiques, et ce n’est pas étonnant que celles-ci, ainsi que le milieu des professionnels de l’information en général, se soient fortement mobilisées pour contrer cette initiative libertarienne. Les concepteurs de l’initiative évoluaient pour la plupart dans les milieux de la finance et de la banque, et avaient en commun de vouer une confiance sans limites aux lois du marché, en plus d’être jeunes. Cela révèle encore une fois la fracture qui se crée entre les générations dans les pratiques culturelles et de consommation (Zünd, 2018)
Ainsi, les services publics chargés de récolter et diffuser de l’information, dont la légitimité semblait aller de soi, ne sont pas à l’abri d’une remise en question. Il est certain que le système politique suisse, considéré comme l’un des plus proches de la démocratie directe au monde en permettant au peuple d’exercer directement son pouvoir politique en se prononçant régulièrement sur l’approbation de textes législatifs, voire constitutionnels, ouvre la porte à toutes sortes d’initiatives, pour peu qu’une certaine part de la population les soutienne. Ce contexte particulier, s’il comporte quelques désavantages, a le mérite de garantir une énorme liberté d’idées, et donc d’expression, ce qui en fait un terreau fertile pour toutes les formes de lobbyisme politiques, et donc encourage les milieux associatifs à faire entendre leur voix.
Milieux associatifs et « No Billag »
Après une certaine frayeur fin 2017 concernant un sondage pré-votations où l’initiative était donnée gagnante à 57% (Revello, 2017), plusieurs acteurs culturels se réveillent et s’organisent pour communiquer contre cette initiative, à commencer par le mouvement Opération Libero, créé lors d’une précédente votation sur l’immigration de masse portée par l’UDC (Union démocratique du centre, parti fortement ancré à droite). Acteurs, humoristes, musiciens, écrivains et bien d’autres entrent en campagne contre cette initiative, la grande difficulté étant l’impossibilité pour la SSR, en tant que service public, de se prononcer sur le sujet, et surtout la nécessité pour elle de veiller impérativement à ne pas favoriser, sur les ondes, l’un ou l’autre des avis.
Avec un peu de recul, cette campagne fut la plus agressive depuis celle de l’adhésion à l’Espace économique européen en 1992 (Guillaume, 2018b), allant jusqu’à la profération de menaces de mort à l’encontre de présidents d’associations ouvertement opposés à l’initiative. Rarement la Suisse n’avait vécu de périodes aussi mouvementées au niveau politique, et face à cette violence, beaucoup furent pris au dépourvu dans ce débat, à commencer par le monde des bibliothèques qui, assez logiquement, ne s’attendait absolument pas à ce qu’une initiative populaire remette en cause des institutions considérées comme des piliers de la démocratie, et ce surtout dans un pays où la participation active des citoyens dans les processus politiques est régulièrement mise en avant.
Au final, l’initiative a été rejetée par une écrasante majorité (71.6% de la population ainsi que la totalité des cantons), une victoire qui a été relayée par bon nombre de médias étrangers, comme Radio-Canada qui relève qu’au lendemain du vote, des mesures devront de toute façon être prises quant à l’avenir de la SSR (Rioux, 2018). Cette dernière, déjà durant le débat, avait commencé à effectuer une autocritique, admettant volontiers que le système actuel ne correspondait plus aux attentes des utilisateurs ni au contexte socio-économique. Il est certain que cet aveu a contribué à faire pencher la balance dans un vote qui, selon les premiers sondages, annonçait le « oui » gagnant.
Milieux associatifs et bibliothèques
Les débats autour de l’initiative « No Billag », ont généré une remise en question de la plupart des services publics, et les bibliothèques n’y échappent pas. Moins touchées par la concurrence, mais malgré tout soumises à un marché de l’information en pleine mutation, il est indispensable qu’elles anticipent au plus vite les profonds changements qui marquent notre société, non seulement sur les plans technologiques, mais aussi sociétaux. Repenser les collections, repenser les espaces, actualiser les missions, … il y a mille pistes de réflexions à emprunter, aussi bien au niveau pratique (aménagement, technologie, formation, …) qu’au niveau de réflexions à mener et de démarches à entreprendre (advocacy, service aux communautés, soutien à la liberté intellectuelle, …).
L’IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), dans un but d’unification et de reconnaissance des professionnels de l’information, propose une vision globale de nos buts et valeurs, régulièrement actualisée (IFLA, 2018). Ce genre de déclaration commune, portée par une association internationale, est à même d’asseoir une certaine légitimité de nos objectifs, et par là-même de nos actions. C’est dans cette optique que deux associations professionnelles suisses ont décidé en mars 2018 de se regrouper sous une bannière commune, en créant BiblioSuisse.
BiblioSuisse a pour vocation de défendre les intérêts des bibliothèques auprès des pouvoirs publics et des instances politiques, soutenir la formation et promouvoir les compétences des professionnels de l’information. En fonction à partir du 1er janvier 2019, l’association n’a pas encore de publications à son nom, mais elle reprend à son compte le Code d’éthique de l’un de ses prédécesseurs, Bibliothèque Information Suisse (BIS), et s’aligne évidemment sur la charte de bibliothèques suisses, élaborée par la Commission de la Bibliothèque Nationale Suisse (Commission de la Bibliothèque Nationale suisse, 2010). En préambule de celle-ci, l’on trouve des affirmations très générales permettant de définir les grandes lignes de développement de la profession :
« Les bibliothèques sont indispensables à la société de l'information, parce que
- elles préparent l'information nécessaire à leurs diverses communautés d'usagers, sous quelque forme qu'elle se présente,
- œuvrant en réseau, elles garantissent à l'ensemble de la population une excellente desserte de leurs services,
- elles offrent un large accès aux ressources électroniques,
- elles contribuent ainsi à réduire la fracture numérique,
- elles préservent pour le long terme le savoir et l'héritage culturel.
Pour que les bibliothèques puissent remplir au mieux leur mission publique, elles ont besoin d'une base légale, d'une définition claire de leur mission et de ressources en conséquence. »
Pour atteindre ces ambitieux objectifs, la réunion des professionnels en une seule association était indispensable, afin d’unir nos compétences et de permettre des actions fortes en faveur des bibliothèques, comme le stipule cet extrait du dépliant préparé en vue du vote de dissolution des anciennes associations BIS et CLP et adressé aux membres des deux associations : « Lobbying : BiblioSuisse défend les intérêts de tous les types de bibliothèques au niveau national et cantonal, et les soutient au niveau communal. Les bibliothèques doivent trouver leur place dans la stratégie « Suisse numérique » du Conseil Fédéral, de même qu’elles doivent trouver leur place dans le plan directeur d’une commune. ».
Mais, même réunis en association « faîtière », les bibliothécaires doivent s’engager en tant que membres individuels dans les différents organes et groupes de travail de BiblioSuisse à des fins de représentativité, de force de conviction, et ne serait-ce que pour des questions financières, car n’oublions pas qu’en l’état, BiblioSuisse n’est pas subventionné par les pouvoirs publics. Cet engagement des personnes permettra d’améliorer les actions concrètes entreprises aux différents niveaux politiques en mettant en place un lobbyisme « intelligent » axé sur trois principes.
Premièrement, il faut impérativement prendre en compte deux éléments déjà cités : le fédéralisme très poussé de notre pays, et le fait que celui-ci est composé de quatre cultures et langues différentes, ce qui rend les actions au niveau national difficile à réaliser. Dès lors, il est impératif de les décliner de diverses manières et dans les diverses régions, en prenant en compte les spécificités socioculturelles, économiques et linguistiques, ainsi que les singularités des bibliothèques.
En second lieu, il faut faire en sorte que les campagnes soient portées par la « base » des bibliothécaires actifs sur le terrain, de façon à éviter toute dichotomie entre le message et la réalité visible par les politiques et le grand public. Une « image » ne se décrète pas, elle doit être véhiculée par les acteurs de la profession.
Pour terminer, il est indispensable de donner une cohérence générale, un « fil rouge », à ces actions, afin de coller au mieux aux enjeux auxquels la Suisse est aujourd’hui confrontée, comme la plupart des démocraties. Le principal enjeu actuel est, à notre sens, l’inclusion sociale et comprend l’inclusion numérique, l’alphabétisation, l’intégration des immigrants et des populations spécifiques, tels les publics empêchés (personnes âgées, à mobilité réduite, à handicap, jeunes, etc.). C’est là un objectif essentiel en lien avec la mission des bibliothèques publiques.
Pour faire face à ces enjeux directement liés à l’utilité démocratique de nos institutions, il est nécessaire que leur personnel soit formé, et continue à se former tout au long de leur carrière. Nombre de petites et moyennes bibliothèques sont encore animées par des « bénévoles » ou du personnel non (ou pas suffisamment) qualifié, ce qui est un frein à la volonté de faire évoluer l’image des bibliothèques auprès des politiques et du grand public, de sortir du cliché « étagères à livres ». L’engagement des responsables des programmes de formation et des bibliothécaires dans une optique de formation continue est indispensable à la constitution d’une image valorisante et légitime de nos institutions : nous sommes, tous ensemble, des acteurs du changement.
Le bibliothécaire de demain
Un changement, d’accord, mais pour tendre vers quoi ? Le modèle du bibliothécaire de demain dépendra de l’évolution sociétale, mais de grands axes peuvent déjà donner quelques pistes, comme l’a relevé Pascal Desfarges (2014) lors de la journée d’étude « Bibliothécaire aujourd’hui, est-ce encore un métier ? ». Une lecture attentive du Manifeste de l’UNESCO pour la Bibliothèque publique permet également de catégoriser les compétences essentielles au futur des bibliothèques.
Le « bibliothécaire-médiateur » : il s’agit là d’un déplacement du centre de gravité du métier vers la médiation. Le bibliothécaire passe dès lors de simple intermédiaire à véritable « traducteur » en faisant comprendre, en explicitant et en traduisant les enjeux de la société de l’information, en jouant un rôle de facilitateur, d’accompagnateur des usagers dans les transformations en matière de culture et d’usages numériques et informationnels (Desfarges, 2014).
Le « bibliothécaire-créateur » : ce rôle touche la mise en place de dispositifs d’aide à la création, particulièrement en ce qui concerne l’appropriation du numérique et la création d’espaces de travail collaboratifs performants. Le bibliothécaire- « invente, expérimente, détourne et cherche à créer du sens à travers les savoirs hybrides associés aux technologies émergentes (jeux vidéo, jeux sérieux, design interactif, usages des technologies nomades, réalité augmentée etc.) » (Desfarges, 2014).
Le « bibliothécaire-gestionnaire » : de moins en moins d’interventions humaines sont nécessaires à la gestion des bibliothèques avec l’introduction de plus en plus fréquente d’automates de prêts, d’outils de catalogage et d’indexation externalisés, la robotisation de certains services, etc. Le bibliothécaire-gestionnaire pourra dès lors se consacrer au développement de véritables stratégies en matière de gestion, comme l’optimisation des structures et des procédures, le déploiement de nouveaux services et produits, et évidemment à l’activisme en termes de marketing et de plaidoyer (Desfarges, 2014).
Bien entendu, les centres de formation, à l’image de la filière Information documentaire de la Haute Ecole de gestion de Genève, s’appliquent depuis plusieurs années déjà à développer les cours existants et à en créer de nouveaux en adéquation avec les évolutions du métier et des besoins des usagers, ceci afin que les professionnels puissent mettre rapidement leurs nouvelles compétences au service des institutions documentaires. Ces compétences sont évidemment variées et se diversifient avec les mutations sociétales et il devient impossible, pour une seule et même personne, de se professionnaliser dans tous les domaines, d’où la nécessité de travailler tous ensemble pour créer la bibliothèque de demain. Les compétences relationnelles, pédagogiques, informatiques, en matière de médiation culturelle et numérique, en matière de communication et de marketing, en termes de gestion stratégique, sont autant d’éléments indispensables au bon fonctionnement de nos bibliothèques, mais seule la combinaison de divers profils professionnels permet de les couvrir.
Une bibliothèque plateforme
Ainsi le bibliothécaire de demain créera la bibliothèque de demain, celle qui sera une nouvelle agora, un pilier indispensable de la démocratie, un lieu d’échanges et de création. Soit, exactement ce que propose Michael Ravedoni dans son travail de Bachelor rédigé en 2018, à la Haute Ecole de gestion de Genève.
Pour véritablement saisir l’importance des bibliothèques en tant que berceau des démocraties, il faut en effet réaliser qu’une « démocratie implique d’avoir des citoyens informés et éduqués demandant de l’information et des procédures transparentes et accessibles. La bibliothèque en est généralement la garante par la promotion de la liberté d’expression et de la liberté intellectuelle » (Ravedoni, 2018, p.10).
Nous faisons nôtre le but fixé par Michael Ravedoni : « L’objectif est simple : mettre à disposition des communautés l’expérience des bibliothécaires et l’infrastructure physique ou virtuelle de la bibliothèque, afin de faciliter la création, le partage et la diffusion des connaissances, dans le but de pérenniser la culture de ces mêmes communautés. Une des missions d’une bibliothèque est de transmettre et pérenniser le patrimoine culturel de la société. Pourquoi ne pas offrir à ceux qui créent et vivent la culture, la possibilité de la transmettre directement ? Offrir la culture par ceux qui la créent. La bibliothèque agirait donc comme un facilitateur entre créateurs et utilisateurs de culture. Puis, comme un catalyseur ayant l’infrastructure et l’expertise nécessaires pour capitaliser et pérenniser cette culture. » (Ravedoni, 2018, p. 43).
Le schéma qui suit est principalement basé sur les modèles de la bibliothèque troisième lieu (Servet, 2009), des quatre espaces (Jochumsen, Rasmussen et Skot-Hansen, 2012), et du New librarianship de David Lankes (2011).
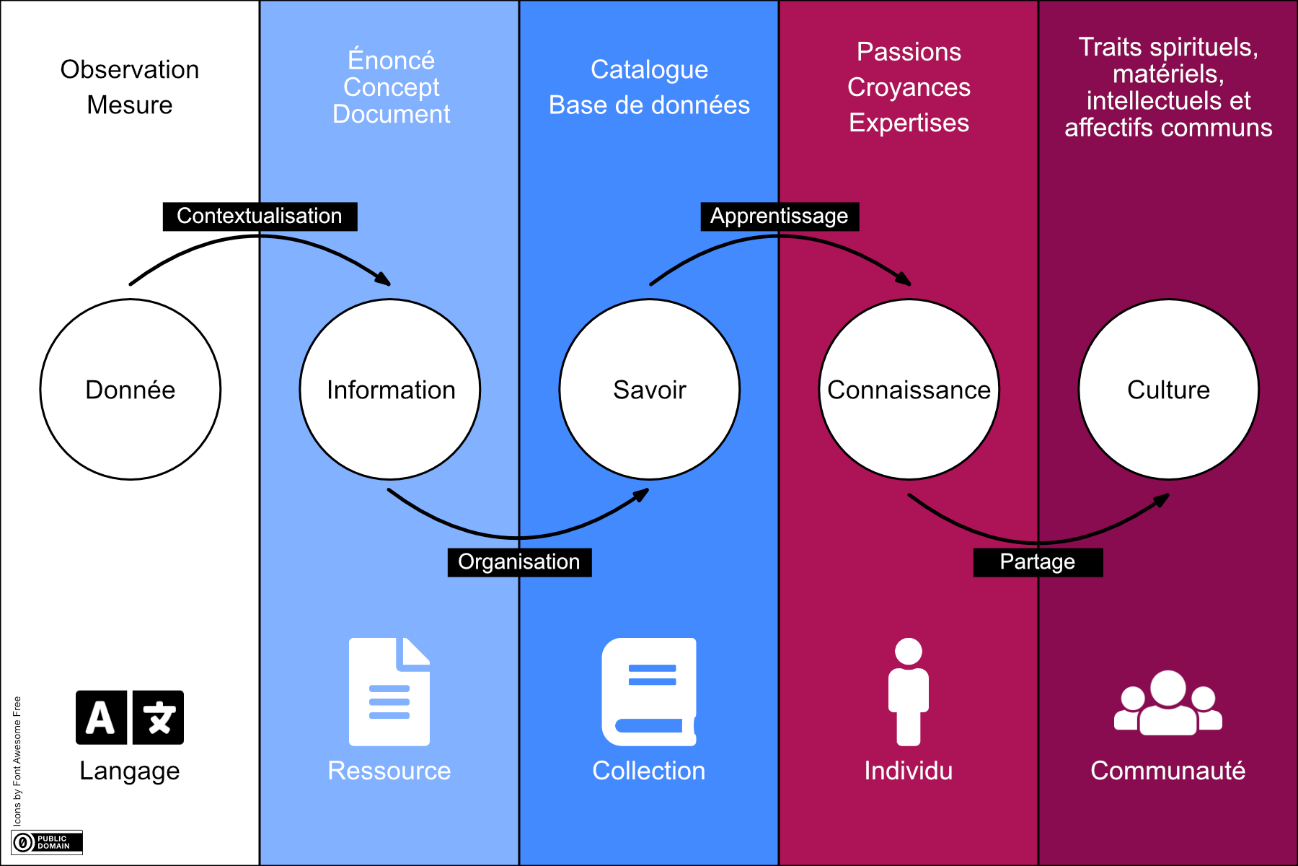
Ravedoni, 2018, p.44
Ce premier schéma en amène un second, le modèle développé par Michael Ravedoni, nous apparaît comme un modèle vers lequel tendre, afin d’assurer l’avenir de nos bibliothèques.
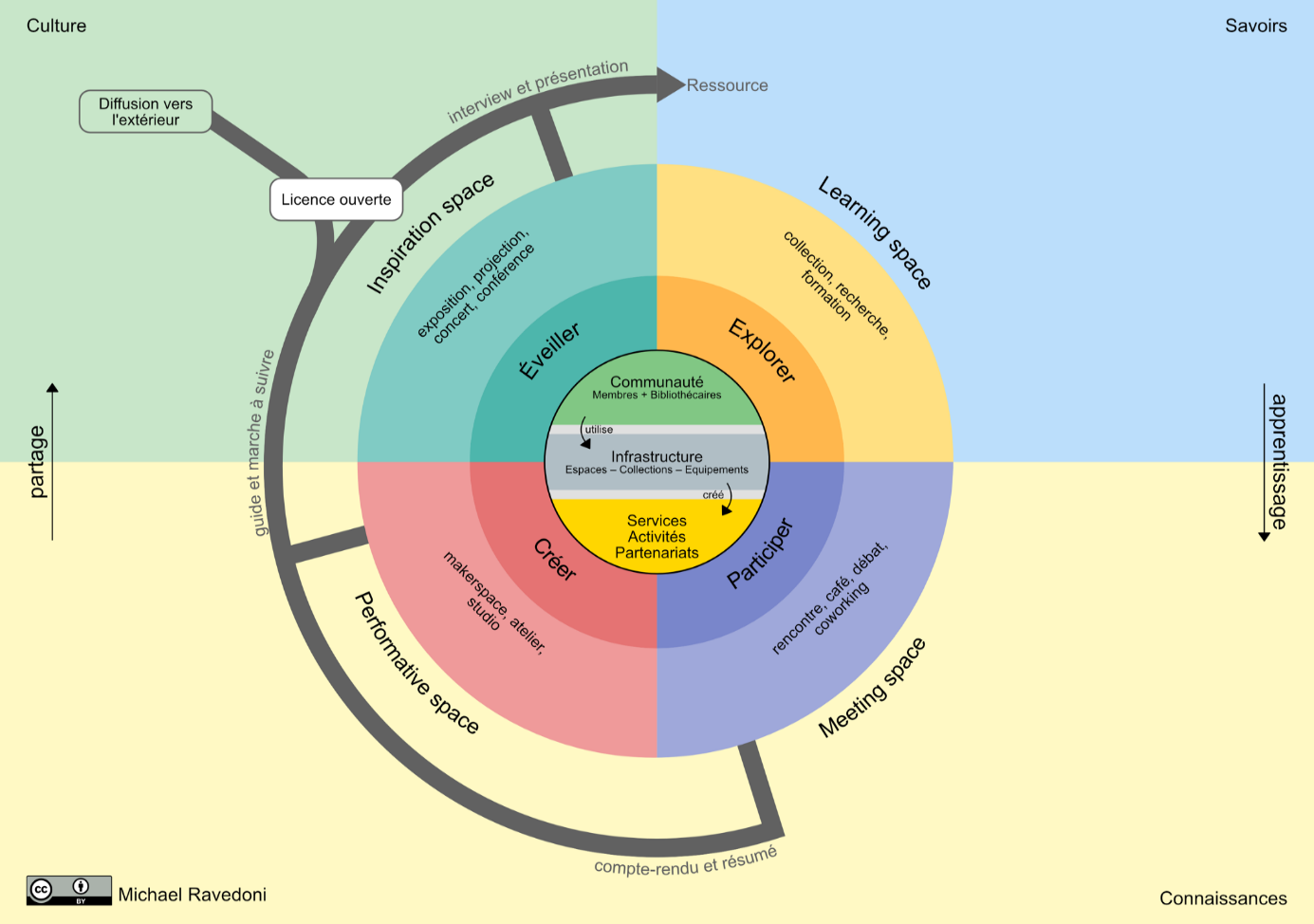
Ravedoni, 2018, p.58
« Le modèle voit la bibliothèque comme un outil faisant partie de l’institution ou de la communauté à laquelle elle appartient, ayant sa propre raison d’être et dont les bibliothécaires occupent une mission particulière : améliorer la société en facilitant la création de connaissances, le partage de culture et la diffusion de ressources dans leurs communautés. Parfois comme stimulateurs, parfois comme médiateurs ou accompagnateurs, ou encore comme partenaires, les bibliothécaires savent créer un environnement propice au partage, à la création et à l’apprentissage. Ils savent aussi thésauriser et pérenniser la culture qui se crée sous leurs yeux. Ils savent connecter les communautés entre elles et leur proposer des services leur facilitant la tâche tout en leur apprenant à devenir autonomes. Ils ne sont pas là, comme des savants prescripteurs, pour dicter une conduite ou privilégier une culture par rapport à l’autre. La bibliothèque se doit d’être un espace où l’exploration, la participation, le partage et l’inspiration s’entremêlent harmonieusement. Un espace motivant, où les membres se sentent appartenir à quelque chose de plus grand qu’eux, où ils se sentent impliqués, écoutés et libres, où leur responsabilité est engagée. De ce fait, la co-création d’une bibliothèque basée sur le respect et la confiance mutuelle devient possible. » (Ravedoni, 2018, p. 58)
Conclusion
L’on voit ainsi que nos missions évoluent en même temps que notre société, il est donc impensable pour des institutions défendant ce type de valeurs de se conforter dans une espèce d’immobilisme, à l’image des clichés encore aujourd’hui véhiculés au sujet des bibliothèques et de leur personnel. Et pourtant, il s’avère qu’il s’agit souvent de ce personnel qui freine le changement, par exemple en ce qui concerne l’ouverture le dimanche ou les horaires élargis. Or, en accord avec nos analyses, c’est au personnel des bibliothèques d’agir, d’être proactif pour devenir les actrices et acteurs des nécessaires changements induits par notre époque, par nos sociétés.
Par souci de cohérence, cette évolution doit se faire à l’unanimité, il est indispensable de faire front tous ensemble pour défendre la pérennisation de nos institutions, en leur faisant prendre tous les virages nécessaires pour arriver à la bibliothèque de demain, pour légitimer les centres d’information comme les piliers dont nos démocraties ont besoin, comme lieux de socialisation, de création, de partage et de diffusion des connaissances. Ainsi, le bibliothécaire est désormais investi d’un rôle politique, qui resterait négligeable sans le soutien d’associations professionnelles organisées.
Dans le cadre de cette intervention à Montréal, nous nous proposions de voir si les vingt-huit années qui nous séparent généraient ou non des divergences entre nous, maître d’enseignement et assistant fraîchement diplômé, entre nos visions. Désormais, nous pouvons résolument affirmer qu’il n’y en a pas, qu’il ne doit pas y en avoir, car le combat pour assurer la pérennisation de nos bibliothèques ne pourra être gagné que grâce à la collaboration de toutes et tous, quels que soient les profils. L’expérience d’une part, et la formation d’autre part, créent la convergence nécessaire entre les générations, afin que tous les bibliothécaires aient la capacité d’être des actrices et des acteurs du changement !
Bibliographie
COMMISSION DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE SUISSE, 2010. Charte des bibliothèques suisses. Bibliothèque nationale suisse (BN) [en ligne]. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/portrait/organisation/charte.html
DESFARGES, Pascal, 2014. Bibliothécaires du futur, futur des bibliothèques : identité, compétences, missions, métier ?. In : ARCHIVES DEPARTEMENTALES D’ILLE-ET-VILAINE. Journée d’étude « Bibliothécaire aujourd’hui, est-ce encore un métier ? », Rennes, 10 avril 2014 [en ligne]. Slideshare, 16 p. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://fr.slideshare.net/retiss/bibliothcaires-du-futur-et-futur-des-bibliothques
FURGER, Michael, 2012. Bibliotheken : weg damit ! NZZ am Sonntag [en ligne]. 7.2.2016. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://nzzas.nzz.ch/hintergrund/bibliotheken-und-buecher-weg-damit-meint-rafael-ball-ld.147683 [accès par abonnement]
JOCHUMSEN, Henryk, RASMUSSEN Casper Hvenegaard, SKOT-HANSEN, Dorte, 2012. The four spaces : a new model for the public library. New Library World [en ligne]. Vol. 113, issue 11/12, pp. 586-597. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03074801211282948 [accès par abonnement]
GUILLAUME, Michel, 2018a. « Peut-être n’avons-nous pas assez dialogué avec la société ». Le Temps. 6 janvier 2018. ISSN 1423-3967
GUILLAUME, Michel, 2018b. « No Billag », la campagne des dérapages. Le Temps. 24 février 2018. ISSN 1423-3967
GUILLAUME, Michel, 2018c. Une SSR en mode « réforme permanente ». Le Temps. 5 mars 2018. ISSN 1423-3967
INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS (IFLA), [2018]. Vision globale : résumé du rapport : top 10 des points-clés et des opportunités. IFLA [en ligne]. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gv-report-summary-fr.pdf
LANKES, R. David, 2011. The atlas of new librarianship. Cambridge : MIT Press. ISBN 978-0-262-01509-7.
RAVEDONI, Michael, 2018. La bibliothèque plateforme : espace dédié à la création, au partage et à la diffusion de culture - exemple par la création d’un makerspace [en ligne]. Genève : Haute Ecole de gestion de Genève. Travail de bachelor. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://doc.rero.ch/search?ln=fr&sc=1&p=ravedoni&action_search=
REVELLO, Sylvia, 2017. Un sondage controversé donne « No Billag » gagnante. Le Temps. 5 décembre 2017. ISSN 1423-3967
RIOUX, Hubert, 2018. Victoire pour la Société suisse de radiodiffusion et télévision. Radio-Canada [en ligne]. 4 mars 2018, 17:23. Mis à jour le 4 mars 2018, 23:52. [Consulté le 17 décembre 2018¨. Disponible à l’adresse : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087062/suisse-redevance-televisuelle-referendum
SERVET, Mathilde, 2009. Les bibliothèques troisième lieu [en ligne]. Villeurbanne : École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB). Travail de mémoire. [Consulté le 17 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/21206-les-bibliotheques-troisieme-lieu.pdf
SOCIÉTÉ SUISSE DE RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION (SSR), [2018]. Mandat. SRG SSR [en ligne]. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://www.srgssr.ch/fr/qui-nous-sommes/vision-et-stategie/mandat/
ZÜND, Céline, 2018. L’influence libertarienne à l’origine de l’initiative « No Billag ». Le Temps. 18 janvier 2018. ISSN 1423-3967
- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires
La contribution suisse dans la recherche sur la communication institutionnelle dans les hôpitaux
Ressi — 20 décembre 2018
Pablo Medina Aguerrebere, Institut de Santé Globale, Faculté de Médecine – Université de Genève
Emmanuel Kabengele, Institut de Santé Globale, Faculté de Médecine – Université de Genève
Résumé
La gestion stratégique de la communication institutionnelle aide les hôpitaux à mieux répondre aux nouvelles exigences des patients et à s’adapter aux changements sociaux et technologiques en cours, ce qui est fondamental pour renforcer leur positionnement stratégique dans le marché des soins. La communication institutionnelle dans le domaine hospitalier devient un sujet de plus en plus important pour les chercheurs et les décideurs politiques. L’objectif de cet article est d’évaluer la contribution de la recherche suisse dans le domaine de la communication hospitalière. Dans cette perspective, nous avons analysé la production scientifique de 1997 à 2017 des principales revues de référence dans ce domaine au niveau international (Journal of Health Communication, Health Communication, Journal of Communication in Healthcare et The American Journal of Public Health), au niveau national suisse (Swiss Medical Weekly, Revue Médicale Suisse) et la base de données Medline afin de repérer des travaux centrés sur le contexte hospitalier suisse. Il en ressort que la recherche suisse dans le domaine est très peu présente dans les revues analysées.
Abstract
Strategic management of corporate communication helps hospitals to better respond to new patient demands and to adapt to social and technological changes, which is fundamental to strengthening their strategic positioning in the healthcare market. Corporate communication in the hospital field is becoming an increasingly important topic for researchers and policymakers. The aim of this article is to evaluate the contribution of Swiss research in the field of hospital communication. In this perspective, we analyzed the scientific production from 1997 to 2017 of the main reference journals in this field at international level (Journal of Health Communication, Health Communication, Journal of Communication in Healthcare and The American Journal of Public Health), at Swiss level (Swiss Medical Weekly, Revue Médicale Suisse) and the Medline database to identify papers focusing on the Swiss hospital context. It shows that Swiss research in the field is very little present in the journals analyzed.
Introduction
La gestion stratégique de la communication institutionnelle dans les hôpitaux est devenue un domaine prioritaire pour les institutions qui souhaitent optimiser leur fonctionnement interne et externe pour ainsi renforcer les rapports établis avec les différentes parties prenantes (employés, patients, médias, autorités publiques, etc.). Les synergies existantes entre ces deux milieux professionnels – hôpital et communication- ont mené plusieurs chercheurs à produire des travaux sur la communication médecin-patient, la communication interne et externe dans les hôpitaux, la gestion de l’image de marque, l’impact des réseaux sociaux sur la réputation de l’hôpital, etc. Ainsi, des revues scientifiques spécialisées dans ce domaine ont vu le jour à travers le monde, comme par exemple Health Communication, Journal of Health Communication ou Journal of Communication in Healthcare. L’objectif de cet article est d’évaluer la contribution de la recherche suisse dans le domaine de la communication hospitalière. Dans cette perspective, nous avons réalisé une revue de littérature sur les principaux axes dans ce domaine (communication institutionnelle, communication interne et externe, réputation et réseaux sociaux) ; et, ensuite, nous avons analysé la production scientifique de 1997 à 2017 des principales revues dans ce domaine au niveau international (Journal of Health Communication, Health Communication, Journal of Communication in Healthcare et The American Journal of Public Health) et national (Swiss Medical Weekly, Revue Médicale Suisse) ainsi que la base de données Medline afin de repérer des travaux centrés sur le contexte hospitalier suisse.
La communication institutionnelle dans les hôpitaux
La communication est un facteur stratégique qui influence la pratique des professionnels de santé dans les hôpitaux (Brent, 2016 ; Burleson, 2014). Les relations synergiques entre la communication et la santé ont mené plusieurs chercheurs à s’intéresser à ce domaine ; ainsi, plusieurs travaux ont porté sur la gestion globale de l’information médicale, la communication médecin-patient ou encore l’impact des nouvelles technologies de la communication sur le fonctionnement de l’hôpital (Hannawa et al. 2015). L’influence de la communication sur les comportements et les résultats médicaux obtenus par les patients qui se rendent à l’hôpital a mené certains, comme Nazione et al. (2013), à affirmer que la communication hospitalière est un domaine de recherche stratégique pour l’avenir de la société. L’augmentation de la production scientifique dans ce domaine montre l’intérêt dans une meilleure connaissance sur le comportement du patient pour ainsi lui offrir un meilleur service médical (Kreps, Query, Bonaguro, 2007). Par ailleurs, ces recherches permettent aussi aux institutions sanitaires d’améliorer l’efficacité de leurs campagnes de communication et de promotion de la santé (Weberling, McKeever, 2014).
Même si les rapports entre la communication et les hôpitaux sont nombreux, nous pouvons souligner cinq domaines de recherche principaux : a) la communication entre le professionnel de la santé et le patient, b) la communication interne dans les hôpitaux, c) la communication externe hospitalière, d) la gestion de l’image de marque et de la réputation et e) l’impact des réseaux sociaux sur la communication institutionnelle des hôpitaux.
La communication entre le patient et le professionnel de la santé est un domaine stratégique pour le bon fonctionnement de l’hôpital. Selon Gilligan et al. (2016), les Facultés de Médecine doivent promouvoir les formations en communication interpersonnelle afin que les futurs professionnels de la santé sachent offrir aux patients un service médical efficace et centré sur les vrais besoins des patients en vue d’améliorer le fonctionnement de l’hôpital. L’empowerment du patient est devenu une priorité pour les organisations hospitalières : ainsi, le patient apparaît comme un acteur autonome et responsable de sa propre santé et assume dorénavant un rôle très actif dans les rapports établis avec les professionnels de la santé (Bureau, Herman-Mesfen, 2014). Ce dernier doit développer des compétences en communication interpersonnelle, écoute et analyse du contexte afin de pouvoir adapter son discours à la situation personnelle de chaque patient (D’Agostino, Bylund, 2014). En ce qui concerne le patient, celui-ci assume un rôle de plus en plus actif dans les rapports établis avec le professionnel de la santé, d’où la nécessité de se former en communication interpersonnelle (Medina Aguerrebere, 2013). Lors d’une consultation médicale à l’hôpital, la satisfaction du patient est déterminée par les compétences en communication interpersonnelle du professionnel de la santé ; autrement dit, la courtoisie, le respect, les habilités linguistiques et la capacité pour expliquer clairement les informations scientifiques (Al-Abri, Al-Balushi, 2014). Pour faciliter les rapports communicationnels établis entre le professionnel de la santé et le patient, il est souhaitable que ces rapports se basent sur l’argumentation rationnelle, laquelle permet de renforcer le rôle prioritaire du patient (Labrie, Schulz, 2014) ; mais aussi sur le contrôle des émotions, pour ainsi éviter les tensions communicationnelles et, donc, les erreurs dans la diffusion d’informations médicales (Dean, Oetzel, 2014).
Dans le milieu hospitalier, la communication interne est devenue une activité stratégique qui influence la qualité du service médical proposé au patient. Selon Welch et Jackson (2007 : 193), « la communication interne est une activité communicationnelle, qui a lieu entre les managers stratégiques et les parties prenantes, et dont le but est la promotion chez l’employé de l’engagement avec l’organisation, le sentiment d’appartenance, la prise de conscience sur l’environnement changeant et la compréhension des objectifs collectifs ». Dans le domaine hospitalier, les professionnels de la communication interne font face à plusieurs défis : le manque d’experts dans le domaine, la difficulté à mettre en place certaines actions de communication interne et la difficulté à divulguer les informations scientifiques (Burleson, 2014). Ces professionnels doivent baser leurs plans d’actions sur une approche multi-stakeholders, autrement dit, ils doivent identifier et caractériser les différentes parties prenantes existant à l’organisation – managers stratégiques, superviseurs, employés, etc.- et adapter leur communication à chacun d’eux (Welch, Jackson, 2007). Dans un contexte médical caractérisé par le changement des attentes qu’ont les patients et par le rôle communicationnel de plus en plus important de l’employé, la communication interne devient un outil fondamental pour aider l’organisation à garder la cohérence entre l’image de marque et le comportement des employés (Naveen, Anil, Smruthi, 2014).
L’objectif de la communication institutionnelle externe est d’aider l’hôpital à établir des rapports satisfaisants avec ses différentes parties prenantes, notamment les patients, les médias et les autorités sanitaires –nationales ou internationales-. L’implantation d’une stratégie efficace de communication externe exige une phase préalable de recherche permettant à l’organisation d’évaluer les attitudes et les attentes des différentes parties prenantes (Moser, Greeman, 2014). Par ailleurs, les responsables de communication utilisent des outils de mesure pour expliquer la valeur ajoutée par la communication externe à l’organisation en terme de réputation, marque, identité, leadership, motivation des employés, prévention de crises et relations avec les parties prenantes (Zerfass, Viertmann, 2017). Dans le cadre de la communication institutionnelle externe, les hôpitaux peuvent avoir recours à la publicité et au marketing. Ces deux disciplines s’appliquent parfaitement dans le domaine hospitalier ; ainsi, par exemple, plusieurs études démontrent que le public est très réceptif aux informations médicales diffusées par les hôpitaux dans les campagnes de publicité (Moser, Greeman, 2014). D’ailleurs, la publicité réalisée par les hôpitaux influence le choix des patients ainsi que les résultats économiques de l’institution (Nanda, Telang, Bhatt, 2012). La communication institutionnelle externe, le marketing et la publicité permettent à l’hôpital de renforcer son image de marque, laquelle, selon Naveen, Anil et Smruthi (2014), détermine les décisions et les perceptions des patients sur l’organisation.
La création d’une image de marque solide constitue une priorité pour le Directeur de Communication de l’hôpital. La marque représente des qualités tangibles et intangibles qui apportent à l’organisation une valeur ajoutée (Esposito, 2017). Dans le domaine hospitalier, la marque ne fait pas référence uniquement au nom de l’organisation, mais aussi à toutes les expériences vécues par les patients à l’hôpital ainsi qu’à leurs attentes vis-à-vis de la promesse de l’organisation (Wang et al. 2011). Pour construire une marque solide, les hôpitaux doivent identifier leur niche de marché, analyser le comportement des parties prenantes et construire une marque basée sur la confiance suscitée par la qualité du service médical proposé au patient (Vinodhini, Kumar, 2010). En fonction de leur statut – public ou privé-, les hôpitaux doivent gérer leur marque d’une manière différente: ainsi, les hôpitaux publics doivent transmettre une image cohérente avec celle de l’administration dont ils dépendent afin que les usagers perçoivent les mêmes valeurs dans les deux institutions ; par contre, les hôpitaux privés doivent offrir une image différenciatrice, de qualité et attrayante pour ainsi attirer les différents publics (Ruiz-Granja, 2015).
Pour construire une marque solide et réputée, les hôpitaux utilisent actuellement les réseaux sociaux comme outil de communication institutionnelle. Ces plateformes facilitent les activités communicationnelles de l’hôpital et promeuvent l’empowerment du patient (Fischer, 2014 ; Househ, Borycki, Kushniruk, 2014), ce qui contribue à la construction d’une marque réputée. Néanmoins, il s’avère nécessaire que ces organisations règlent préalablement certains problèmes concernant les réseaux sociaux, comme par exemple la confidentialité, la sécurité, la gestion de l’identité et la désinformation (Househ, Borycki, Kushniruk, 2014). D’ailleurs, elles doivent parier sur la formation des patients et des professionnels de la santé dans l’usage efficace de ces outils (Moorhead et al. 2013). La stratégie sur les réseaux sociaux doit viser la satisfaction des besoins communicationnels ou cliniques des différentes parties prenantes dont dépend l’hôpital (McCarroll et al. 2014), d’où l’importance que ces organisations gèrent les conversations avec les patients pour ainsi mieux satisfaire lesdits besoins (Abramson, Keefe, Chou, 2015).
La gestion stratégique de la communication – interpersonnelle, interne, externe et online- contribue à la création d’une marque hospitalière solide, ce qui est fondamental pour renforcer le positionnement stratégique de l’organisation dans le marché des soins. La recherche sur ce domaine, notamment la communication médecin-patient, devient de plus en plus nécessaire pour les hôpitaux, mais aussi pour les institutions universitaires qui souhaitent mettre en valeur un domaine de recherche qui concerne toute la population. La réalisation de recherches qualitatives ou quantitatives sur la communication médecin-patient, la communication online ou la communication externe de l’hôpital est très présente dans certains pays, comme par exemple les États-Unis. Néanmoins, ces dernières années, nombreux chercheurs de différents pays se sont intéressés à ce milieu de recherche, ce qui met en évidence l’importance grandissante de la communication institutionnelle dans les hôpitaux.
Méthodologie
Afin de connaître la contribution des chercheurs suisses à la production scientifique sur la communication institutionnelle dans les hôpitaux, nous avons analysé individuellement toutes les publications relatives à ce domaine scientifique qui ont paru entre 1997 et 2017. Pour ce faire, nous avons consulté la base de données PubMed, ainsi que le site web individuel des principales revues de référence internationale dans ce domaine (Journal of Health Communication, Health Communication, Journal of Communication in Healthcare et The American Journal of Public Health). Les trois premières publications sont les revues spécialisées en communication santé les mieux classées dans le ranking JCR Thompson Reuters 2016; en ce qui concerne la quatrième revue, il s’agit d’une des revues les mieux classées dans le classement « public, environnemental and occupational health » (JCR Thompson Reuters 2016), et spécialement ouverte envers le domaine de la communication. Afin de trouver les informations précises concernant notre recherche, nous avons analysé le titre et le résumé de tous les articles publiés entre 1997 et 2017. Pour ce faire, nous avons eu recours à différents mots clés - en anglais- combinés de différentes manières : hospital, Switzerland, communication, interpersonal, internal, brand, reputation et social media. Nous avons réalisé toutes les combinaisons possibles afin de trouver les meilleures informations; ainsi, par exemple, pour le mot « hospital », nous avons mené sept recherche différentes : hospital et Switzerland, hospital et communication, hospital et interpersonal, hospital et internal, hospital et brand, hospital et reputation, et hospital et social media. Nous avons fait la même chose avec tous les mots. Une fois évaluées ces quatre revues, et afin de compléter cette étude, nous avons utilisé les mêmes mots clés – en français et en anglais- et les mêmes combinaisons pour analyser les articles publiés entre 1997 et 2017 par les deux revues scientifiques de référence en Suisse dans le domaine de la santé publique (Swiss Medical Weekly, Revue Médicale Suisse) et par la base de données Medline. Pour ce faire, nous avons eu recours à la base de données PubMed. L’analyse de 6 revues scientifiques et de la base de données Medline a été menée du 30 octobre 2017 au 10 décembre 2017.
Résultats
Depuis 1997 jusqu’à 2017, les trois journaux de référence internationale dans le domaine de la communication de santé (Journal of Health Communication, Health Communication et Journal of Communication in Healthcare) et l’un des journaux les plus représentatifs sur la santé publique (The American Journal of Public Health) ont publié 13.703 articles portant sur la communication, la santé publique, les organisations sanitaires, les pathologies, les traitements, etc. (voir Tableau 1. Production scientifique 1997-2017). Les auteurs de ces articles travaillent dans différentes universités internationales, notamment aux États-Unis, en Grande Bretagne et au Canada.
Malgré le volume élevé de production scientifique, il y a très peu de travaux qui analysent le rôle de la communication institutionnelle dans les hôpitaux de Suisse. Ainsi, parmi les 13.703 articles considérés, il n’a pas été trouvé des travaux centrés spécifiquement sur la communication institutionnelle dans les hôpitaux suisses : communication interpersonnelle, communication interne, communication externe, marque, réputation ou réseaux sociaux. Seules 8 articles ont été repérés en lien avec la communication institutionnelle hospitalière en Suisse (voir Tableau 2. Articles sur la communication hospitalière en Suisse).
Tableau 1. Production scientifique 1997-2017
|
Revue |
Années |
Périodicité |
Nombre d’articles publiés |
Nombre de volumes publiés |
Nombre moyen d’articles publiés par volume |
|
Journal of Health Communication |
1997-2017 |
Mensuelle |
1 707 |
179
|
9,5 |
|
Health Communication |
1997-2017 |
Mensuelle |
1 391 |
133 |
10,5 |
|
Journal of Communication in Healthcare* |
2008-2017 |
Bimensuelle |
335 |
38 |
8,8 |
|
The American Journal of Public Health |
1997-2017 |
Mensuelle |
10 270
|
277 |
37,1
|
* Le premier numéro de ce journal a été publié en 2008
Tableau 2. Articles sur la communication hospitalière en Suisse
|
|
Revue |
Titre article |
Année |
Auteurs |
Sujets analysés |
|
1 |
Journal of Health Communication |
An International Comparison of the Association among Literacy, Education, and Health across the United States, Canada, Switzerland, Italy, Norway, and Bermuda: Implications for Health Disparities. |
2015 |
Takashi Yamashita, Suzanne Kunkel |
Santé, éducation, communication. |
|
2 |
Journal of Health Communication |
Empowering People and Organizations through Information |
2012 |
Najeeb Al-Shorbaji |
Communication interne, information, gestion des connaissances. |
|
3 |
Health Communication |
Discharge Communication in Patients Presenting to the Emergency Department With Chest Pain: Defining the Ideal Content |
2015 |
Selina Ackerman et al. |
Communication interne, diffusion d’informations, communication médecin-patient. |
|
4 |
Health Communication |
Physician-Perceived Contradictions in End-of-Life Communication: Toward a Self-Report Measurement Scale |
2014 |
Rebecca Amati, Annegret Hannawa |
Soins palliatifs, communication interne, communication interpersonnelle. |
|
5 |
Health Communication |
Relational Dialectics Theory: Disentangling Physician-Perceived Tensions of End-of-Life Communication |
2013 |
Rebecca Amati, Annegret Hannawa |
Soins palliatifs, communication interne, communication interpersonnelle. |
|
6 |
Health Communication |
Physicians' Communicative Strategies in Interacting With Internet-Informed Patients: Results From a Qualitative Study |
2012 |
Maria Caiata, Peter Schulz |
Hopital, communication interne, communication interpersonnelle. |
|
7 |
Health Communication |
Health Communication Research in Europe: An Emerging Field |
2010 |
Peter Schulz, Uwe Hartung |
Recherche académique, communication santé, patients. |
|
8 |
Journal of Communication in Healthcare |
Differential appraisal of age thresholds for mammographic screening in Holland and Switzerland |
2014 |
Peter Schulz, Bert Meuffels |
Cancer de sein, communication interne, brochures. |
Les sujets analysés sont une liste de sujets ad hoc nous permettant de clarifier les contenus analysés
L’analyse menée sur les 13.703 articles publiés par ces quatre journaux met en évidence certaines tendances. En premier lieu, l’absence marquée d’articles dans le domaine de la communication institutionnelle dans les hôpitaux, que ce soit dans le contexte suisse ou ailleurs. Même s’il y a quelques articles sur la communication interne et interpersonnelle dans le domaine hospitalier, nous n’avons trouvé aucun texte centré sur la communication institutionnelle qu’un hôpital peut mettre en place pour construire sa marque et améliorer ses rapports avec les parties prenantes. Néanmoins, il faut mettre en évidence le cas du Journal of Health Communication, qui a consacré un numéro spécial à la communication interpersonnelle dans le domaine du cancer (2009, vol. 14, sup. 1, State of the Sciences of Communication for Cancer Prevention and Control) ; celui de Health Communication, qui a publié plusieurs articles sur la communication interpersonnelle dans différentes situations - urgences, soins palliatifs, soins de premiers secours- ; et celui du Journal of Communication in Healthcare, qui a publié plusieurs recherches sur les campagnes de santé publique et le marketing sanitaire.
En deuxième lieu, la plupart des travaux analysent la réalité des États-Unis, la Grande Bretagne ou le Canada. Ainsi, par exemple, dans la revue American Journal of Public Health, nous avons trouvé plusieurs textes centrés sur les problèmes de santé publique dans certains états des États-Unis (Californie, Floride, etc.), l’impact sur la santé publique de certains évènements qui ont eu lieu dans le pays (Ouragan Katrina, attaques terroristes à l’anthrax, attentats du 11 Septembre, etc.) ou encore les comportements sanitaires des minorités habitant aux États-Unis – hispanos, africains, etc.- Néanmoins, le Journal of Health Communication a publié plusieurs articles sur les problèmes et défis de santé publique dans d’autres pays, comme par exemple le Kenya, l’Inde ou la Chine ; et le Journal Health Communication a consacré un numéro spécial au développement de la santé publique dans ce dernier pays.
En troisième lieu, les quatre revues analysées priorisent la publication d’articles centrés sur le cas concret de pathologies ou traitements. Ainsi, le Journal of Health Communication a publié plusieurs textes sur le tabac, le VIH, le cancer et la santé mentale ; la revue Health Communication, sur la santé sexuelle, les soins palliatifs, la santé mentale et le don d’organes ; le Journal of Communication in Healthcare, sur la gestion des informations concernant le patient, l’alimentation, la health literacy et le cancer ; et l’American Journal of Public Health, sur la drogue, la contraception, l’ alcool, les styles de vie et la contraception.
Et finalement, en quatrième lieu, le peu de textes qui s’intéressent à la communication en santé publique sont rédigés sous une approche journalistique (couverture médiatique d’un traitement ou une pathologie, campagnes médiatiques contre le tabac, impact de la presse sur la santé publique, etc.), et non pas sous une approche de communication institutionnelle qui vise l’analyse de sujets clés pour une organisation, comme par exemple l’image de marque, la réputation ou le rapport avec les parties prenantes.
Afin de compléter cette étude, nous avons analysé les travaux publiés par les deux meilleures revues de santé publique en Suisse (Swiss Medical Weekly, Revue Médicale Suisse) et par la base de données Medline. Nous avons trouvé des résultats qui confirment le manque de publications centrées spécifiquement sur la communication institutionnelle dans les hôpitaux de Suisse. Ainsi, de 1997 à 2017, la Swiss Medical Weekly a publié uniquement 5 articles en lien avec la communication institutionnelle dans les hôpitaux suisse (voir Tableau 3. Articles parus dans Swiss Medical Weekly) ; la Revue Médicale Suisse, 18 articles (voir Tableau 4. Articles parus dans la Revue Médicale Suisse); et la base de données Medline, 5 articles (voir Tableau 5. Articles parus dans Medline).
Tableau 3. Articles parus dans Swiss Medical Weekly
|
|
Revue |
Titre article |
Année |
Auteurs |
Sujets analysés |
|
1 |
Swiss Medical Weekly |
HIV screening: better communication instead of searching for a needle in a haystack? |
2016 |
Pietro Vernazza |
Communication interne, communication médecin patient, prévention. |
|
2 |
Swiss Medical Weekly |
Teaching communication skills: beyond wishful thinking |
2015 |
Junod Perron et al. |
Communication interpersonnelle, communication médecin patient, profils de patients. |
|
3 |
Swiss Medical Weekly |
Discharge communication in the emergency department: physicians underestimate the time needed |
2012 |
Selina Ackermann et al. |
Communication interne, communication médecin patient, service urgences. |
|
4 |
Swiss Medical Weekly |
Language difficulties in outpatients and their impact on a chronic pain unit in Northwest Switzerland. |
2010 |
Ruppen W, Badschapp O, Urwyler A. |
Hopital, communication interpersonnelle patients chroniques. |
|
5 |
Swiss Medical Weekly |
Communication training and antibiotic use in acute respiratory tract infections |
2006 |
Mathias Brieck et al. |
Communication interne, communication médecin patient, antibiotiques. |
Les sujets analysés sont une liste de sujets ad hoc nous permettant de clarifier les contenus analysés
Tableau 4. Articles parus dans la Revue Médicale Suisse
|
|
Revue |
Titre article |
Année |
Auteurs |
Sujets analysés |
|
1 |
Revue Médicale Suisse |
Formation à la communication clinique : malaise dans la médecine |
2017 |
Céline Bourquin, Friedrich Stiefel |
Communication institutionnelle, communication interne, communication interpersonnelle |
|
2 |
Revue Médicale Suisse |
Enseignement prégradué à la communication et à la relation médecin-patient |
2017 |
Alexandre Berney et al. |
Communication, communication médecin patient, discours. |
|
3 |
Revue Médicale Suisse |
Vaccination de la personne âgée : quelques outils pour mieux communiquer |
2017 |
Lisa Hentsch et al. |
Communication, prévention, personnes âgées. |
|
4 |
Revue Médicale Suisse |
Communiquer, converser, s’émerveiller |
2017 |
Marco Vannotti |
Hopital, communication médecin-patient, accompagnement. |
|
5 |
Revue Médicale Suisse |
Communiquer à la femme enceinte: avantages, risques et incertitudesde la vaccination |
2017 |
Aude Freiburghaus, Elena Ferro-Luzzi, Joël Krüll |
Communication interne, communication interpersonnelle, femmes enceintes. |
|
6 |
Revue Médicale Suisse |
Communication du risque en médecine des voyages |
2015 |
Reto Auer et al. |
Communication, prévention, médecine de voyage |
|
7 |
Revue Médicale Suisse |
Gestion et communication de l’information en surveillance biologique: une approche éthique et interdisciplinaire |
2015 |
Laetitia Pralong |
Communication, gestion de l’information, surveillance biologique |
|
8 |
Revue Médicale Suisse |
Stratégies de communication au service de la formation : quelques outils pratiques |
2015 |
David Gachoud, Sylvie Félix, Matteo Monti |
Communication institutionnelle, communication externe, formation. |
|
9 |
Revue Médicale Suisse |
Réseaux sociaux : de nouveaux outils de communication et de formation pour les médecins ? |
2015 |
François Bastardot, Peter Vollenweider, Pedro Marques-Vidal |
Hopital, communication, médias sociaux. |
|
10 |
Revue Médicale Suisse |
Relation soignant-soigné : quand les blogs s’en mêlent |
2014 |
Céline Rondi, Alexandre Berney |
Hopital, communication, médias sociaux. |
|
11 |
Revue Médicale Suisse |
Communication lors de la consultation : une compétence qui s’apprend et... s’enseigne |
2012 |
Louis Simonet |
Hopital, communication médecin-patient, enseignement. |
|
12 |
Revue Médicale Suisse |
Menaces épidémiologiques : réflexions sur la communication |
2011 |
Christian Chuard, Daniel Genné |
Communication, prévention, épidémiologie |
|
13 |
Revue Médicale Suisse |
Perception et communication du risque : du diabète à la maladie cardiovasculaire |
2010 |
Francesco Gianinazzi et al. |
Communication interne, risque, maladie cardiovasculaires. |
|
14 |
Revue Médicale Suisse |
La communication médicale et les recommandations relationnelles : à contre-courant |
2007 |
C. Luthy C. Cedraschi |
Communication interne, communication médecin-patient, évaluation. |
|
15 |
Revue Médicale Suisse |
Améliorer les compétences communicationnelles : expérience «clinique» et évaluation scientifique |
2006 |
F. Stiefel I. Rousselle J.-N. Despland P. Guex |
Communication interne, communication interpersonnelle, profil patients. |
|
16 |
Revue Médicale Suisse |
Chaque praticien est aussi enseignant : la communication pédagogique |
2006 |
J. Sommer N. Junod Perron |
Communication interne, communication médecin-patient, enseignement. |
|
17 |
Revue Médicale Suisse |
Quelle place donner à la messagerie électronique dans la communication patients-médecins ? |
2004 |
J.-L. Vonnez |
Hopital, communication online, email. |
|
18 |
Revue Médicale Suisse |
La communication : un élément central en soins palliatifs |
2002 |
F. Stiefel, I. Rousselle et P. Guex |
Communication institutionnelle, communication médecin-patient, soins palliatifs. |
Les sujets analysés sont une liste de sujets ad hoc nous permettant de clarifier les contenus analysés
Tableau 5. Articles parus dans Medline
|
|
Revue |
Titre article |
Année |
Auteurs |
Sujets analysés |
|
1 |
Psychiatry Research |
Informal coercion as a neglected form of communication in psychiatric settings in Germany and Switzerland. |
2017 |
Elmer et al. |
Communication interne, communication interpersonnelle, psychiatrie. |
|
2 |
BMC Health Services Research |
Use of email, cell phone and text message between patients and primary-care physicians : cross-sectional study in a French-speaking part of Switzerland. |
2016 |
Dash et al. |
Communication interne, communication online, email. |
|
3 |
The UMSCH |
Telemedicine in Switzerland |
2015 |
Denz MD |
Hôpital, communication, télémédecine. |
|
4 |
Burns |
Evaluation of the online-presence (homepage) of burn units/burn centers in Germany, Austria and Switzerland. |
2012 |
Selig H. et al. |
Hôpital, communication online, page d’accueil. |
|
5 |
BMC Medical Education |
Self-assessment of intercultural communication skills: a survey of physicians and medical students in Geneva, Switzerland. |
2011 |
Hudelson P, Perron N, Perneger T. |
Hôpital, communication médecin-patient, interculturalité. |
Les sujets analysés sont une liste de sujets ad hoc nous permettant de clarifier les contenus analysés
Discussion
La communication institutionnelle dans le milieu hospitalier constitue une priorité stratégique pour toutes les organisations qui souhaitent renforcer leur image de marque (Medina, Lahmadi, 2012). Grâce à la communication, l’organisation peut améliorer ses rapports avec les parties prenantes dont elle dépend et renforcer son positionnement stratégique dans le marché (Anisimova, 2013). Malgré l’importance stratégique de la communication institutionnelle dans le milieu hospitalier, la communauté académique ne semble pas trop s’y intéresser. Plusieurs aspects permettent d’expliquer cette réalité.
En premier lieu, les Facultés de Communication des universités, qui sont très bien instaurées dans certains pays comme les Etats-Unis, ne sont pas très présentes dans d’autres pays, ce qui rend difficile le développement d’un axe de recherche portant sur la communication hospitalière. D’ailleurs, la plupart de ces Facultés proposent des formations en journalisme, lesquelles semblent ne pas répondre aux besoins des hôpitaux du point de vue de la communication institutionnelle. Par ailleurs, les autres Facultés de Médecine accusent un peu de retard dans l’instauration de cours obligatoires sur la communication institutionnelle, ce qui ne correspond pas avec les demandes des futurs professionnels de la santé. Ainsi, ces professionnels ont besoin de développer leurs habilités de communication interpersonnelle afin de mieux interagir avec les différents types des patients -différences culturelles, sociodémographiques, linguistiques, religieuses, etc.- et pouvoir ainsi leur offrir un service intégral du point de vue médical et humain (Dean, Oetzel, 2014).
En deuxième lieu, la plupart des hôpitaux accusent un certain retard dans le développement de structures formelles de communication institutionnelle (Kemp, Jilipalli, Becerra, 2014). Pendant des années, plusieurs organisations hospitalières n’ont pas eu besoin de développer leur image de marque ni leurs rapports avec les différents parties prenantes (Maier, 2016). Néanmoins, depuis plus de vingt ans, de plus en plus d’hôpitaux doivent faire face à différents problèmes de management comme par exemple le déficit budgétaire ; le disfonctionnement dans les processus internes de travail ; la concurrence grandissante entre les hôpitaux privés, publics et les groupes hospitaliers internationaux présents dans différents pays ; les nouvelles technologies de la communication et la cybersanté ; ou encore le rôle de plus en plus actif du patient lors des consultations médicales. Le nouveau contexte hospitalier oblige ces organisations à renforcer la gestion professionnelle de la communication : il existe un écart entre la diffusion de certains contenus de communication (magazines, sites web, etc.) et le travail stratégique réalisé par un département de communication. La création de ces structures formelles constitue l’un des défis prioritaires pour ces organisations (Martini, 2010).
Et, en troisième lieu, l’effectif limité de revues scientifiques spécialisées dans le domaine de la communication hospitalière a rendu difficile le développement de cet axe de recherche. Ainsi, à part les revues scientifiques analysées dans cette étude (Journal of Health Communication, Health Communication, Journal of Communication in Healthcare), il y a très peu de revues académiques qui portent sur le domaine de la communication hospitalière. Ces dernières années, dans certains pays d’Europe et d’Amérique Latine, plusieurs universités ont créé des revues dans le domaine, comme par exemple Revista Española de Comunicación y Salud (Université Carlos III à Madrid, Espagne) ou l’International Journal of Communication and Health (Université de Bucarest, Roumanie); néanmoins, il s’agit de revues qui ne mobilisent pas encore la communauté académique puisqu’elles ne sont pas encore bien classées dans les bases de données (Thompson Reuters, Ebsco, etc.).
Ces trois aspects présents dans la plupart des pays rendent très difficile le développement de la communication hospitalière comme un axe stratégique de recherche scientifique. En Suisse, comme dans la plupart des pays, ces trois aspects sont aussi présents. Les données analysées dans cet article montrent que dans les quatre revues scientifiques de référence internationale, il n’y a aucune publication sur les stratégies de communication institutionnelle que les hôpitaux suisses mettent en place pour renforcer leur marque et ainsi l’image perçue par les différents parties prenantes (patients, médias, autorités publiques, etc.). Même si certains auteurs ont publié des articles sur la communication interpersonnelle ou la communication interne dans le milieu hospitalier suisse, le vrai enjeu de la communication hospitalière réside dans la définition de stratégies globales de communication institutionnelle qui visent la création d’une marque solide capable d’aider l’hôpital à renforcer son positionnement stratégique dans le marché des soins sur le long terme. En ce qui concerne les deux revues suisses (Swiss Medical Weekly, Revue Médicale Suisse) et la base de donnée Medline, la plupart des articles portent aussi sur la communication interne et, surtout, la communication médecin-patient, ce qui met en évidence une carence de travaux sur l’approche stratégique de la communication institutionnelle en milieu hospitalier.
Malgré la situation actuelle, la Suisse constitue l’un des meilleurs pays au monde pour devenir une référence internationale dans la recherche sur la communication institutionnelle dans les hôpitaux. Trois raisons permettent d’asseoir cette affirmation. En premier lieu, la Suisse accueille de nombreuses organisations internationales dans le domaine de la santé, comme par exemple l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Médecins Sans Frontières (MSF), le Comité International de la Croix Rouge (CICR), Alliance Mondiale pour les Vaccins et la Vaccination (GAVI), Fond Mondial ou encore OnuSida. Le leadership international de ces organisations peut contribuer favorablement au développement de cette recherche, non seulement en Suisse, mais aussi dans tous les pays où ces organismes internationaux sont présents. En deuxième lieu, les universités suisses sont très réputées au niveau international, ce qui facilite la mise en oeuvre de plans de recherche transversaux sur ce domaine. Ainsi, selon le Classement de Shanghai 2017, parmi les 100 meilleures universités au monde, il y a 5 universités helvétiques : Ecole Fédérale Polytechnique de Zurich (19), Université de Zurich (58), Université de Genève (60), Ecole Fédérale Polytechnique de Lausanne (76) et Université de Bale (95). Et, en troisième lieu, depuis des années, le système hospitalier suisse est classé parmi les meilleurs systèmes de santé au monde (GBD, 2017). Les hôpitaux à renommée internationale, comme le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois ou les Hopitaux Universitaires de Genève, peuvent mener, en collaboration avec les universités, des projets de recherche sur la communication institutionnelle des hôpitaux.
Malgré l’intérêt de cette étude, nous pouvons signaler quelques limitations. En premier lieu, l’absence d’informations sur la production scientifique d’autres pays dans le domaine de la communication institutionnelle dans les hôpitaux. Ce manque d’information rend difficile les comparaisons avec la situation de la Suisse. En deuxième lieu, le manque d’informations concernant les axes stratégiques de recherche dans les différentes universités de Suisse, autrement dit, les sujets d’analyse prioritaires, les approches suivies, les revues internationales où les chercheurs soumettent leurs travaux, etc. En troisième lieu, le manque d’informations sur l’origine géographique et les universités d’affiliation des chercheurs qui ont publié dans les différentes revues scientifiques considérées dans cette étude depuis 1997 jusqu’à 2017. Et, finalement, en quatrième lieu, il s’avère compliqué de bien utiliser les différents mots-clés pour trouver une liste précise des articles portant sur la communication santé en Suisse, vu que, souvent, les chercheurs ne sont pas très précis au moment de choisir les dits mots.
Conclusion
L’analyse de la production scientifique depuis 1997 jusqu’à 2017 par les revues de référence dans le domaine de la communication institutionnelle dans les hôpitaux, autant au niveau international (Journal of Health Communication, Health Communication, Journal of Communication in Healthcare, The American Journal of Public Health) que national (Swiss Medical Weekly, Revue Médicale Suisse), met en évidence l’absence de travaux scientifiques sur la communication institutionnelle dans les hôpitaux suisses. Afin de conclure ce texte, nous apportons trois dernières réflexions. En premier lieu, la recherche académique en Suisse sur la communication institutionnelle dans les hôpitaux n’est pas diffusée dans les meilleures revues scientifiques dans ce domaine au niveau international, ce qui rend difficile la visibilité des chercheurs travaillant sur ce domaine. En deuxième lieu, les quatre revues scientifiques de référence internationale analysées dans cet article, priorisent la publication d’articles portant sur des pathologies, traitements et problèmes de santé qui ont lieu dans certains pays, notamment les Etats-Unis, l’Angleterre et le Canada. Et, en troisième lieu, les deux revues suisses considérées dans cette étude montrent un intérêt marqué envers la communication interne et interpersonnelle, mais non pas envers la gestion stratégique de la communication institutionnelle dans le milieu hospitalier. Dans les prochaines années, les travaux des chercheurs devraient tendre à combler ces lacunes.
Bibliographie
Abramson, Karley; Keefe, Brian; Chou, Wen-Ying (2015). Communicating About Cancer Through Facebook: A Qualitative Analysis of a Breast Cancer Awareness Page. Journal of Health Communication, 20 (2): 237-243. Doi: 10.1080/10810730.2014.927034.
Al-Abri, Rashid; Al-Balushi, Amina (2014). Patient Satisfaction Survey as a Tool Towards Quality Improvement. Oman Medical Journal, 29 (1):3-7. Doi: 10. 5001/omj.2014.02.
Anisimova, Tatiana (2013). Evaluating the impact of corporate brand on consumer satisfaction. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 25 (4): 561-589. Doi: 10.1108/APJML-12-2012-0132.
Brent, Ruben (2016). Communication Theory and Health Communication Practice: The More Things Change, the More They Stay the Same. Health Communication, 31 (1): 1-11, Doi: 10.1080/10410236.2014.923086.
Bureau, Eve; Herman-Mesfen, Judith (2014). Les patients contemporains face à la démocratie sanitaire. Anthropologie & Santé, 8: 1-15.
Burleson, Debra (2014). Communication Challenges in the Hospital Setting: A Comparative Case Study of Hospitalists and Patients’ Perception. Journal of Business and Technical Communication, 28(2): 187-221. Doi: 10.1177/1050651913513901.
D’Agostino, Thomas; Bylund, Carma (2014). Nonverbal Accommodation in Health Care Communication. Health Communication, 29 (6): 563-573. DOI: 10.1080/10410236.2013.783773.
Dean, Marleah; Oetzel, John (2014). Physicians’ Perspectives of Managing Tensions Around Dimensions of Effective Communication in the Emergency Department. Health Communication, 29 (3): 257-266. Doi: 10.1080/10410236.2012.743869.
Esposito, Annamaria (2017). Hospital branding in Italy: A pilot study based on the case method. Health Marketing Quarterly, 34 (1): 35-47. DOI: 10.1080/07359683.2016.1275211.
Fischer, Sophia (2014). Hospital Positioning and Integrated Hospital Marketing Communications: State-of-the-Art Review, Conceptual Framework, and Research Agenda. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 26 (1): 1-34. Doi: 10.1080/10495142.2014.870431.
Gilligan, C.; James, EL.; Snow, P.; Outram, S.; Ward, BM.; Powell, M.; Lonsdale, C.; Cushing, AM.; Silverman, J.; Regan, T.; Harvey, P.; Lynagh, MC. (2016). Interventions for improving medical students’ interpersonal communication in medical consultations. Cochrane Database of Systematic Reviews 11, CD012418.
Global Burden of Disease (GBD) (2017). Healthcare Access and Quality Index based on mortality from causes amenable to personal health care in 195 countries and territories, 1990–2015: Healthcare a novel analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet, 390, 100091: 231-266. Doi: DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30818-8
Hannawa, Annegret; García-Jiménez, Leonarda; Candrian, Carey; Rossmann, Constanze; Schulz, Peter (2015). Identifying the Field of Health Communication. Journal of Health Communication, 20 (5): 521-530. DOI: 10.1080/10810730.2014.999891.
Househ, Mowafa; Borycki, Elizabeth; Kushniruk, Andre (2014). Empowering patients through social media: The benefits and challenges. Health Informatics Journal, 20 (1): 50-58. Doi: 10.1177/1460458213476969.
Kemp, Elyria; Jillapalli, Ravi; Becerra, Enrique (2014). Healthcare branding: developing emotionally based consumer brand relationships. Journal of Services Marketing, 28 (2): 126 – 137. Doi: http://dx.doi.org/10.1108/JSM-08-2012-0157.
Kreps, Gary; Query, Jim; Bonaguro, Ellen (2007). The interdisciplinary study of health communication and its relationship to communication science. In L. Lederman (Ed.), Beyond these walls: Readings in health communication (pp. 2–13). Los Angeles: Roxbury. ISBN: 0195332504.
Labrie, Nanon; Schulz, Peter (2014). Does Argumentation Matter? A Systematic Literature Review on the Role of Argumentation in Doctor–Patient Communication. Health Communication, 29 (10): 996-1008. Doi: 10.1080/10410236.2013.829018.
Maier, Craig (2016). Beyond Branding: Van Riel and Fombrun’s Corporate Communication Theory in the Human Services Sector. Qualitative Research Reports in Communication, 17 (1): 27-35. Doi: 10.1080/17459435.2015.1088892.
Martini, Marina (2010). Communication — An important management task in the hospital market. Journal of Management & Marketing in Healthcare, 3 (1): 9-12. Doi: 10.1179/175330310X12665775636346.
McCarroll, Michele; Armbruster, Shannon; Chung, Jae; Kim, Junghyun; McKenzie, Alissa; Von Gruenigen, Vivian (2014). Health Care and Social Media Platforms in Hospitals. Health Communication, 29 (9): 947-952. Doi: 10.1080/10410236.2013.813831.
Medina Aguerrebere, Pablo (2013). La diffusion de l’identité de l’hôpital à travers la communication interne. Quaderni, 81 : 95-103. Doi: 10.4000/quaderni.719.
Medina Aguerrebere, Pablo; Lahmadi, Ghizlaine (2012). La dimension communicationnelle du management hospitalier. Communication et Organisation, 41 : 157-168. Doi : 10.4000/communicationorganisation.3790.
Moorhead, Anne; Hazlett, Diane; Harrison, Laura; Carroll, Jennifer; Irwin, Anthea; Hoving, Ciska (2013). A New Dimension of Health Care: Systematic Review of the Uses, Benefits, and Limitations of Social Media for Health Communication. Journal of Medical Internet Research, 15 (4): e85. Doi: 10.2196/jmir.1933.
Moser, Ronald; Greeman, Gordon (2014). An Empirical Analysis of the Public’s Attitudes Toward Advertising Hospital Services: A Comparative Cross-Sectional Study. Health Marketing Quarterly, 31:13–30. Doi: 10.1080/07359683.2013.847334.
Nanda, Sibabrata; Telang, Achyut; Bhatt, Gaurav (2012). Hospital advertising: A literature review. International Journal of Healthcare Management, 5 (1): 28-31. Doi: 10.1179/2047971911Y.0000000002.
Naveen , Kumar; Anil, Jacob; Smruthi, Thota (2014). Impact of healthcare marketing and branding on hospital services. International Journal of Research Foundation of Hospital & Healthcare Administration, 2 (1): 19-24. Doi: 10.5005/jp-journals-10035-1010.
Nazione, Samantha; Pace, Kristin; Russell, Jessica; Silk, Kami (2013). A 10 Year Content Analysis of Original Research Articles Published in Health Communication and Journal of Health Communication (2000–2009). Journal of Health Communication, 18 (2): 223-240, Doi: 10.1080/10810730.2012.688253.
Ruiz-Granja, María José (2015). Análisis comunicacional de páginas web hospitalarias. El caso de los hospitales sevillanos. Revista Española de Comunicación y Salud, 6(2): 138-156.
Vinodhini, Y. ; Kumar, B. (2010). Brand equity in hospital marketing. Summer Internship Society, 2 (1): 89-93.
Wang, Yu-Che; Hsu, Kuei-Chu; Hsu, Sheng-Hsun; Hsieh, Po-An (2011). Constructing an index for brand equity: a hospital example. The Service Industries Journal, 31 (2): 311-322. Doi: 10.1080/02642060902759145.
Weberling McKeever, Brooke (2014). The Status of Health Communication: Education and Employment Outlook for a Growing Field. Journal of Health Communication, 19 (12): 1408-1423. Doi: 10.1080/10810730.2014.904024.
Welch, Mary; Jackson, Paul (2007). Rethinking internal communication: a stakeholder approach. Corporate Communications: An International Journal, 12 (2): 177-198. Doi: https:// doi.org/10.1108/13563280710744847.
Zerfass, Ansgar; Viertmann, Christine (2017). Creating business value through corporate communication: A theory-based framework and its practical application. Journal of Communication Management 21 (1): 68-81. Doi: https://doi.org/10.1108/JCOM-07-2016-0059.
- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires
Les 100 ans de la filière Information documentaire de la HEG-Genève : numéro spécial de RESSI à paraître
Ressi — 20 décembre 2018
Hélène Madinier, Haute Ecole de Gestion, Geneve
Les 100 ans de la filière Information documentaire de la HEG-Genève : numéro spécial de RESSI à paraître
En juin 2018, la filière Information documentaire de la Haute Ecole de Gestion de Genève fêtait ses 100 ans d’existence.
Durant cinq jours de conférences, d’ateliers, de témoignages, de visites, et même de suivi d’un escape game, des professionnels de toute la Suisse et de la francophonie ont échangé sur l’évolution des nombreux métiers du domaine de la gestion de l’information.
Chaque professeur de la filière Information documentaire a consacré une demi-journée du jubilé à sa spécialité, en donnant la parole à des intervenants représentatifs des divers profils liés à la filière.
Parmi les interventions à relever, celle de Mathilde Servet sur la bibliothèque 3ème lieu, l’archivage du web à la BnF présenté par Marie Chouleur, les différents métiers des Data, dont le focus de Martin Grandjean, Data Historian, qui a présenté les réseaux de connaissance informels à la société des Nations comme exemple de la « mise en données » de l’histoire. Mais aussi les nouvelles compétences des veilleurs expliquées par Véronique Mesguich, le support aux chercheurs dans la gestion des données de la recherche à l’Université de Genève présenté par Pierre-Yves Burgi, la visite guidée à la Fondation Bodmer et les différentes présentations sur les outils permettant l’accès à l’information.
Cette semaine tournée à la fois sur l’avenir des métiers de l’information et sur le passé de la formation, mis en avant par une exposition réalisée par les étudiants, a permis de réunir plus de 400 professionnels et étudiants.
Ce jubilé a été organisé avec l'aide d’une trentaine d’étudiants de 2ème année de bachelor de la filière Information documentaire.
Un numéro spécial de RESSI, à paraître début 2019, sera justement consacré à cet événement : il reviendra sur les évolutions de la filière à travers une chronologie commentée, des interviews et le développement de l’informatique documentaire, et il rendra compte des différentes interventions de chaque demi-journée.
- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires
N°19 décembre 2018
Ressi — 20 décembre 2018
Sommaire - N° 19, Décembre 2018
Articles de recherche :
-
La contribution suisse dans la recherche sur la communication institutionnelle dans les hôpitaux - Pablo Medina Aguerrebere et Emmanuel Kabengele
-
La Perspective du Continuum des archives illustrée par l’exemple d’un document personnel - Viviane Frings-Hessami
Comptes-rendus d'expériences :
-
Renouvaud : de la gestion de projet à la coordination du réseau vaudois des bibliothèques - Jeannette Frey et Piergiuseppe Esposito
- Des ebooks dans sa poche : projet de valorisation de la col-lection numérique de la Bibliothèque de l’UNIGE - Pablo Iriarte, Aurélie Vieux et Marc Meury
-
Apprentissage et classification automatiques pour améliorer la pertinence d'un corpus d’articles - Julien Gobeill, Matthias van den Heuvel, Laura Minu Nowzohour, Joëlle Noailly, Gaétan de Rassenfosse et Patrick Ruch
- Conserver et valoriser les archives de la Société des Arts de Genève - Sylvain Wenger
-
Les bibliothèques de la Communauté du savoir - Agnès Dervaux-Duquenne
- Demain sera mieux qu’aujourd’hui : évolution des rôles et missions du bibliothécaire - Matthieu Cevey et Michel Gorin
Comptes-rendus d'événements :
-
Conférence nationale Open Access - Benoìt Epron
- Quelle veille pour les start-ups ? compte rendu de la 15ème journée franco-suisse sur la veille stratégique et l’intelligence économique, 14 juin 2018, Besançon - Hélène Madinier
-
Les 100 ans de la filière Information documentaire de la HEG-Genève : numéro spécial de RESSI à paraître - Hélène Madinier
Recensions :
-
Cinquante ans de numérique en bibliothèque - Alexis Rivier
- Rechercher l’information stratégique sur le web : sourcing, veille et analyse à l’heure de la révolution numérique - Claire Wuillemin
-
Consommer l’information : de la gestion à la médiation documentaire - Siham Alaoui
- Service Science and the Information Professional - Tullio Basaglia
- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires
Editorial
Ressi — 20 décembre 2018
Comité RESSI
Editorial n°19
C’est un numéro 19 très riche en contributions que nous avons le plaisir de vous proposer.
Dans la rubrique « Etudes et Recherches », vous trouverez un premier article recensant la production scientifique sur la communication hospitalière. Intitulé La contribution suisse dans la recherche sur la communication institutionnelle dans les hôpitaux et signé Pablo Medina Aguerrebere et Emmanuel Kabengele, respectivement assistant de recherche et professeur à l’Institut de Santé Globale, de la Faculté de Médecine de l’Université de Genève, il arrive à la conclusion que la production suisse sur le sujet est encore peu présente.
La deuxième contribution est signée Viviane Frings-Hessami, chargée de cours à l’université de Monash, en Australie. Intitulé La Perspective du Continuum des archives illustré par l’exemple d’un document personnel, il explicite de manière très concrète une nouvelle approche du cycle de vie des données, le records continuum, au travers d’une photo de famille.
Dans la rubrique « Comptes rendus d’expérience », nous vous proposons six contributions.
La première est signée Jeannette Frey, Directrice de la BCU Lausanne, Présidente de Renouvaud et Piergiuseppe Esposito, chargé de mission à la BCU de Lausanne. Intitulé Renouvaud : de la gestion de projet à la coordination du réseau vaudois des bibliothèques, il détaille les étapes et les méthodes ayant permis à l’ensemble des bibliothèques vaudoises (plus de 100 jusqu’à présent), de migrer de Rero vers le système Alma au sein du réseau Renouvaud. C’est un projet mené en deux ans, d’une ampleur sans précédent, et qui a comporté plusieurs dimensions : organisationnelle, informatique et bibliothéconomique.
La deuxième, rédigée par Aurélie Vieux, Pablo Iriarte et Marc Meury, collaborateurs à la Division de l’information scientifique de l’Université de Genève, est intitulée Des e-books dans sa poche : projet de valorisation de la collection numérique de la Bibliothèque de l’Université de Genève. Elle décrit le projet d’harmonisation de la valorisation des ressources numériques entre les différents sites des bibliothèques de l’Université de Genève, grâce à la création de l’Application de valorisation numérique “Avalon”, qui simplifie le processus de création des supports de valorisation, optimisant ainsi la visibilité des ressources numériques.
La troisième contribution émane de Julien Gobeill et Patrick Ruch, respectivement chargé de cours et professeur ordinaire à la HEG-Genève, et membres de l’Institut suisse de bio-informatique, Matthias van den Heuvel et Gaétan de Rassenfosse, respectivement doctorant et professeur à l’EPFL, ainsi que Laura Minu Nowzohour et Joëlle Noailly, respectivement doctorante et professeure à l’IHEID à Genève. Intitulé Apprentissage et classification automatiques pour améliorer la pertinence d’un corpus d’articles, il explique avec un exemple comment utiliser la fouille de textes (text mining) pour aider le spécialiste en recherche documentaire dans une activité de constitution de corpus, tout spécialement avec des masses d’informations importantes.
La quatrième contribution est signée par Sylvain Wenger, Directeur de projet de la Valorisation du patrimoine et de la promotion de la recherche auprès de la Société des Arts et intitulée Conserver et valoriser les archives de la Société des Arts de Genève. Il y décrit les enjeux et étapes du projet de mise en place, depuis 2016, des actions de valorisation de cette Société, fondée en 1776 pour la promotion de l’économie locale, actions destinées à la communauté de la recherche et à un public plus large, dont les résultats sont attendus pour 2019-2020.
La cinquième contribution, intitulée Les bibliothèques de la Communauté du Savoir, et signée Agnès Dervaux-Duquenne, bibliothécaire responsable de la Haute Ecole Arc Ingénierie à Neuchâtel, décrit les actions de collaboration – et leurs bénéfices - mises en œuvre par les bibliothèques de Communauté du savoir, réseau visant à renforcer, valoriser et stimuler les collaborations franco-suisses dans l'Arc jurassien (incluant la Franche-Comté et les cantons de Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud côté Suisse), en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation.
La sixième contribution est due à Michel Gorin et Matthieu Cevey, respectivement maître d’enseignement et assistant d’enseignement à la Haute Ecole de Gestion de Genève. Intitulée Demain est mieux qu’aujourd’hui : évolution des rôles et missions des bibliothèques, elle constitue le reflet d’une intervention faite par ses auteurs lors du Congrès des professionnels de l’information de Montréal, organisé du 12 au 14 novembre 2018 et centré sur le thème : « Les professionnel-le-s de l’information, actrices et acteurs de changement ». Ils font tout d’abord état de l’importance des bibliothèques comme garantes de la démocratie en tirant un parallèle avec l’initiative populaire suisse « No Billag ». Ensuite, reconnaissant la nécessité, pour les bibliothécaires, de s’adapter aux mutations en cours, ils proposent un modèle de « bibliothèque-plateforme », basé sur le récent travail de bachelor d’un étudiant.
Dans la rubrique « Compte rendu d’événement », on trouvera deux contributions principales et la mention d’une recension à venir.
La première, signée Benoît Epron, professeur associé à la HEG-Genève et intitulée Conférence nationale Open access, rend compte de la journée organisée le 26 octobre 2018 par swissuniversities à l'Université de Lausanne, qui faisait le point sur l'open access en Suisse en abordant ses aspects académiques, économiques et politiques.
La deuxième contribution rend compte de la dernière Journée franco-suisse sur la veille stratégique et l'intelligence économique, la 15ème, qui a eu lieu le 12 juin 2018 à Besançon sur le thème: Quelle veille pour les start-ups ? Signée par Hélène Madinier, professeure associée à la HEG-Genève, il rend compte des différentes interventions de nature théorique et sous forme de témoignages de start-ups, ainsi que d’une démonstration de méthode de recherche d’information pour une start-up faite en direct par un consultant.
La troisième est une annonce du numéro spécial de RESSI, faite par le Comité de rédaction, à l’occasion des 100 ans de la filière Information documentaire de la HEG-Genève. Cet anniversaire a été l’occasion de diverses conférences et autres manifestations qui ont eu lieu en juin 2018, qui seront résumées, avec photos, chronologie, articles récapitulatifs, prospectifs et interviews, dans un numéro spécial de RESSI à paraître début 2019.
Finalement, on trouvera quatre recensions d’ouvrages.
La première recension est écrite par Alexis Rivier, Conservateur des ressources numériques et des périodiques à la Bibliothèque de Genève, et rend compte de l’ouvrage d’Yves Desrichard Cinquante ans de numérique en bibliothèque. Publié en 2017, ce livre articule le numérique en bibliothèque en cinq « temps », couvrant chacun à peu près une décennie, et décrit les transformations des bibliothèques – encore à venir - induites par l’arrivée de l’informatique.
La deuxième recension émane de Claire Wuillemin, assistante d’enseignement à la HEG-Genève, et rend compte de l’ouvrage de Véronique Mesguich, Rechercher l’information stratégique sur le web : sourcing, veille et analyse à l’heure de la révolution numérique. Publié en 2018, ce livre fait un point essentiel sur l’évolution de Google et des moteurs de recherche. Il donne des clés pour la recherche d’information et l’évaluation de la qualité de l’information, en visant le développement d’une véritable littératie numérique.
Le troisième compte rendu d’ouvrage est signé Siham Alaoui, étudiante au doctorat en archivistique à l’Université Laval du Québec, et recense le livre Consommer l’information : de la gestion à la médiation documentaire, de Martine Cardin et Anne Klein, publié en 2018 aux Presses de l’Université Laval. Il décrit la nouvelle approche de l’archivistique, soit celle de l’archivistique ouverte, résultant de l’interdisciplinarité entre l’archivistique et le marketing ouvert.
Enfin, le quatrième compte rendu, sous la plume de Tullio Basaglia, chef de section de la bibliothèque du CERN à Genève, rend compte de l’ouvrage en anglais d’Yvonne de Grandbois - qui a fait sa carrière de professionnelle de l’information en Suisse romande- Service Science and the Information Professional, publié en 2016. Ce livre offre un aperçu succinct mais complet de la discipline qu’est la science des services, et il souligne l’importance de cette dernière pour les professionnels de l’information.
Nous vous souhaitons une très bonne lecture et nous remercions vivement les auteurs de cette édition, ainsi que les fidèles réviseurs, ainsi que ceux et celles qui ont contribué à la mise en ligne de RESSI.
Le Comité de rédaction
- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires
Renouvaud : de la gestion de projet à la coordination du réseau vaudois des bibliothèques
Ressi — 20 décembre 2018
Jeannette Frey, Directrice BCU Lausanne, Présidente Renouvaud
Piergiuseppe Esposito, Chargé de missions BCU Lausanne
Résumé
En 2014, le Canton de Vaud décide de quitter RERO, le réseau des bibliothèques de Suisse occidentale, pour migrer vers de nouvelles technologies cloud. La Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne va utiliser la méthode de gestion de projets HERMES, développée par la Confédération. Elle renonce à passer aux règles de catalogage RDA, conserve le format MARC21. Elle complète le cahier des charges GEMEVAL, élaboré par RERO, IDS et la BNS, pour lancer un appel d'offres qui aboutit à la sélection du système Alma de l’entreprise Ex Libris. Le contrat est signé à la fin de l'été 2015. Le programme, intitulé Renouvaud, se compose de trois sous-projets : organisationnel, informatique et bibliothéconomique. Il englobe, à peu d'exceptions près, toutes les bibliothèques du Canton de Vaud : patrimoniales, scientifiques, scolaires et lecture publique. Le réseau Renouvaud est opérationnel dès le 22 août 2016. Considérant que le projet national SLSP a choisi la même solution informatique (Alma), Renouvaud devrait être à même de coopérer avec lui. Renouvaud a tenu les délais fixés en respectant le budget voté. Fin 2017, il offre plus de 3,5 millions de documents imprimés et presque 1 million de documents numériques.
Renouvaud : de la gestion de projet à la coordination du réseau vaudois des bibliothèques [1]
Historique de la décision vaudoise
Le projet Renouvaud a été initié suite à la décision du canton de Vaud de quitter RERO (REseau ROmand, réseau des bibliothèques de Suisse occidentale). Le 14 mars 2014, la Conseillère d’État Anne-Catherine Lyon, cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), annonçait à la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), organe titulaire de RERO, que le canton de Vaud se dédisait de la convention intercantonale RERO à fin 2016[2]. Cette décision était motivée par l’impossibilité de trouver une nouvelle gouvernance pour RERO après 8 ans de tractations, ce qui bloquait l’investissement pour le passage à de nouvelles technologies cloud. Plusieurs solutions pour la gouvernance avaient été étudiées, le concordat intercantonal, puis l’option de créer une association, sans succès. Au terme de nombreuses discussions et de longs blocages, la Conseillère d’État constatait que RERO était devenu pénalisant pour le réseau vaudois et la Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne, en particulier pour répondre aux demandes pressantes des utilisateurs universitaires. Le 17 mars 2014, la Direction de la BCU Lausanne répercutait la nouvelle de la dédite de la convention auprès de l’ensemble de ses collaborateurs ainsi qu’aux partenaires des bibliothèques vaudoises membres de RERO.
Mandat donné par le politique pour Renouvaud
Donnant suite à cette décision, le DFJC émettait en avril 2014 un mandat de reprise de la gestion du réseau vaudois par la BCU Lausanne à la sortie du canton de Vaud de RERO, soit au 1er janvier 2017. Le mandat détaille les objectifs généraux et spécifiques du projet Renouvaud. À la fin du projet, la BCU Lausanne devait se trouver en mesure d’offrir une solution de gestion effective et efficiente du réseau, au point de vue organisationnel, financier et métier et avoir mis en place un système de gestion intégré de bibliothèque (SIGB) dans le cloud, permettant aux bibliothèques vaudoises de collaborer entre elles et avec d’autres réseaux suisses et francophones, ainsi qu’avec la Bibliothèque Nationale Suisse (BNS). Le mandat prévoyait également que la BCU Lausanne propose au DFJC une gouvernance pour le réseau vaudois ainsi qu’un nouveau business model avec des flux d’argent simples et transparents. Le défi était de taille en raison des délais imposés.
La gestion de grands projets à la BCU Lausanne
Pour la gestion de ses projets, la BCU Lausanne a recours à la méthode de gestion de projets HERMES, développée par l’Unité de pilotage informatique de la Confédération[3]. L’organigramme, les rôles, le phasage et planning ont donc été mis en place selon cette méthode. Le pilotage et la conduite reposent sur deux instances : un comité de pilotage (CoPil) et un comité de projet (CoPro).
Éléments de la méthode HERMES 5
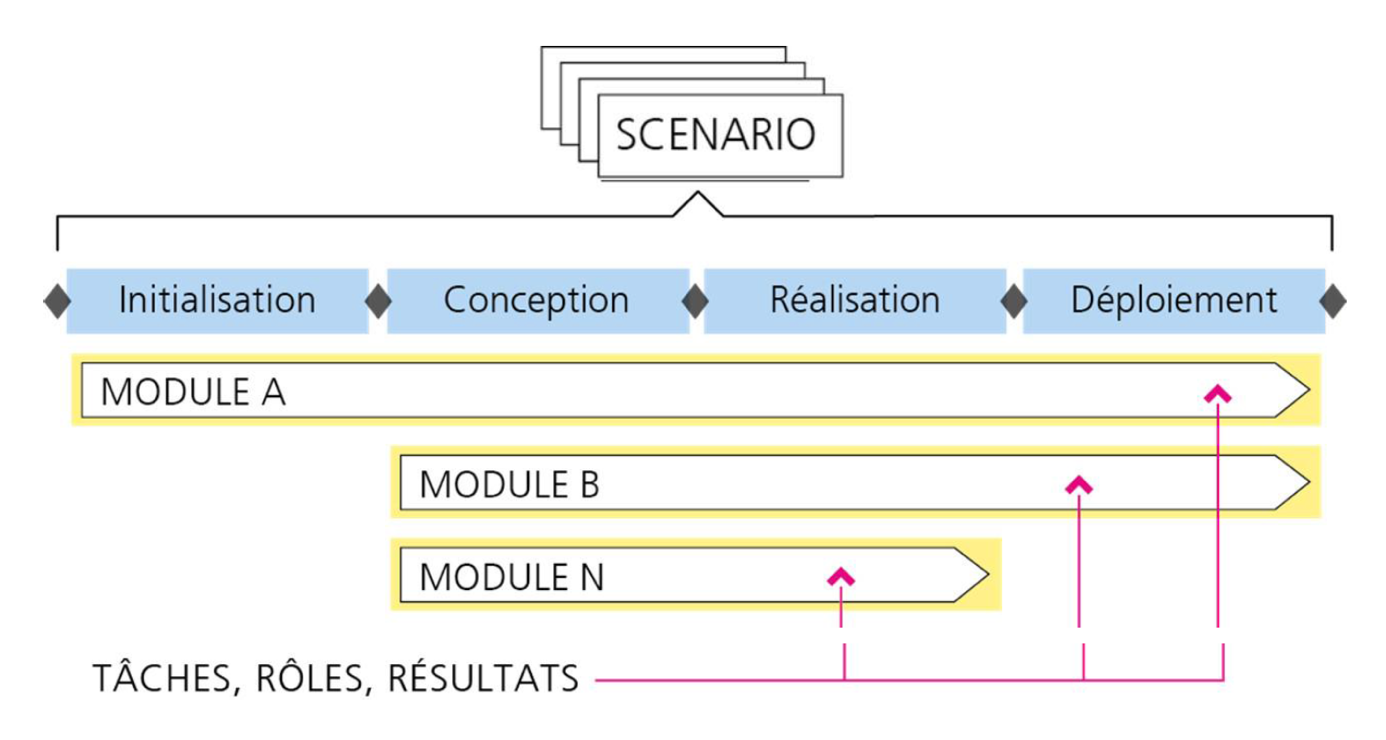
Source : Manuel de référence HERMES 5.1 (repli cartonné de couverture)
Principes de base pour la mise en place du réseau Renouvaud
La BCU Lausanne a lancé le projet Renouvaud avec l’objectif d’implémenter les outils, services et processus de travail nécessaires à la reprise des fonctionnalités couvertes pour le réseau vaudois par les anciens outils de RERO, et de les compléter avec des fonctionnalités pour lesquelles le réseau vaudois n’avait pas reçu de réponses de RERO au cours des années précédentes – en particulier l’acquisition, la gestion et la mise à disposition des ressources numériques. Déjà au sein de RERO, la BCU Lausanne assurait pour les bibliothèques vaudoises la gestion d’un certain nombre de processus : bon nombre de formations dispensées, la participation aux groupes de travail et aux task forces, etc.).
La reprise complète de la gestion du réseau vaudois nécessitait cependant d’étudier les processus de travail partagés existants entre la Centrale RERO et la Coordination locale vaudoise, ainsi que de cartographier les processus de travail à créer pour compléter l’existant, un travail qui a été fait dans le cadre de la phase d’analyse préliminaire.
Plusieurs scénarios ont été élaborés, avec ou sans modification des règles de catalogage et du format de métadonnées lors de la migration des données.
Au-delà de leur utilisation au sein de RERO, les règles AACR2 (règles de catalogage anglo-américaines) constituaient alors l’ensemble structuré de règles de catalogage le plus usité dans le monde, traduit dans de nombreuses langues. Un mandat de veille prioritaire fut confié à un groupe de travail composé d’experts en catalogage afin d’évaluer l’impact et la faisabilité d’un passage aux normes RDA / FRBR durant la phase de conception du projet. Il en ressortit que le RDA n’était pas encore abouti, que la traduction française avait été interrompue et que la France ne prévoyait pas une transition dans un futur proche.
Finalement, ce fut le scénario impliquant un changement de SIGB sans passage aux règles de catalogage RDA, et sans modification du format des notices MARC21 vers un modèle FRBR qui fut choisi, en raison d’une part des délais de réalisation et de mise en œuvre très serrés et d’autre part parce que cela réduisait considérablement la complexité du projet.
Le cahier des charges Renouvaud
En ce qui concerne le cahier des charges, le projet Renouvaud ne partait pas de rien. De 2009 à 2012, RERO, IDS et la BNS avaient mené le projet GEMEVAL (Gemeinsame Evaluation eines neuen Bibliothekssystems), au cours duquel un cahier des charges commun avait été ébauché. Un appel d’offres commun n’avait cependant pas pu être envisagé, notamment en raison du fait que pour les partenaires IDS, chaque canton aurait dû être partenaire et valideur de l’appel d’offres public, ce qui semblait impraticable.
Après l’initialisation du projet Renouvaud, l’ébauche de cahier des charges issue de GEMEVAL a donc été reprise et complétée par un recueil exhaustif des besoins des membres du réseau vaudois, afin d’offrir un tableau synthétique des éléments principaux devant être couverts par un appel d’offres public. Les spécialistes de chaque domaine ont participé à la rédaction en détail de tous les points. La récolte des informations s’est déroulée par tandem de deux personnes : une personne en charge de la rédaction du besoin et une personne en charge de la relecture du besoin.
On remarquera que la description de la solution cible comprend des fonctions requises (obligatoires), des fonctions additionnelles souhaitables (optionnelles) et des fonctions facultatives (Nice to have). Cette différentiation résulte des conditions-cadres des appels d’offres publics. Les fonctions facultatives sont par exemple des points présentant un intérêt, mais hors périmètre du projet tel qu’évalué dans le cadre de l’appel d’offres public.
Les fonctionnalités standards étaient regroupées en sept modules pour décrire l’architecture fonctionnelle : acquisitions, catalogage, périodiques, lecteurs, circulation, statistiques et catalogue public. Les exigences du système, autant fonctionnelles que non fonctionnelles, ont été modélisées selon le formalisme UML des cas d’utilisation (Use Case). Les cas d’utilisation ainsi obtenus sont regroupés dans des modules qui eux-mêmes sont regroupés dans des thèmes. Pour chaque module précité, les exigences requises sont jugées indispensables pour le démarrage de l’exploitation du SIGB au 1er janvier 2017, tandis que les fonctionnalités souhaitées peuvent être mises à disposition des usagers dans un second temps.
L’appel d’offres public – état du marché du SIGB cloud en 2014
La rédaction du cahier des charges fut effectuée dans un temps record durant l’été 2014, ce qui permit de lancer l’appel d’offres public à l’automne 2014. L’objet du marché était d’acquérir et déployer un SIGB couvrant l’ensemble des besoins des bibliothèques du réseau vaudois ainsi que la fourniture de prestations associées. Le périmètre de l’offre comprenait la fourniture et la maintenance d’un SIGB dans le cloud, incluant la mise à disposition et la maintenance de deux environnements (soit production et test), ainsi que la formation de l’équipe de projet et des formateurs eux-mêmes.
Le marché a été adjugé sur la base des cinq critères d’évaluation suivants (avec leurs pondérations) : prix total de l’offre (30%), organisation pour l’exécution du marché (15%), qualité fonctionnelle et technique (30%), organisation de base du soumissionnaire (15%) et références du soumissionnaire (10%).
Négociations avec Ex Libris : quelques constats
La BCU Lausanne a reçu cinq offres dont deux durent être rejetées en raison du non-respect des conditions de forme et de participation. Sur les trois offres retenues, le choix de la solution Alma - Primo de la société Ex Libris présentait le rapport qualité-prix le plus avantageux. Alma est une solution cloud de SIGB dernière génération permettant une gestion unifiée de toutes les ressources documentaires, imprimées, multimédias et électroniques. Orienté processus, le logiciel propose des outils de gestion puissants et personnalisables, bien adaptés à un réseau de bibliothèques tel que le réseau vaudois. Primo est l’outil de découverte utilisé pour accéder au catalogue permettant l’accès direct à tout le contenu proposé par les bibliothèques du réseau ; cet outil était déjà connu des bibliothèques vaudoises dans la mesure où il s’agit de la solution à la base du portail Explore de RERO.
L’adjudication du marché fut suivie d’une assez longue phase de négociation. Pour ces formulations juridiques pointues, l’équipe de projet put s’appuyer sur le Service juridique et législatif (SJL) de l’État de Vaud, qui apporta une contribution fondamentale en termes de rédaction et de relecture du contrat. Après plusieurs tours de négociation, le contrat put être signé entre l’État de Vaud et Ex Libris à la fin d’été 2015, avec un démarrage officiel des activités de projet avec le fournisseur fixé au mois de septembre. En attendant, un premier workshop avec deux personnes d’Ex Libris – un chef de projet et un spécialiste de l’équipe d’implémentation du logiciel – fut organisé durant l’été 2015 à la BCU Lausanne, workshop au cours duquel le processus de migration des données fut discuté et la date du go-live confirmée au 22 août 2016.
Dès lors commença le long travail de description détaillée de l’implémentation. Une décision dut tout d’abord être prise sur l’architecture globale du système. Au premier niveau de définition, le système d’Ex Libris offre une « community zone » globale, agrégeant des données en provenance des éditeurs et de toutes les bibliothèques utilisant le système. Au second niveau, le réseau Renouvaud a acheté une zone réseau, qui génère pour le réseau un catalogue commun. Un troisième niveau regroupe toutes les bibliothèques scolaires et de lecture publique dans un ensemble, et toutes les bibliothèques scientifiques et patrimoniales dans un autre. Chaque ensemble partage ses fichiers lecteurs et d’autres paramétrages. Un quatrième niveau définit les bibliothèques, un cinquième respectivement leurs différents sites et dépôts.
L’affinage du paramétrage entraîna un grand nombre de discussions de détail : ainsi, pour le paramétrage de l’accès au catalogue des bibliothèques scolaires, l’équipe de projet exigea que dans ce catalogue n’apparaissent que les ouvrages disponibles dans la bibliothèque d’où était effectuée la recherche. Cette demande se justifie par le type de public qui fréquente les bibliothèques scolaires, peu apte à se déplacer physiquement dans une autre bibliothèque ou à effectuer un Prêt Entre Bibliothèques (PEB) pour emprunter un ouvrage. Aussi simple que cela puisse paraître, la question a posé de prime abord un problème de taille au fournisseur, pour qui ce type de développement allait à l’encontre de ceux prévus pour l’outil de découverte Primo. Finalement, les discussions portèrent leurs fruits et le problème fut réglé par la création d’un portail par bibliothèque scolaire.
Gestion du projet, structure du projet et personnels BCUL impliqués
- le projet d’organisation permettait de constituer le nouveau réseau vaudois de bibliothèques et de formaliser sa gouvernance. Le projet d’organisation a également défini la structure de la centrale de coordination du réseau vaudois de bibliothèques, ses responsabilités et son business plan. Il a établi le cadre contractuel déterminant les relations entre la BCU Lausanne, les membres du réseau et ses partenaires (RERO, BNS, BNF, etc.). Il a aussi été chargé de créer les conditions-cadres pour assurer une collaboration active entre bibliothèques du réseau vaudois et, dans la mesure du possible, avec d’autres réseaux de bibliothèques (IDS, SUDOC, etc.) ;
- le projet informatique comprenait l’acquisition du nouveau SIGB localisé dans le cloud, la migration des données et la recette du système qui devait permettre la gestion des ressources des bibliothèques du réseau vaudois, l’acquisition des ouvrages, le prêt, ainsi que l’accès aux contenus imprimés, multimédias et électroniques, dès le 1er janvier 2017 ;
- le projet bibliothéconomique permit de formaliser les normes et les standards appliqués au sein du réseau vaudois dans tous les domaines d’activité des bibliothèques, c’est-à-dire l’acquisition, le catalogage, le bulletinage, le prêt, le prêt interurbain, respectivement l’indexation et l’importation de masse de notices, l’activation des ressources numériques ainsi que la livraison d’indicateurs statistiques. Ceci permit aussi de créer et de dispenser les formations, ainsi que de mettre en place un contrôle qualité.
Selon HERMES, le pilotage du projet Renouvaud reposait sur un comité de pilotage (CoPil), qui assumait collégialement la responsabilité du projet dans son ensemble. Présidé par Jeannette Frey, directrice de la BCU Lausanne, et composé de représentants des différents types de bibliothèques membres du réseau vaudois, le CoPil s’est réuni tous les deux mois. Il a surveillé et piloté le déroulement du projet de manière globale, assuré l’acquisition et la mise à disposition des moyens nécessaires et garanti leur utilisation optimale. Le CoPil traitait aussi des problèmes extraordinaires, et, last but not least, validait les différents points de décision, notamment la conclusion et la libération des différentes phases du projet. Afin d’avoir une gestion professionnelle et neutre de la qualité et des risques, une consultante externe fut mandatée par la BCU Lausanne et associée au CoPil.
La conduite du projet reposait ensuite sur un comité de projet (CoPro), présidé par Alexandre Lopes, responsable Technologies bibliothécaires de la BCU Lausanne, ce dernier assumant le rôle de chef de projet. Le CoPro se réunissait de façon hebdomadaire. Le chef de projet était épaulé par un consultant externe mandaté pour prendre en charge la conduite de la partie informatique du projet. Au bénéfice de compétences sénior en gestion de projet, il était le principal répondant pour l’appel d’offres public, les spécifications détaillées ainsi que la recette.
Le projet Renouvaud se composait de trois sous-projets afin de répondre aux exigences du mandat du DFJC :
Organigramme Renouvaud
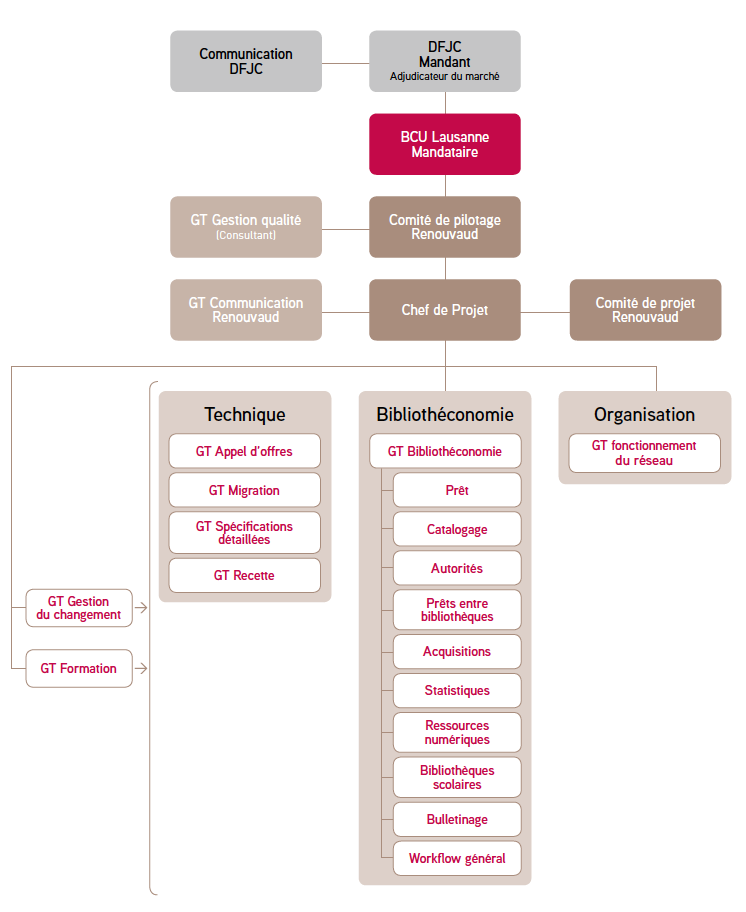
Source : Rapport Annuel Renouvaud 2017, p. 15.
Les tâches des sous-projets ainsi que les activités transversales furent assurées par une dizaine de groupes de travail ad hoc : GT appel d’offres, GT migration, GT spécifications détaillées, GT recette, GT bibliothéconomie, GT fonctionnement du réseau, GT formation, GT gestion qualité, GT communication, GT gestion du changement et GT organisation de la coordination. Les objectifs des groupes de travail furent définis dans un mandat propre à chaque groupe. Chaque responsable gérait son GT comme un projet en tant que tel avec son propre planning, ses charges, ses délais et ses livrables. Il assurait la coordination des activités du groupe et était garant du respect des délais et des jalons fixés par le groupe. Il veillait également à la qualité des livrables de son groupe, avec le support de la responsable Qualité. Du côté de la BCU Lausanne, le chef de projet prit en charge le GT migration, tandis que le directeur adjoint du site Unithèque, Jean-Claude Albertin, dirigea le GT fonctionnement du réseau et le GT gestion du changement. Un apport majeur vint aussi de Jasmin Hügi (GT bibliothéconomie), de Jean-François Richer (GT formation) et de Fanny Peuker (GT organisation de la coordination). 80% des personnels impliqués dans les groupes de travail furent mis à disposition par la BCU Lausanne, 20 % par les autres membres du réseau, avec des provenances aussi diverses que les bibliothèques scolaires et les bibliothèques du CHUV.
Principaux défis dans la gestion du projet
Au cours de l’année 2015, le CoPil a pris l’une après l’autre les décisions nécessaires à la formulation du concept et à la réalisation du projet Renouvaud. Le CoPil a notamment validé les organigrammes pour les différentes phases du projet, les règles de catalogage au passage sur le nouvel outil, le plan de communication, le plan qualité, le suivi des risques, la topologie du futur réseau, les mesures de protection des données des lecteurs et l’interfaçage avec des applications tierces. De plus, le CoPil a validé le passage à une indexation avec RAMEAU précoordonnée, composé d’une chaîne de mots matières (en opposition à l’utilisation de mots matières individuels). Parmi les nombreux avantages de cette pratique, on doit mentionner l’exploitation des indexations des bibliothèques partenaires RAMEAU (p.ex. BNF, SUDOC) et une meilleure exploitation de Primo dans l’organisation hiérarchique des mots matières.
L’un des principaux défis dans la gestion du projet fut de tenir les délais tout en maintenant la motivation des collaborateurs sur la durée. Un planning détaillé du projet fut établi et mis à jour régulièrement, afin d’avoir une vue d’ensemble de l’avancement des travaux de chaque groupe de travail. Outre les rapports de phase produits à la fin de chaque phase HERMES, des documents de reporting permirent de jalonner la vie du projet Renouvaud avec une périodicité mensuelle : le rapport d’état du projet, le rapport d’évaluation des risques et l’état des lieux des groupes de travail.
Un autre défi de taille était de réussir à motiver les groupes de travail impliqués dans le projet, sous la contrainte d’un planning serré. Une grande importance fut accordée par le chef de projet au recrutement de membres des équipes et des groupes à la fois engagés, motivés et prêts à relever un défi sur une durée relativement longue. Pendant toute la durée du projet, les vacances furent accordées en fonction du calendrier du projet et des reports furent parfois nécessaires afin de tenir les délais. L’équipe de projet fit également preuve de souplesse et ne ménagea pas ses efforts en termes d’horaires, les séances pouvant se prolonger jusque dans la nuit.
La définition précise des configurations souhaitées, les tests et la préparation de la migration des données ont constitué un autre défi majeur pour l’équipe de projet. Un test de conformité des données à migrer relativement aux spécifications de migration fut suivi par un test de chargement des données dans le futur système informatique. Conformément à la loi sur la protection des données, au début du mois de décembre 2015 et avant de charger les données dans le système même test, une communication fut faite à l’ensemble des usagers les informant que leurs données seraient transmises au fournisseur du nouveau SIGB. La bonne préparation de la communication permit d’optimiser cette étape et seule une trentaine de personnes refusa que leurs données soient transmises, dont une quinzaine pour des raisons autres que la protection des données. En parallèle, les données extraites du catalogue de RERO furent transmises via un protocole sécurisé à Ex Libris le 14 décembre, date à laquelle commença donc la migration de test sur l’intégralité des données ; le but de cette opération était de faire une répétition générale de la migration de bascule prévue en août 2016. Ex Libris livra dans les délais prévus l’environnement de préproduction du logiciel Alma, le 8 février 2016. Dès la livraison effective, le groupe de travail chargé de la migration effectua des tests de manière à s’assurer que la qualité des données était bien conforme pour poursuivre les travaux. Aucun problème majeur nécessitant de refaire entièrement la migration de test ne fut rencontré. Quelques anomalies furent détectées et rigoureusement inventoriées, mais, de manière générale, la qualité des données migrées fut jugée très satisfaisante. En dépit du décalage en urgence du début de la phase de bascule (cutover) en raison d’une erreur de planification du fournisseur, la migration de bascule put être effectuée au moment du passage en production, soit le 22 août 2016.
La traduction des interfaces des outils Alma et Primo, qui faisait partie du cahier des charges pour l’appel d’offres, représenta un autre défi à gérer pour l’équipe de projet ainsi que pour les différents groupes de travail impliqués, et en particulier pour le GT6 formation. Lors de la livraison des interfaces en français, prévue relativement tardivement pour le printemps 2016, des problèmes de traduction de l’anglais, voire des oublis furent détectés. De plus, certaines traductions portaient parfois à confusion soit pour les professionnels, car le vocabulaire-métier ne se retrouvait pas dans Alma, soit pour les utilisateurs. Bien que des contrepropositions de traduction furent faites par la Coordination Renouvaud, il s’avérait parfois très laborieux d’obtenir l’intégration des modifications demandées. Concernant l’aide en ligne d’Alma, les textes furent traduits en français, mais les captures d’écran et les vidéos restèrent finalement en anglais, en raison du fait qu’elles sont mises à jour de manière centrale pour toutes les langues. Cela ne fut pas sans poser problème au groupe de travail chargé de la formation de plus de 500 collaborateurs du réseau avant le lancement.
Renouvaud se lance !
À la veille du go-live, les résultats obtenus par les équipes et les groupes de travail furent considérés conformes aux attentes. Concernant la partie informatique du projet, la recette était terminée avec un bilan de 80% des besoins testés avec succès. Après de longs mois de préparation, Renouvaud fut lancé le 22 août 2016, comme prévu dès le montage du projet avec le fournisseur juste après l’adjudication du marché. En dehors d’un problème mineur avec le chargement des données « lecteurs » des bibliothèques scolaires, le démarrage fut fluide et les services proposés aux usagers furent actifs dans tout le réseau dès 14h00 ce jour-là, à l’heure prévue pour le début des activités de prêt. Pour l’anecdote, la première transaction fut effectuée à 14h01. Le service de prêt fut tout de suite fonctionnel, des dizaines de milliers d’utilisateurs purent se loguer pendant la première semaine et il y eut beaucoup de feedbacks positifs des bibliothèques du réseau. Certes, le 22 août ne fut qu’une étape et de nombreuses tâches attendaient encore l’équipe de projet. Les mois qui suivirent le lancement permirent néanmoins aux collaborateurs et aux utilisateurs de prendre en main l’outil et de l’utiliser quotidiennement dès avant la sortie effective du réseau RERO, soit au 31 décembre 2016.
Plusieurs actions de communication accompagnèrent le lancement. Outre les informations régulièrement mises à jour sur le site web de la BCU Lausanne, une charte graphique Renouvaud fut créée et déclinée, aussi bien sur les interfaces du SIGB que sur les imprimés, crayons et sacs distribués dans toutes les bibliothèques du réseau. À l’interne, plusieurs séances plénières réunirent les professionnels du réseau tandis que des messages informant les usagers et des présentations publiques permirent de préparer les usagers à ce changement.
Les travaux après le lancement
La migration des données étant désormais terminée et le changement de logiciel effectif, la Coordination Renouvaud reprit ses travaux. Lorsque les fonctionnalités offertes par les outils Alma et Primo ne répondaient pas aux besoins ou attentes, des développements informatiques furent faits en interne afin de se rapprocher au maximum du fonctionnement prévu. Pour gérer les demandes en provenance des bibliothèques du réseau, un outil de ticketing testé au préalable à la BCU Lausanne fut mis à disposition de tous les professionnels du réseau après le go-live. Dès lors, un important travail de stabilisation du système fut mené par la Coordination : elle repérait les dysfonctionnements des outils et les annonçait à l’équipe de support d’Ex Libris, afin qu’elle puisse les résoudre ou proposer une solution de contournement dans les meilleurs délais. Ex Libris acceptait de faire des développements s’il s’agissait d’un besoin partagé par un nombre suffisamment important de clients. Ainsi, Alma évolue très régulièrement avec des mises à jour mensuelles de l’outil contenant des améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Le paramétrage fin de certaines fonctionnalités permit l’adoption progressive de « bonnes » pratiques et la prise en main d’Alma par les professionnels du réseau vaudois ; ceci s’accompagna de la mise à disposition de manuels sur mesure pour intégrer les processus.
À la fin de l’année 2016, la Coordination Renouvaud mit pour la première fois à disposition des bibliothèques du réseau toutes les statistiques habituellement fournies par la Coordination vaudoise ou par RERO. À noter que la nouvelle plateforme de gestion implique certaines différences dans la façon d’élaborer les chiffres, différences liées aux méthodes propres à chaque logiciel. Alma propose un outil très puissant de génération de produits et statistiques nommé Analytics (développé par Oracle) qui permet aux bibliothécaires-système de préparer des rapports et listages flexibles. Le tableau de bord « statistiques d’acquisitions » est par exemple destiné à faciliter le pilotage, la gestion des budgets et des commandes dans Alma. Il s’agit alors de définir les paramètres permettant la génération correcte de ces statistiques en fonction d’un certain nombre de critères choisis par les bibliothécaires du réseau. Parfois, des erreurs de calcul furent repérées et corrigées grâce au zèle des bibliothécaires – ce fut le cas par exemple des statistiques des prolongations de prêt.
Par ailleurs, un toilettage des processus de travail est amorcé au sein de la BCU Lausanne, aussi bien dans le cadre du circuit du document que dans celui des services au public, afin de revoir ou de redistribuer autrement certaines tâches. Pour ce faire, des réflexions approfondies sont engagées par les différents services sur la manière de fonctionner, le potentiel de collaboration entre les équipes, les sites et avec le réseau.
L’utilisation d’un système cloud permet en l’essence de partager et de réutiliser très facilement des métadonnées en provenance du monde entier. D’autres acteurs suisses avancent également dans la réinformatisation de leurs bibliothèques et réseaux. La Bibliothèque nationale suisse, tout comme le projet SLSP (pour Swiss Library Service Platform, géré maintenant par la SLSP S.A.) utiliseront à moyen terme les mêmes outils que le réseau Renouvaud. La question est donc maintenant de savoir comment ces différents acteurs suisses interagiront au niveau national sur la base d’un même outil plus global, quelles coopérations seront envisagées, respectivement quels services seront proposés par une plateforme commerciale comme SLSP S.A., à quel prix et avec quelle plus-value pour les éventuels clients.
Interconnexion des systèmes par APIs
Un des avantages d’un système comme Alma est son potentiel de connexion facilitée à d’autres systèmes par les APIs (Applications Programming Interfaces). À l’initiative de deux services centraux de la BCU Lausanne, l’interfaçage avec d’autres systèmes apporta rapidement une autre pierre à l’édifice Renouvaud. La 1re Assemblée annuelle Renouvaud du 29 septembre 2017 fut l’occasion de présenter GOBI de la maison EBSCO, un outil d’acquisition automatisée de livres numériques.
De son côté, le service Finances de la BCU Lausanne étudia le développement d’une interface permettant l’interconnexion avec le système de facturation de l’État de Vaud (SAP). Ensuite, les principaux fournisseurs furent contactés afin de leur proposer de passer au système d’importation automatique de factures en format EDI (Electronic Data Interchange). La mise en place de ce système permettra un gain de temps considérable au service Finances ; une extension de ce système à d’autres bibliothèques du réseau est envisagée à moyen terme. Ces deux réalisations permettent à la fois de travailler de manière plus efficace (réduction du temps), et plus efficiente, car elles permettent de diminuer le risque d’erreurs.
Gestion du réseau vaudois par la Coordination Renouvaud
Au début de l’année 2017, Renouvaud sortit peu à peu du mode projet et mit en place les différents organes pour garantir un fonctionnement efficient sur la durée. Le CoPil muta en Conseil Renouvaud et valida d’une part les missions, la structure et l’organisation de la Coordination Renouvaud et confirma d’autre part la mise en place des commissions techniques pour traiter les questions métier au sein du réseau. Un responsable de la Coordination Renouvaud put être recruté en la personne de Christian Bürki, dès le 1er mai 2017. Son engagement s’accompagna de la mise en place d’un plan d’action composé de trois axes stratégiques : stabiliser, optimiser et innover. Les deux premiers axes posèrent les bases pour la gestion du réseau les années à venir. D’abord, il s’agissait de consolider le fonctionnement du réseau après le lancement de la nouvelle plateforme. Ensuite, il s’agissait de simplifier et de standardiser les tâches afin d’augmenter la cadence de l’intégration des bibliothèques. En effet, la vitesse d’intégration des bibliothèques dépend non seulement des ressources financières et humaines à disposition, mais aussi de l’expérience acquise avec Alma.
Dès le mois de mai 2017, la Coordination se penchait sur le processus d’intégration des nouvelles bibliothèques et les paramétrages de base d’Alma. Le temps de paramétrage du prêt fut divisé par 10 après 5 mois. En parallèle, il fut établi que l’optimisation du processus d’intégration passera par une priorisation des bibliothèques à intégrer en fonction de leur degré de complexité d’intégration, selon les prestations sollicitées. Le principe est d’intégrer les bibliothèques par wagons, selon les paramétrages souhaités. Afin de les intégrer pleinement au réseau, la migration de leurs données, la formation des collaborateurs et le paramétrage de l’outil sont réalisés. L’année 2017 permit ainsi une première consolidation de la plateforme hébergeant déjà 109 bibliothèques du réseau vaudois. Ce fut l’occasion d’harmoniser un certain nombre de pratiques, par exemple au niveau des règles de prêt, de mettre en place des procédures et de développer des outils pour faciliter l’arrivée de nouveaux membres. Un des premiers outils développés permit de charger de manière semi-automatique les données des étudiants et écoliers avant chaque nouvelle rentrée scolaire. Une adaptation de l’outil de raccrochage pour les migrations permettra de concrétiser ultérieurement les efforts de la Coordination. En effet, ce seront plus de 50 nouvelles bibliothèques qui vont grossir le réseau Renouvaud entre 2018 et 2021.
Organes Renouvaud
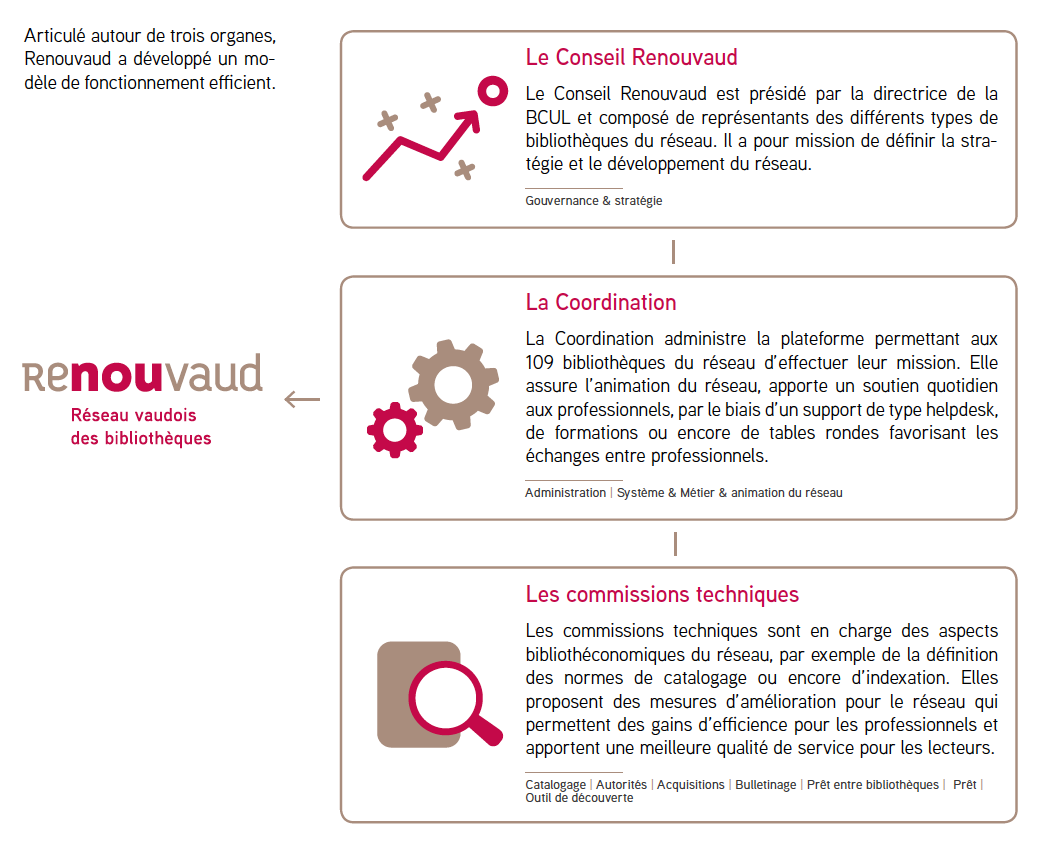
Source : Rapport Annuel Renouvaud 2017, p. 11.
Bilan deux ans après le lancement
Lors du lancement du projet Renouvaud en 2014, la Conseillère d’État Anne-Catherine Lyon avait défini les objectifs généraux et spécifiques du projet. Deux ans après le lancement de la nouvelle plateforme de gestion, 95% des fonctionnalités ont été validées et les objectifs ont tous été atteints, sauf la validation formelle de gouvernance, qui est encore en attente. La publication du premier rapport annuel Renouvaud 2017 montre que les délais ont été tenus et le réseau Renouvaud dispose depuis le 1er janvier 2017 de toute l’infrastructure nécessaire au bon fonctionnement des bibliothèques le composant. Le budget a été respecté et le solde au 31 décembre 2017 du crédit d’investissement s’établit à CHF 85'494. A cette date, Renouvaud compte au total 109 bibliothèques, dont 53 scientifiques et/ou patrimoniales et 56 bibliothèques scolaires et de lecture publiques. Les chiffres de l’utilisation du réseau par les publics sont excellents et représentent une progression forte par rapport aux années précédentes : de l’offre imprimée totale (3'507'127) à l’offre de ressources électroniques (938'443), des recherches dans le catalogue (2'111’813), du nombre de prêts (1'843'627) au nombre de consultations des ressources électroniques (près de 3 millions). De toute évidence, l’intégration des outils Alma et Primo, permet aux publics d’accéder plus facilement aux ressources imprimées et numériques.
En 2017, Renouvaud est l’un des plus grands réseaux de bibliothèques suisses et le premier à utiliser une plateforme de dernière génération basée sur une technologie cloud. Pour relever les défis de la 4e révolution industrielle, qui touchent les bibliothèques de plein fouet, Renouvaud a mis en place une organisation structurelle agile au niveau des décisions stratégiques. Le réseau a aussi construit une équipe bicéphale, technique et métier, qui permet une gestion professionnelle de la plateforme technique tout en maintenant un lien métier fort avec les bibliothécaires, stimulant d’échanges intensifs et assurant la formation continue des bibliothécaires. Cette organisation s’appuie sur une bonne compréhension du terrain et permet une mise en place de processus et d’outils les plus adaptés possible aux besoins de plus de 500 professionnels du réseau qui travaillent quotidiennement au service d’environ 140’000 usagers de tous les âges. Renouvaud est un réseau jeune, dynamique et complexe qui est en train de mûrir grâce aux échanges entre professionnels du réseau. L’organisation d’assemblées annuelles et de tables rondes par la Coordination Renouvaud nourrit cette perspective. Ces plateformes d’échanges entre professionnels permettent la circulation des informations et des idées et font progresser l’ensemble du réseau, tout en ouvrant des perspectives de collaboration très réjouissantes dans les années à venir.
Bibliographie
DFJC, Reprise de la gestion du réseau vaudois par la Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne (BCU Lausanne) au 1er janvier 2017, 8 septembre 2014
État de Vaud et BCU Lausanne, Appel d’offres marché public : procédure ouverte. Projet Renouvaud. Conditions et formes de participation, 11 novembre 2014
État de Vaud et BCU Lausanne, Appel d’offres marché public : procédure ouverte. Projet Renouvaud. Cahier des charges, 11 novembre 2014
État de Vaud, Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’investissement de CHF 2'307'000 pour financer la mise en œuvre du futur réseau vaudois des bibliothèques et du système d’information associé dans le cadre du programme de gestion des bibliothèques du réseau vaudois (RenouVaud), juin 2015
Lettre d’information Renovaud, années 2015-2018
Rapport annuel BCU Lausanne, années 2014-2017
Rapport annuel Renouvaud, année 2017
Notes
[1]Note méthodologique. La préparation de cet article se base sur la consultation de sources publiées et non publiées produites dans le cadre du projet Renouvaud. Certaines parties de l’article reprennent le contenu des rapports annuels de la BCU Lausanne et du premier rapport annuel Renouvaud, édités sous la direction de Jeannette Frey. Nous avons également repris et adapté certaines parties des sources non publiées (rapport d’initialisation, rapport d’analyse préliminaire et appel d’offres public du projet Renouvaud). Nous remercions vivement Alexandre Lopes, Christian Bürki et Jasmin Hügi pour leurs renseignements et suggestions. Le contenu de cet article reste bien sûr de la seule responsabilité de ses auteurs.
[2]Comme le stipule l’article 24 de la Convention RERO, adoptée le 25 novembre 1999, la sortie est effective au 31 décembre 2016, afin de respecter le délai de sortie de 24 mois à l’avance pour la fin d’une année civile.
[3]HERMES online : http://www.hermes.admin.ch. La version 5 a été lancée en 2013 et le release 5.1 en juin 2014.
- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires
Des ebooks dans sa poche : projet de valorisation de la collection numérique de la Bibliothèque de l’UNIGE
Ressi — 20 décembre 2018
Bibliothèque de l’Université de Genève, CODIS - Service de coordination de la DIS
Rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4 - Suisse
Résumé
La valorisation des ressources en ligne, coûteuses et invisibles dans les rayons des bibliothèques, se fait souvent manuellement avec un grand nombre d’étapes chronophages nécessitant des compétences techniques. En 2017, la Bibliothèque de l’Université de Genève a mis sur pied un groupe de travail dont l’objectif est d’harmoniser les pratiques de promotion de leurs collections numériques, notamment les ebooks. Ce projet a abouti à la création de l’Application de valorisation numérique “Avalon”, qui simplifie le processus de création des supports de valorisation (collecte de métadonnées et d’images de couverture, création des URLs raccourcis et QR-codes) tout en respectant la charte graphique institutionnelle. L’accès aux ebooks est simplifié grâce à la lecture des QR-codes, fonctionnalité intégrée à l’application UNIGE mobile, et l’affichage des informations sur une page Web intermédiaire. L’usager peut ainsi littéralement “mettre un ebook dans sa poche”. Cet article a pour objectif de présenter le contexte du projet, la méthodologie employée, le fonctionnement d’Avalon et de proposer un retour d’expérience sur ce projet.
Abstract
The promotion of online resources, which are expensive and invisible on the library shelves, is often done manually with a lot of time-consuming steps requiring technical skills. In 2017, the Geneva University Library set up a working group whose objective is to harmonize the promotion practices of their digital collections, particularly e-books. This project has led to the creation of the digital resources promotion application “Avalon”, which optimizes the process of creating promotional materials (collection of metadata and cover images as well as the creation of shortened URLs and QR-codes) respecting the institutional visual identity. Access to ebooks is simplified by scanning the QR-codes, feature included in the mobile UNIGE application, and displaying the information on an intermediate web page. The user can literally “put an ebook in his pocket”. This article aims to present the context of the project, the methodology, the functionalities of Avalon and to provide experience feedback.
Des ebooks dans sa poche : projet de valorisation de la collection numérique de la Bibliothèque de l’UNIGE
L’impact du numérique dans les bibliothèques universitaires
La Bibliothèque de l’Université de Genève (UNIGE) évolue dans un contexte académique et social marqué par un très fort développement du numérique dans toutes les disciplines. L’impact de cette mutation est global et il a provoqué des changements majeurs dans les pratiques des publics et des professionnels des bibliothèques universitaires. En effet, en une génération nous sommes passés d’une collection exclusivement physique et locale à une autre hybride, dominée par une nouvelle offre des contenus en format numérique, hébergés majoritairement en dehors de la bibliothèque.
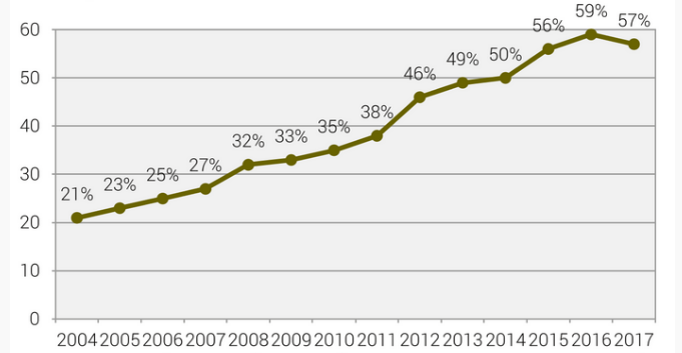
Figure 1 : Proportion des frais d’acquisition des documents électroniques par rapport aux frais d’acquisition totaux dans les bibliothèques universitaires suisses de 2004 à 2017
(Source : Statistique suisse des bibliothèques, Office fédéral de la statistique, https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-information-sport/culture/bibliotheques.html)
Les avantages du numérique sont nombreux : pas d’espace de stockage physique nécessaire, ni de manutention, consultations simultanées possibles, etc. Ils répondent aux pratiques de plus en plus nomades du public universitaire (documents accessibles partout et en tout temps). Cependant, certaines caractéristiques des ebooks constituent aussi des inconvénients face au livre papier : la complexité liée à la multiplication des formats propriétaires et ouverts (EPUB, PDF, Mobipocket, iBook, Kindle, etc.), le contrôle des accès par DRMs ou soumis à des contrats, son absence dans les espaces physiques en sont quelques exemples.
Ce changement de paradigme documentaire, basé sur la location d’un service et l’accès à distance, nous éloigne de plus en plus du traitement traditionnel des documents, qui représentait le cœur du métier pendant plusieurs siècles. La maintenance d’une collection numérique en expansion constante est complexe, la nature instable des médias électroniques (formats, liens, etc.) et la multiplicité des modèles de services (licences, plateformes, Open Access, etc.) engendrent un bouleversement des pratiques professionnelles dans le monde des bibliothèques académiques. Ce caractère insaisissable provoque une certaine inconsistance dans le traitement documentaire et la mise en valeur de ce type de documents. En effet, cette difficulté à maîtriser le contenu et le flux des métadonnées de cette collection numérique, explique que les bibliothèques académiques se contentent souvent d’un signalement minimaliste au niveau de l’outil de découverte et de la liste de titres (liste A-Z générée par le résolveur des liens).
Si le livre en format papier reste majoritaire pour le type de document “Livre”, la collection d’ebooks continue de se développer très rapidement. Par exemple, à la Bibliothèque de l’UNIGE, la collection d’ebooks a dépassé la barre des 500'000 documents et elle s’est étoffée d’environ 5'000 nouveaux titres en 2017. Ainsi, les ebooks représentent 13% de la collection totale des livres (ISBNs uniques). Cependant la majorité de la collection numérique est invisible au rayon (87% des ISBNs en format électronique n’ont pas d’équivalent papier). Une partie de cette collection d’ebooks existe aussi en format papier, ce qui représente environ 13'000 titres actuellement.
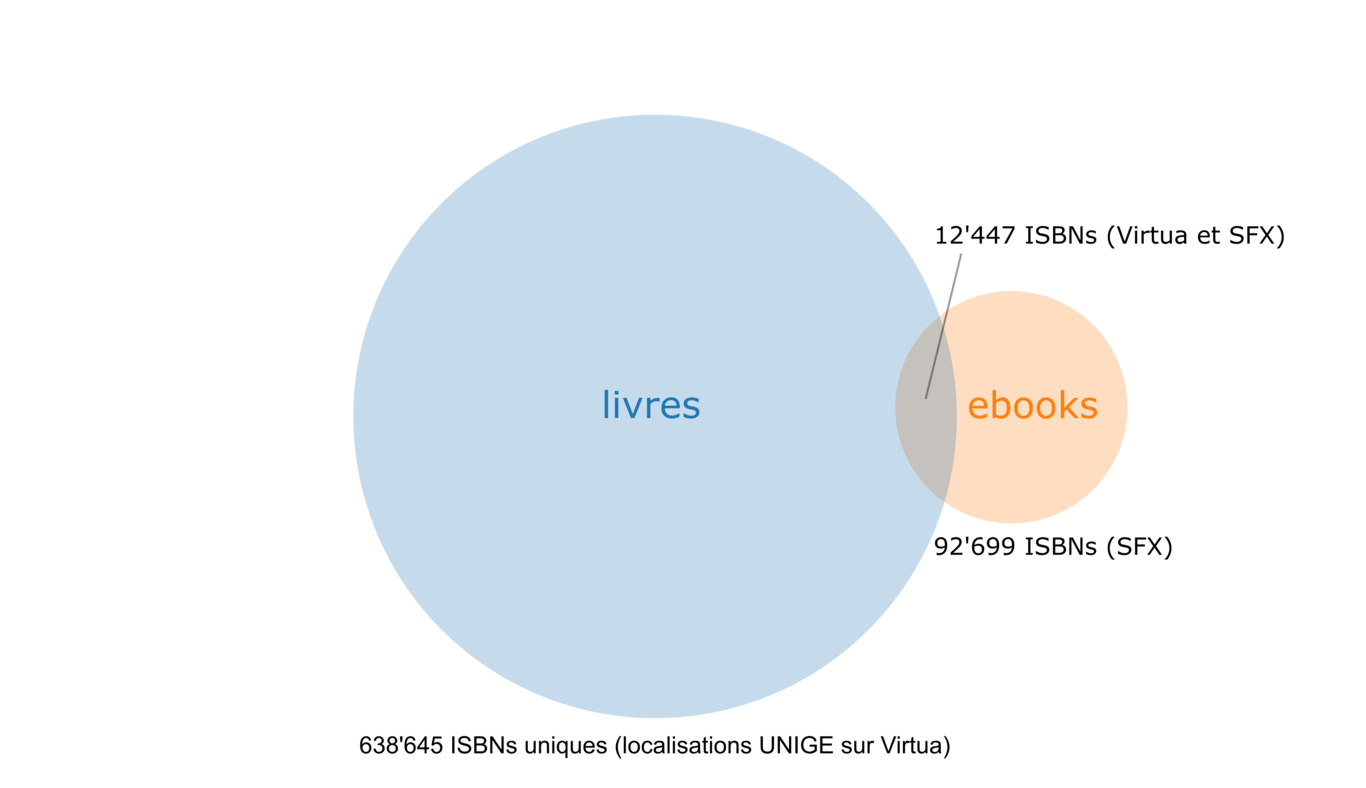
Figure 2 : Comparaison des ISBNs uniques dans la collection de la
Bibliothèque de l’UNIGE selon le support
Le contexte numérique et technologique actuel ouvre de nouvelles perspectives pour les bibliothèques universitaires. Les catalogues et les solutions de découvertes exploitent et fournissent de nouvelles APIs (Applications programming interface) qui permettent le développement de nouveaux outils. Les données bibliographiques s’ouvrent de plus en plus (mouvement Open Data) pour favoriser l’échange de métadonnées entre les systèmes.
Ces 10 dernières années, l’usage d’Internet a été bouleversé par l’arrivée des smartphones qui sont devenus l’une des portes principales pour la consultation de l’information sous forme numérique. Ces objets sont de véritables « couteaux suisses » informatiques incluant une pléthore d’applications à exploiter par les bibliothèques. Par exemple, les QR-codes fournissent aux bibliothèques un pont entre le monde physique et virtuel. Longtemps considérés comme désuets et sous-exploités en dehors de l’usage industriel, les QR-codes sont récemment revenus sur le devant de la scène pour répondre à de nouveaux usages (micro-paiement, promotion, vente en ligne, etc.). De plus, la lecture des QR-codes est aujourd’hui facilitée par l’intégration de sa lecture par la caméra des nouveaux smartphones.
La Bibliothèque de l’UNIGE a décidé de participer au développement de l’application mobile institutionnelle et propose actuellement de nouvelles fonctionnalités telles que le calcul de l’occupation des salles en temps réel, la lecture des codes-barres (QR-codes et ISBNs), la recherche dans l’outil de découverte RERO Explore Genève.
Etat de la valorisation des ebooks à la Bibliothèque de l’UNIGE
La Bibliothèque de l’UNIGE met à disposition du public des collections papier et numériques déployées sur quatre sites répartis dans la ville : Uni Arve, Uni Bastions, Uni CMU et Uni Mail. La collection d’ebooks s’est largement développée dans tous les domaines mais sa mise en valeur dans les espaces physiques n’a pas fait l’objet d’une réflexion concertée. En 2017, le service de coordination de la Bibliothèque (CODIS) qui a pour mission de coordonner des projets transversaux et d’harmoniser les activités au sein de l’institution, a reçu pour mandat de se pencher sur cette problématique.
La valorisation des ebooks et des périodiques électroniques était déjà pratiquée sur certains sites via des affiches, flyers ou fantômes incluant des QR-codes. Cependant, il n’existait pas de pratiques ni de procédures communes. Certains sites menaient des actions de valorisation dans les espaces depuis plusieurs années, tandis que d’autres se contentaient d’une promotion en ligne uniquement. Les dispositifs de valorisation existants différaient d’un site à l’autre : certains utilisaient des étiquettes pour signaler l’existence de la version numérique sur l’exemplaire physique, d’autres des blocs en plexiglas avec des affiches, d’autres des fantômes. Le visuel (logos, couleurs, mise en page, etc.) variait également et ne respectait pas toujours la charte graphique de la Bibliothèque. Par ailleurs, ces supports de valorisation ne renvoyaient pas tous aux mêmes type de contenu (texte intégral ou catalogue des ebooks), et les QR-codes utilisés ne dirigeaient pas toujours sur des pages adaptées à la consultation sur dispositif mobile.
Du côté des collaborateurs, la création des URLs raccourcis et des QR-codes posait problème puisque les outils pour les générer étaient des sites commerciaux parfois peu fiables. Pour créer manuellement ces supports de valorisation, les collègues avaient besoin de plusieurs logiciels dont certains nécessitent des compétences techniques particulières et chronophages (environ 10 minutes pour créer un seul support). Ce procédé peu efficient ne permettait pas de faire face à une masse de ressources numériques toujours plus importante à valoriser. Contrairement à la chaîne de traitement documentaire des imprimés, bien maîtrisée, celle des ebooks n’était pas formellement intégrée dans les pratiques professionnelles.
Du point de vue des usagers, les statistiques d’utilisation des QR-codes récoltées ponctuellement montraient une faible utilisation de ces supports comme moyen d’accéder à ces ressources. En effet, la multiplicité des formats et des supports pouvait diminuer l’impact de ce type d’actions, qui ne bénéficiaient pas d’une identité visuelle commune et d’un accompagnement technique et promotionnel suffisant.
Fort de ce constat et considérant la volonté de la Bibliothèque de promouvoir plus efficacement les ressources numériques, le contexte s’avérait favorable à la mise en place d’un projet transversal qui a pu démarrer en 2017. Dans un premier temps, le périmètre a été circonscrit à la valorisation des ebooks dans les espaces physiques, écartant la valorisation des autres types de ressources (périodiques électroniques et bases de données). La mise en valeur de ces ressources sur des canaux numériques (site web, écrans d’information, etc.) est quant à elle prévue dans un projet futur.
Objectifs et coordination du projet
Les objectifs du projet étaient multiples. Ils visaient principalement à fournir aux collaborateurs en charge de la valorisation des ressources numériques sur les sites des procédures et un outil commun pour intégrer cette étape dans la chaîne de traitement documentaire, au même titre que les ressources papier. Le projet avait également pour but d’améliorer la visibilité de ces collections et de faciliter leur accès. Plus concrètement, il s’agissait de :
-
promouvoir plus systématiquement les collections d’ebooks auprès des usagers sur l’ensemble des sites de la Bibliothèque ;
-
faciliter la création et la gestion des supports communs de valorisation (affiches, fantômes, etc.) munis de QR-codes et de liens pérennes ;
-
rendre plus visibles ces collections immatérielles grâce à un visuel commun identifiable qui répond à la charte graphique institutionnelle ;
-
augmenter la consultation de ces ressources grâce à un accès facilité et plus direct sur dispositifs mobiles.
En début d’année 2017, une étude préalable au projet avait permis de réaliser un état de l’art de la valorisation des ressources électroniques en bibliothèque et d’identifier les différentes méthodes et outils mis en place. Cette étude a été complétée avec des retours d’expérience d’autres institutions.
Pour mener à bien cette réflexion transversale, un groupe de travail ponctuel a été créé. Il est composé d’une sélection de spécialistes en charge de la gestion des ebooks sur chaque site et au sein du CODIS, et d’un bibliothécaire système. Il est animé par le coordinateur du pôle Informatique documentaire et la coordinatrice du pôle Communication. Le groupe s’est réuni régulièrement tout au long du projet qui a duré pratiquement 2 ans et s’est articulé en trois temps. La première période, allant d’avril à septembre 2017, a été consacrée à la définition du cadrage du projet (état des lieux de la valorisation sur les sites, définition des besoins et des fonctionnalités de l’application). Les 8 mois suivants ont été dédiés au développement technique de l’application Avalon, à la rédaction de la documentation et à la personnalisation graphique des supports de valorisation. Une fois en ligne, l’application Avalon a été testée par les membres du groupe, ce qui a permis d’intégrer de nouvelles fonctionnalités et des améliorations afin d’affiner la logique du processus de valorisation. Enfin, la phase de déploiement sur les sites impliquant la formation des collègues, s’est articulée pendant l’été, de mai à août 2018. Lors de cette dernière étape, les membres du groupe de travail ont pris en charge l’organisation du travail sur leurs sites respectifs.
Avalon : réalisation de l’Application de Valorisation Numérique
L’objectif de la plateforme était double. Premièrement, Avalon a été conçue pour offrir aux collaborateurs de la Bibliothèque une interface ergonomique permettant la production efficiente de supports de valorisation homogènes et facilement identifiables dans les rayons. Ensuite, elle devait aussi faciliter l’accès aux ressources pour les usagers.
La réalisation dans son ensemble constitue un écosystème d’applications de gestion (applications web développées en PHP sur un serveur interne de l’UNIGE LAMP géré par la Bibliothèque) permettant de connecter entre eux les éléments suivants :
-
flux de données en provenance des base de données institutionnelles (RERO Explore et SFX) et commerciales (images de couverture issues de Google, Amazon, etc.),
-
interface d’administration pour la création et la gestion des supports de valorisation,
-
création et gestion des URLs raccourcis et QR-codes,
-
génération des pages web intermédiaires destinées au public
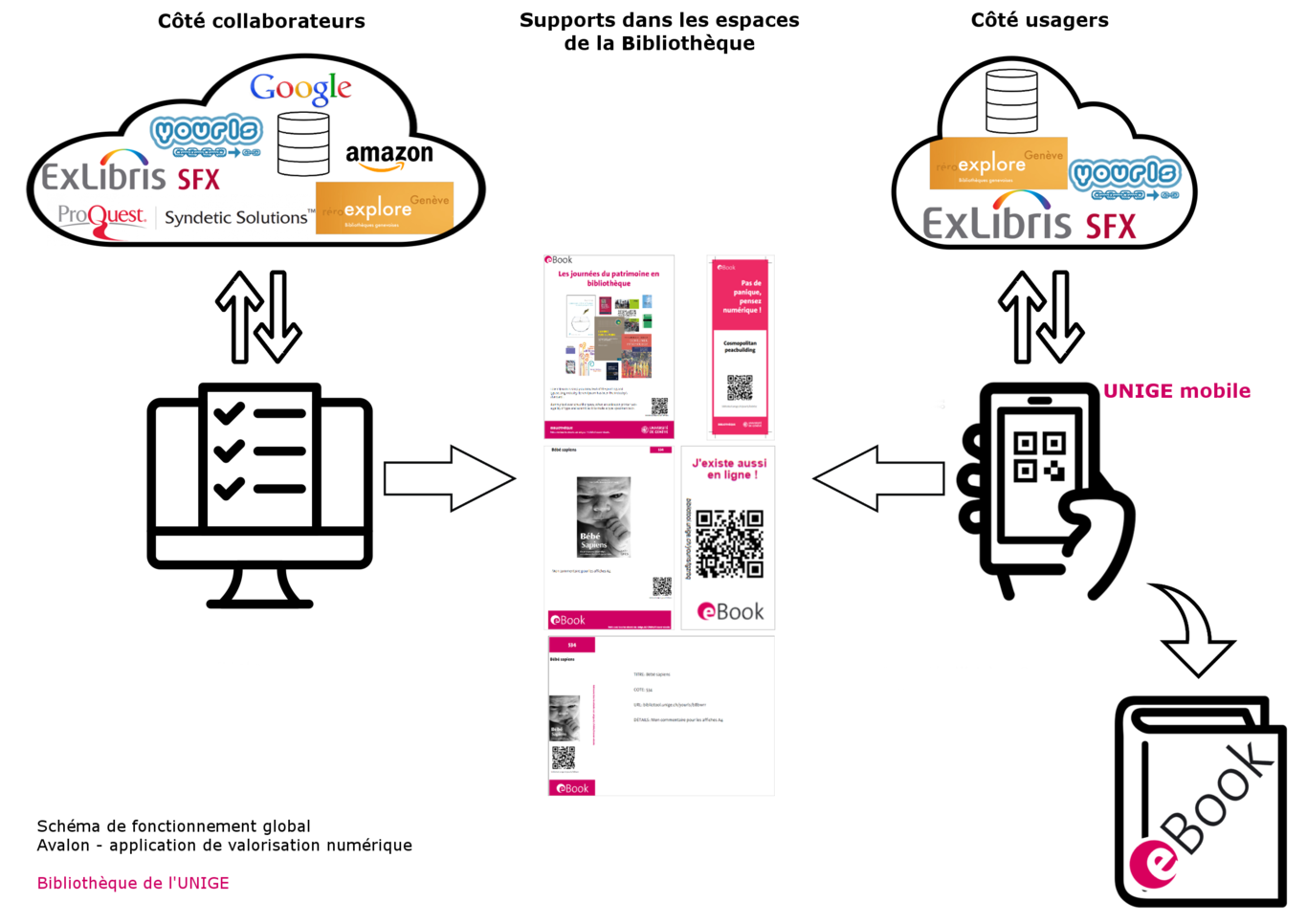
Figure 3 : Schéma de fonctionnement d’Avalon :
workflow de valorisation et d’accès pour une ressource.
L’interface d’administration permet de valoriser les ressources numériques en moins d’une minute. Elle se compose d’un formulaire de recherche communicant avec RERO Explore Genève, via l’API PNX Rest de Primo, qui récupère les principales métadonnées de l’ebook à valoriser.
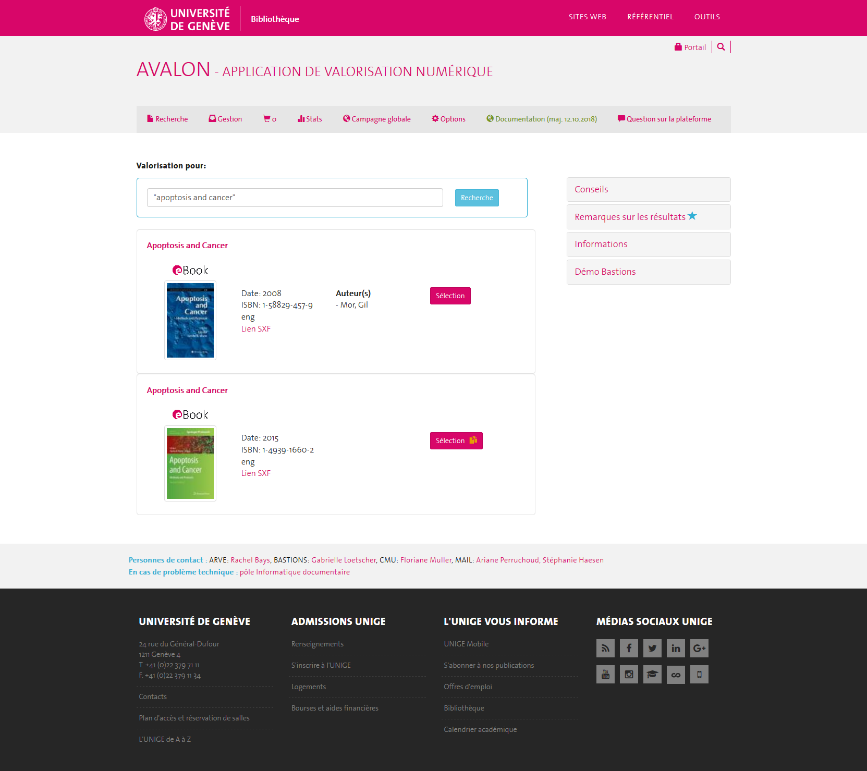
Figure 4 : Etape 1, recherche du titre “apoptosis and cancer”
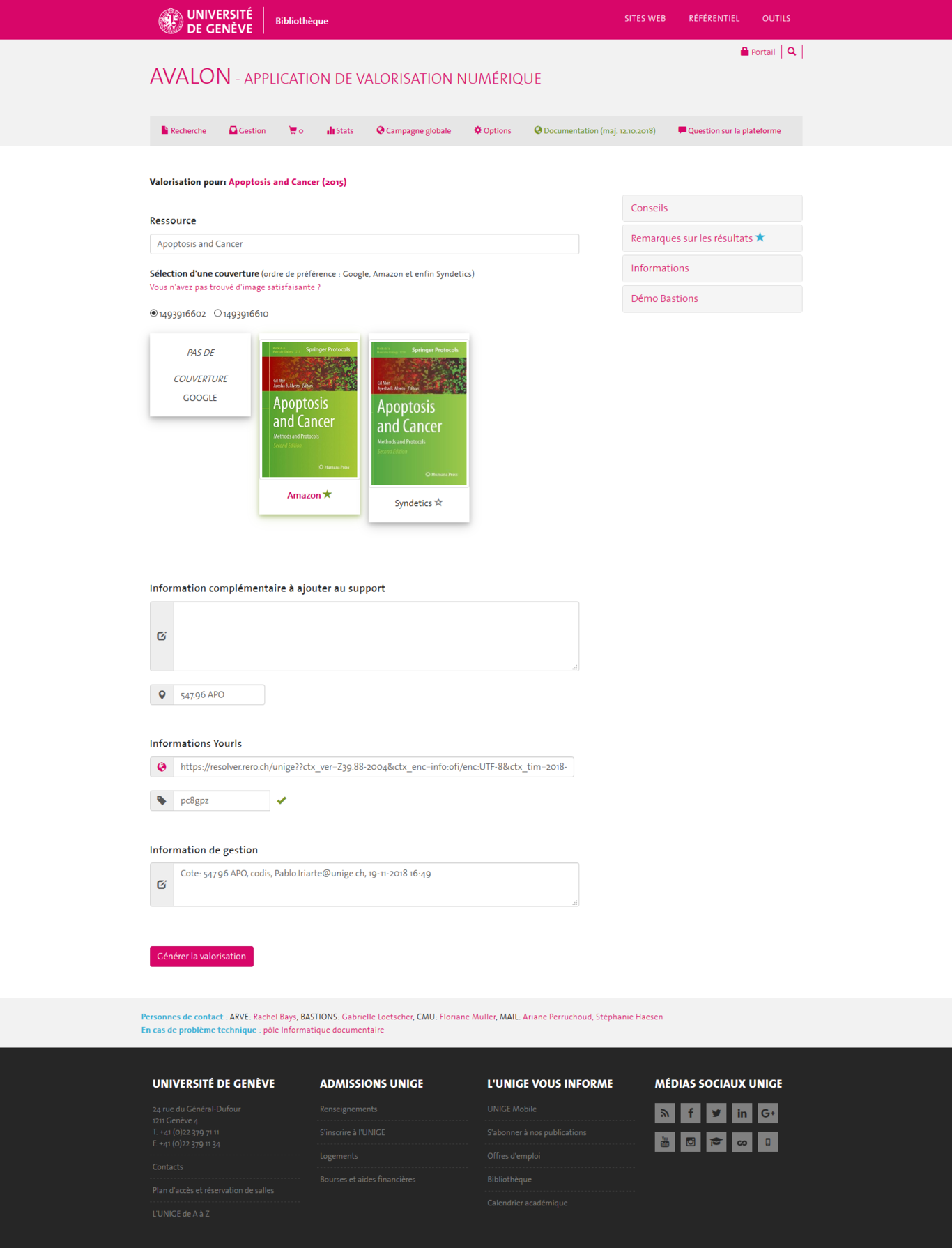
Figure 5 : Etape 2, collecte des données du titre “apoptosis and cancer”
Dans ce formulaire, l’ensemble des métadonnées de la ressource sélectionnée (titre, image de couverture, ISBN/ISSN, lien SFX, etc.) ont été récupérées automatiquement. Il est possible de les modifier, d’ajouter des éléments complémentaires (informations de gestion, résumé, cote, etc.). Un URL raccourci est également généré, celui-ci servira pour la création du QR-code. L’ensemble de ces métadonnées servira de contenu aux supports de valorisation.
Une fois complété, les données du formulaire sont stockées dans la base de données, et une nouvelle valorisation (entrée) apparait dans le tableau de gestion. A partir de ce tableau, il est possible de générer les supports de valorisation au format PDF.
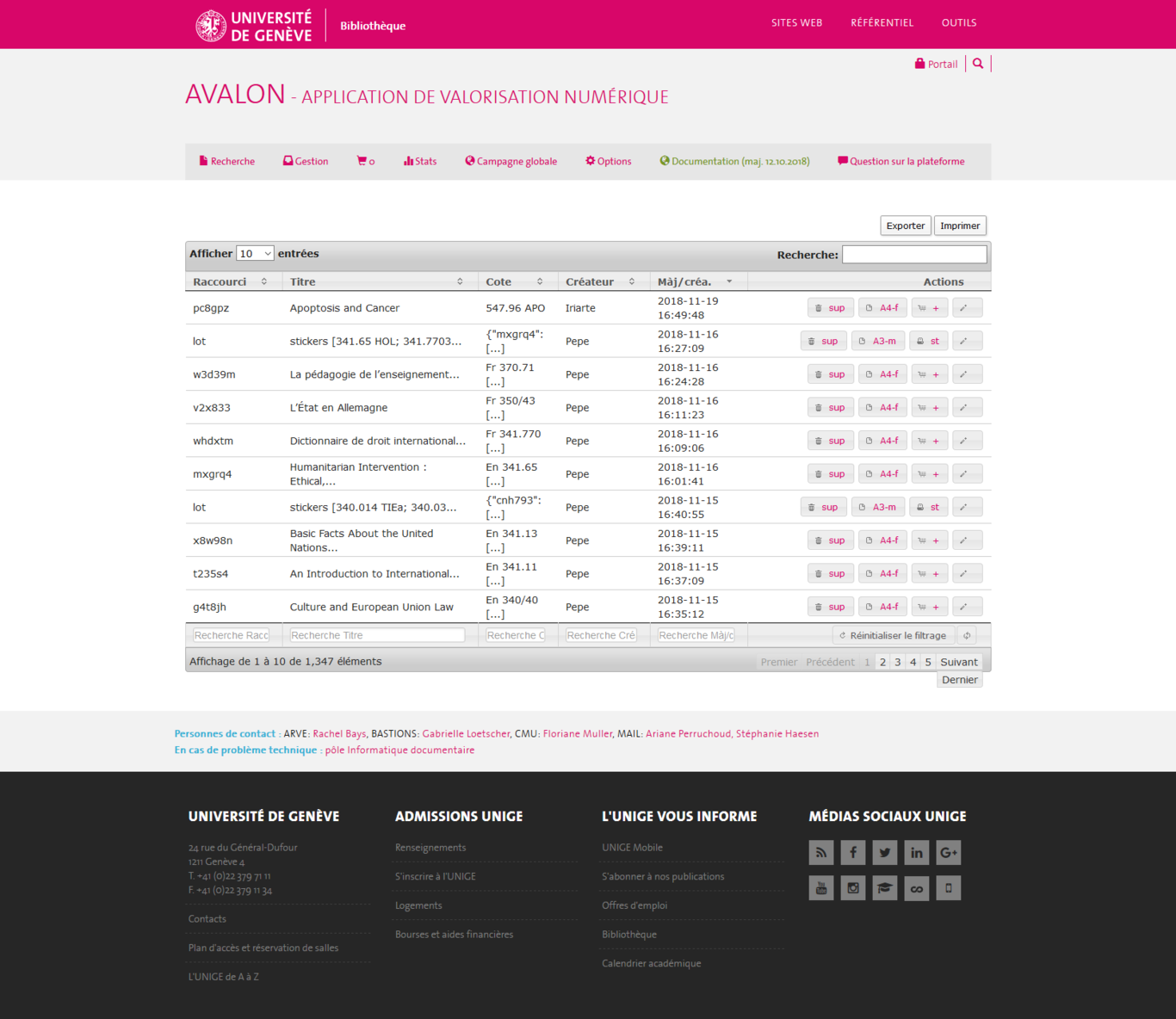
Figure 6 : Etape 3, affichage de la valorisation pour le titre « apoptosis and cancer »
dans le tableau de gestion
Quelques fonctionnalités ont été développées pour donner plus d’autonomie aux créateurs des supports de valorisation, qui ne possèdent pas forcément de compétences techniques. Pour la mise en page, il est possible de choisir la taille des caractères dans les résumés, modifier les textes affichés, ajouter des commentaires et choisir une image de couverture autre que celle récoltée automatiquement. Des fonctionnalités spécifiques ont été ajoutées par la suite pour permettre l’impression en plusieurs fois d’un même code-barre pour les exemplaires multiples ou pour un lot de stickers sur une page d'étiquettes incomplète (déjà utilisée).
Pour répondre aux besoins des sites qui souhaitaient valoriser aussi bien des lots (ebooks, bouquets) que des titres à l’unité cinq modèles de supports ont été définis.
Un titre sera valorisé par le biais d’affiches en format A4 (portrait/paysage), de fantômes ou encore d’étiquettes. Un lot de ressources (collections, thématiques) sera mis en valeur par le biais d’affiches en format A3 ou de marques-page/échéancier dans le cadre de campagnes.
Ces 5 modèles de supports de valorisation ont une mise en page prédéfinie en accord avec la charte graphique de la Bibliothèque.
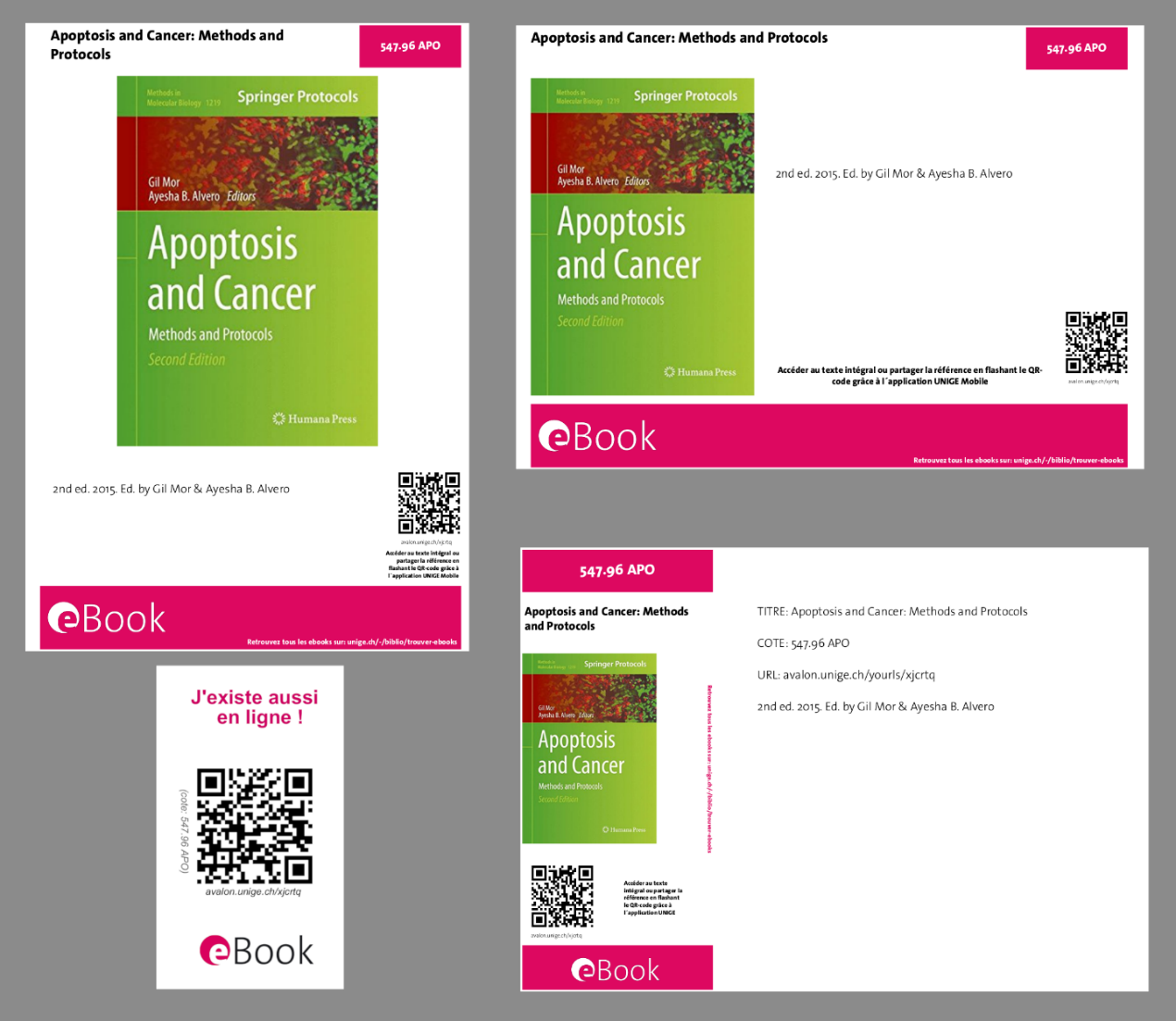
Figure 7 : supports de valorisation au titre
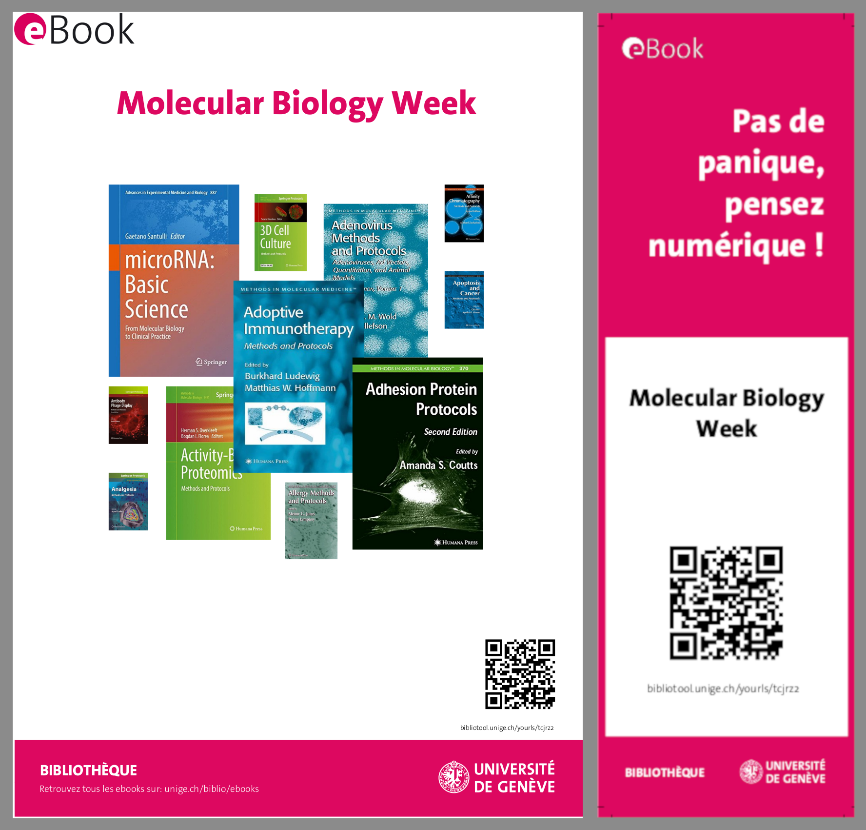
Figure 8 : supports de valorisation des lots
Par le biais de ces supports de valorisation générés avec Avalon (et en particulier du QR-code présent), l’usager peut accéder à la ressource numérique ou à une sélection thématique (recherche Explore pré-établie). Le flash d’un QR-Code amène sur une “page intermédiaire” (page web) également générée par Avalon.
Cette page permet de prendre connaissance des règles d’usage des ressources numériques, d’accéder à la ressource désirée et souvent au texte intégral, de partager la référence sur des réseaux sociaux mais aussi, et surtout, d’envoyer le lien de la “page intermédiaire” par email en vue d’une utilisation ultérieure. Cette dernière fonctionnalité a été développée pour offrir la possibilité à l’usager de consulter la ressource sur un appareil de lecture plus confortable et à un moment plus opportun.
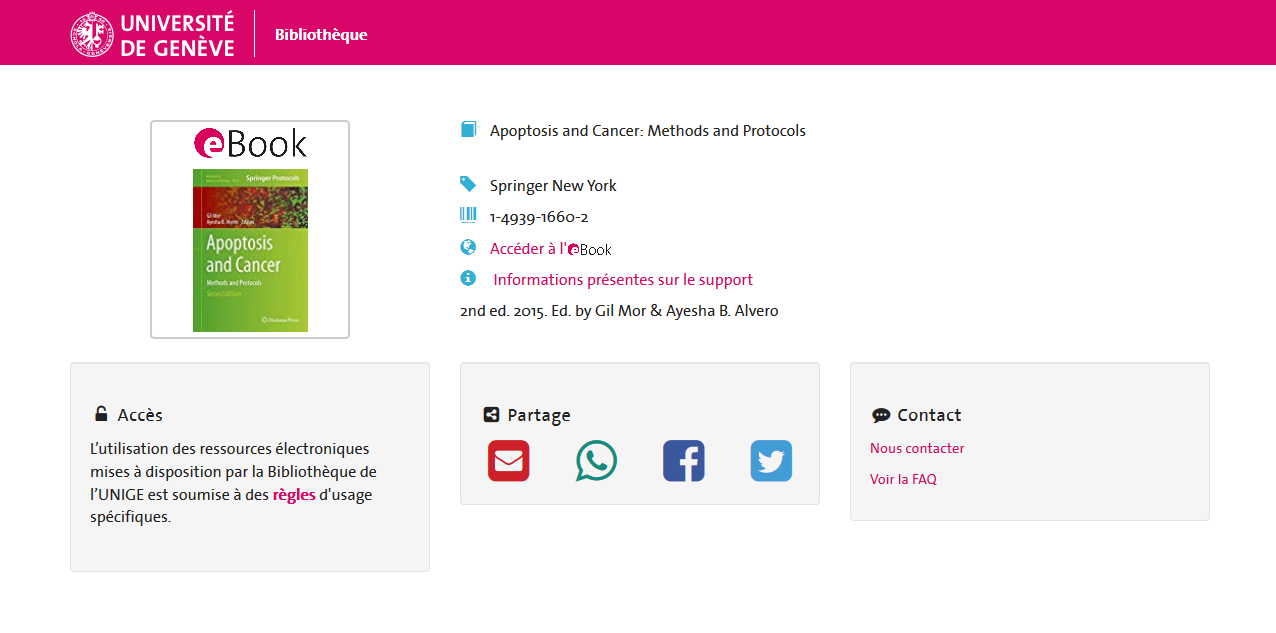
Figure 9 : Vue de la page intermédiaire (ordinateur et tablette)
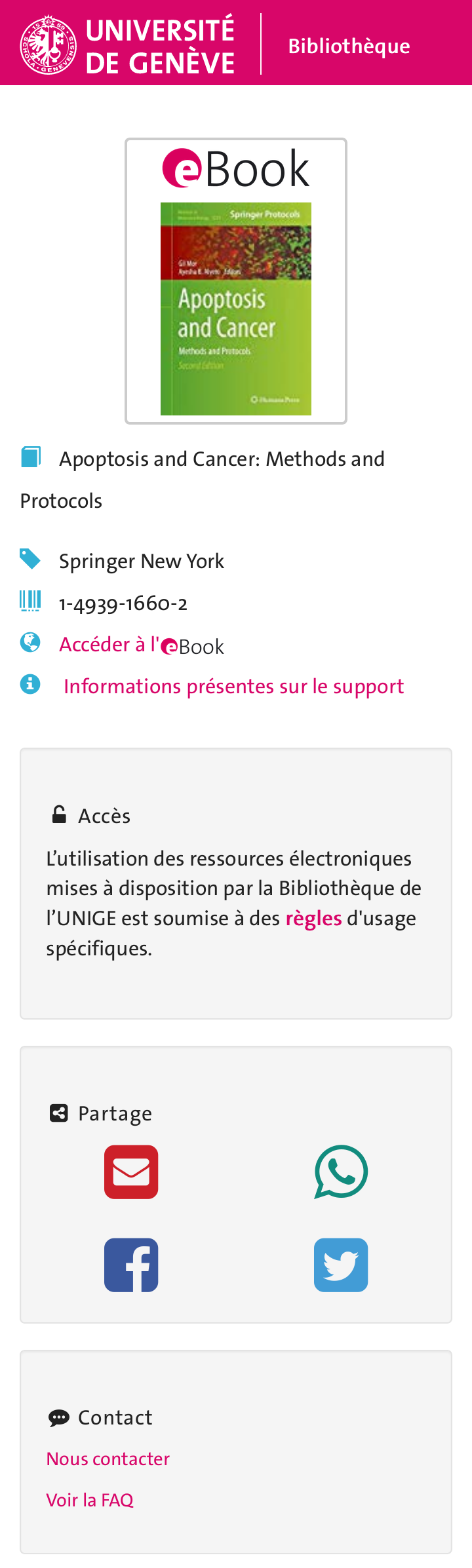
Figure 10 : Vue de la page intermédiaire (smartphone)
Cette page intermédiaire permet en outre de matérialiser le rôle de la Bibliothèque en tant que fournisseur des ressources numériques et offre une valeur ajoutée en proposant une solution technique en cas de problème d’accès.
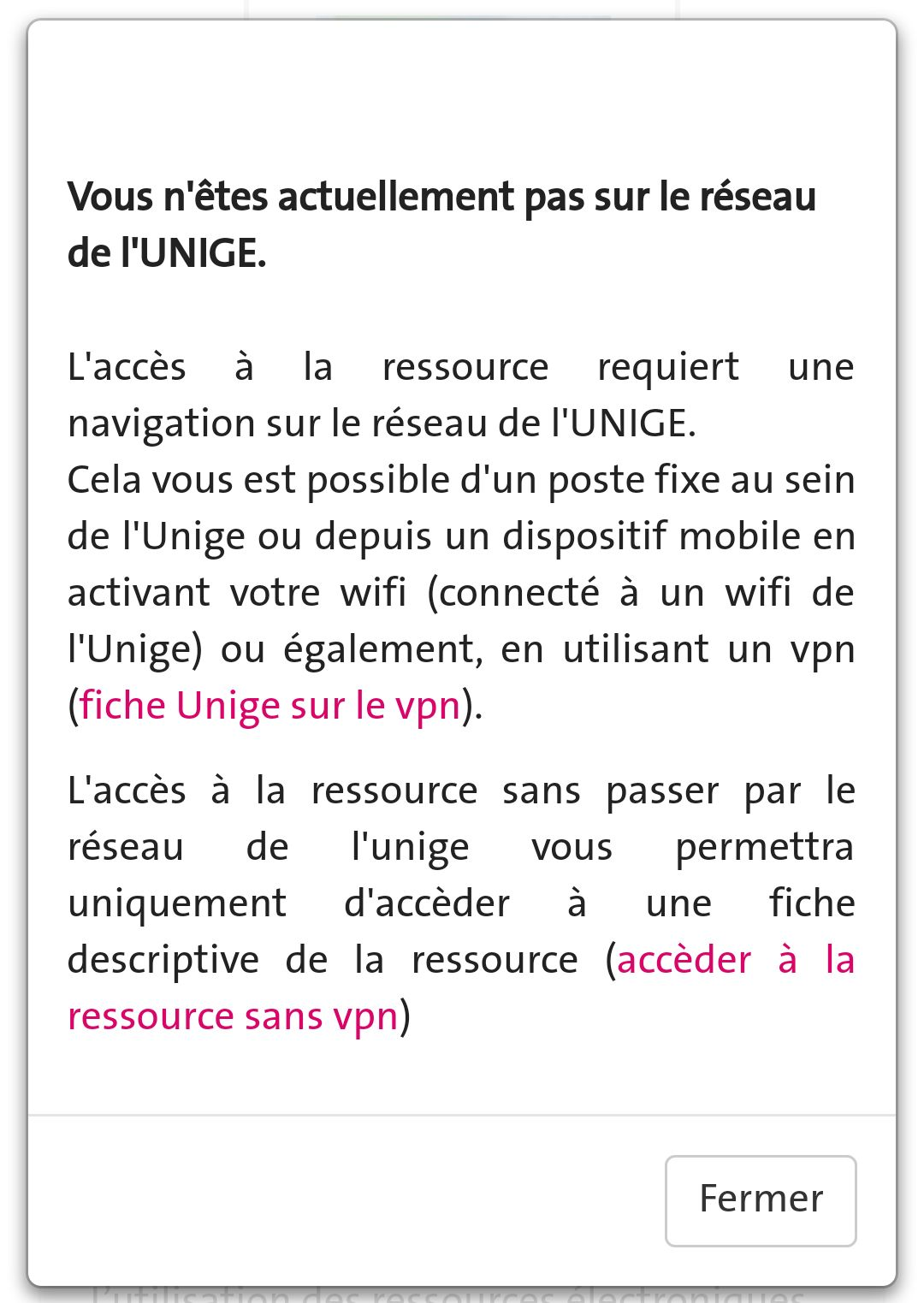
Figure 11 : Fenêtre modale qui apparaît lorsque l’usager tente d’accéder à la ressource numérique sans être sur le réseau de l’Université.
Déploiement et communication sur le projet
Pour faciliter la coordination du déploiement sur l’ensemble des sites de la Bibliothèque, un calendrier global commun a été défini. Il prévoyait 4 mois de mise en œuvre avec comme échéance la rentrée universitaire de septembre 2018. Néanmoins, les sites ayant des fonctionnements propres, il était important que chacun puisse s’organiser de manière autonome. Cette mise en œuvre consistait en deux étapes principales :
-
former les collègues des sites sur Avalon, organiser ou réorganiser (si déjà existant) le processus de traitement documentaire afin que l’étape de valorisation soit intégrée comme nouvelle tâche systématique,
-
générer et imprimer les supports de valorisation à installer dans les rayons. Une étape supplémentaire qui consistait à enlever tous les anciens supports et à les remplacer par les nouveaux a été nécessaire pour certains sites.
Etant donné que ce projet allait toucher un très grand nombre de collaborateurs de la Bibliothèque, la gestion des communications au lancement, mais aussi tout au long du projet, était indispensable. Dès lors, des communications à deux niveaux, transversal et par site, ont été transmises à toute la Bibliothèque à des moments clés (séances de coordination du CODIS, réunions du comité de direction de la Bibliothèque, emails, newsletter interne, etc.). Au niveau des sites, les membres du groupe s’étaient chargés de relayer les informations (les procès-verbaux, séances d’équipe, lettres d’information des sites).
Lors de la dernière phase du projet, la communication interne s’est intensifiée afin de soutenir le déploiement sur les sites. Plusieurs documents ont été produits et ont servis de supports de communication :
-
un schéma de présentation de l’application (cf figure 1)
-
un guide d’utilisation
-
une vidéo de démonstration de l’interface “collaborateurs” d’Avalon
-
une vidéo de démonstration de l’utilisation de l’application UNIGE mobile pour accéder aux ressources (https://mediaserver.unige.ch/play/110505).
Six séances de présentation d’Avalon ont été organisées juste avant le lancement effectif. Ces réunions visaient à sensibiliser les collaborateurs de la Bibliothèque à la problématique de la valorisation des ressources numériques d’une part et à leur faire des démonstrations pratiques d’autre part. L’enjeu était que l’ensemble des collègues puissent prendre en main les fonctionnalités de l’application UNIGE mobile, notamment le lecteur de QR-codes et les fonctionnalités de la page intermédiaire. Au terme des présentations, les collègues devaient être familiers avec les nouveaux supports de valorisation installés dans les rayons afin de répondre aux questions des usagers et de les accompagner dans ces nouvelles pratiques.
Communication aux usagers
A l’occasion de la rentrée de septembre 2018, le lancement de ce nouveau service s’est accompagné de plusieurs actions de communication autour des fonctionnalités développées par la Bibliothèque dans l’application UNIGE mobile. En effet, une campagne de communication pour le lancement officiel de la version 2 de l’application mobile était prévue au même moment. Dès lors, il semblait plus pertinent de profiter de la visibilité offerte par cette campagne globale et décliner le visuel retenu pour la “Bibliothèque version mobile”.

Figure 12 : Affiches promotionnelles de l’application UNIGE mobile

Figure 13 : Flyer de promotion de « la Bibliothèque version mobile » (recto)
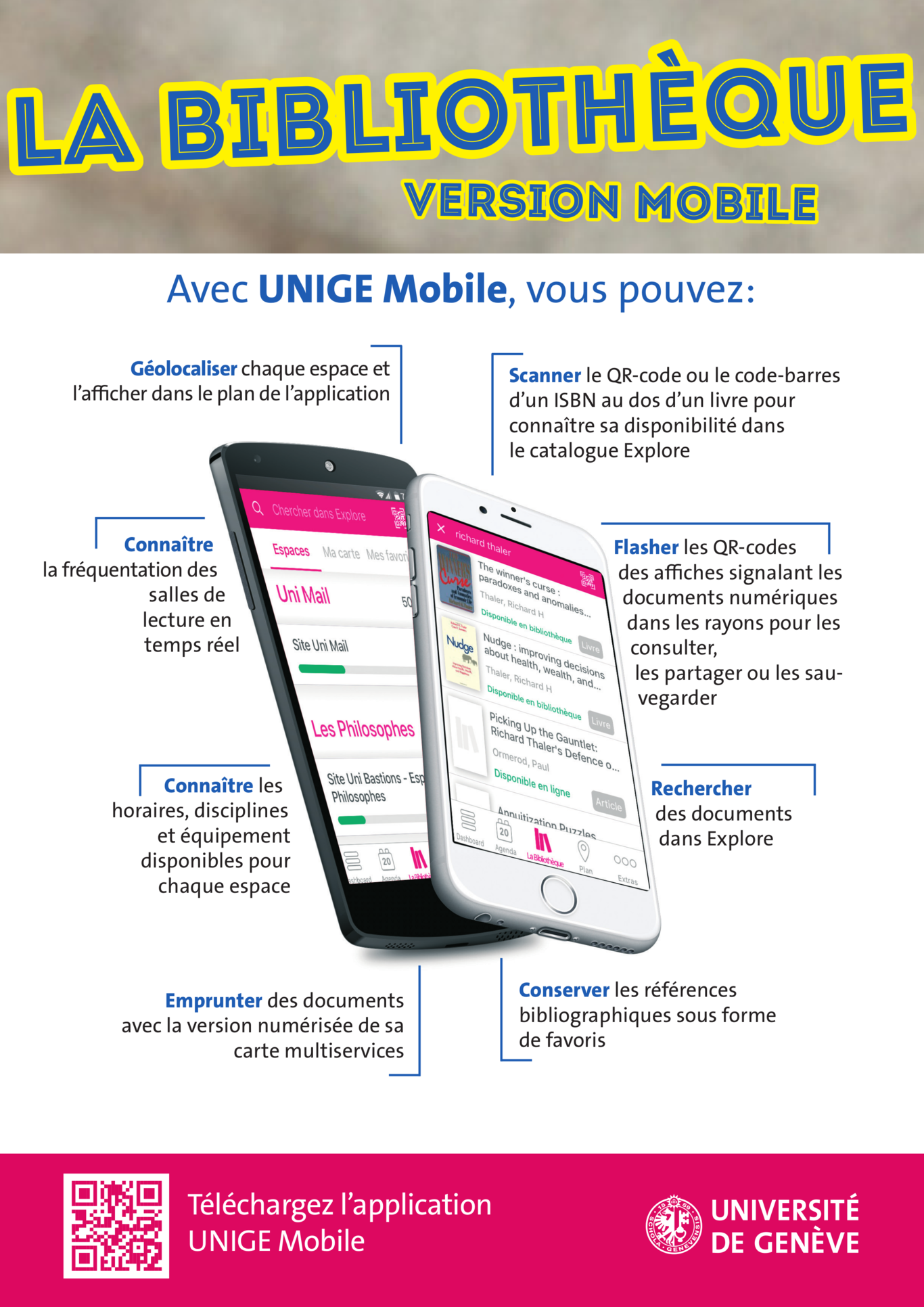
Figure 14 : Flyer de promotion de « la Bibliothèque version mobile » (verso)
Retour d’expériences
A ce stade du projet, l’un des premiers constats est l’importance de l’accompagnement et la communication, notamment dans la phase de déploiement. Malgré les efforts déployés, ces nouveaux supports de facilitation ne sont pas encore perçus par l’ensemble des collaborateurs comme un service à part entière de la Bibliothèque. Cela peut s’expliquer par un manque de temps ou d’intérêt face aux nouvelles technologies.
L’une des difficultés majeures rencontrées dans ce projet est inhérente à l’organisation interne et à la taille de la Bibliothèque de l’UNIGE qui fonctionne selon deux dimensions ; transversale et par site. Cette structure conditionne l’organisation de ce type de projet qui implique une gestion centralisée avec un groupe de travail multisites, mais un déploiement qui doit tenir compte des besoins et des contraintes au niveau local. Ce fonctionnement a l’avantage de laisser une grande autonomie aux sites tout en encourageant l’appropriation de l’application Avalon. A titre d’exemple, tous les sites ont pu déployer les supports de valorisation selon un processus et un rythme propres. Cette souplesse implique toutefois une perte de la vision d’ensemble et un déploiement décalé dans le temps.
Les retours des collègues impliqués sur l’application Avalon ont été très positifs. La formation et le matériel mis à leur disposition lors de la phase de déploiement ainsi que l’ergonomie et la simplicité d’utilisation de l’interface ont contribué à la prise en main rapide de l’outil et permis la création d’un grand nombre de supports en peu de temps.
Un facteur de réussite important du projet est lié à sa temporalité qui a coïncidé avec le développement de l’application mobile institutionnelle. Ainsi, il a été possible d’intégrer le lecteur de QR-codes parmi les fonctionnalités de la section “Bibliothèque” de l’application mobile de l’Université, anticipant son intégration sur les nouveaux smartphones.
Conclusion et suites du projet
A l’heure où nous écrivons ce texte, cela fait seulement 4 mois que les supports de valorisation ont été placés dans les rayons de la Bibliothèque et notre expérience se limite pour le moment aux étapes de conception, développement de l’application et déploiement. La collecte de statistiques d’utilisation de ces supports, consultables par les administrateurs sur l’application Avalon, a bien démarré à la rentrée universitaire de septembre 2018. À ce stade, la période observée est trop courte pour analyser l’impact de ce nouveau service auprès du public ainsi que sur le nombre de consultations des ressources valorisées.
Il est prévu de réaliser un bilan du projet une année après le lancement (septembre 2019). L’objectif sera de vérifier l’intégration de ces nouvelles pratiques de consultation des ressources numériques par les collègues et les publics de la Bibliothèque. Il est également planifié d’analyser les statistiques d’usage des QR-codes, en coopération avec le pôle Ressources documentaires, afin de connaître l’impact des actions de promotion sur l’usage réel des ressources numériques valorisées.
La deuxième étape du projet qui consiste désormais à intégrer de nouveaux types de ressources numériques dans Avalon, notamment les périodiques et les bases de données, a déjà démarré et se poursuit actuellement avec le même groupe de travail. Selon le calendrier en cours et les discussions actuelles, au printemps 2019, Avalon pourra être utilisé pour promouvoir des bases de données, des périodiques électroniques, des sites Web et d’autres ressources multimédias.
Par la suite, il sera question de lancer un nouveau projet qui traitera de la création d’une nouvelle solution technique de promotion en ligne des documents physiques et numériques.
Bibliographie
Barron G. (2014) Intégrer des ressources numériques dans les collections. Villeurbanne: ENSSIB.
Jeanson A. (2013) Les services innovants liés au numérique: l’exemple des bibliothèques universitaires [Mémoire d’étude]. Villeurbanne: ENSSIB. Disponible sur: http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/60394-les-services-i...
Meury M. (2013). Les QR codes en bibliothèque: un exemple de médiation numérique au service des usagers [Mémoire de Certificate of Advanced Studies (CAS)]. Université de Fribourg. Disponible sur: http://doc.rero.ch/record/209354/
Pouchot S, Vieux A, Peregrina R. (2016) Si proche, si loin: prêt de ebooks en bibliothèque: la situation en Suisse romande. In: Les Presses de l’ENSSIB. p. 37‑54. (Collection Les numériques). Disponible sur: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01412659
Souchon, F. (2014). Faire vivre les ressources numériques dans la bibliothèque physique. Le cas des bibliothèques universitaires. [Mémoire d’étude]. Villeurbanne: ENSSIB; Disponible sur: http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/64182-faire-vivre-le...
Vieux A. (2014). Signaler et valoriser les ressources documentaires numériques en bibliothèque universitaire: quels enjeux pour la Bibliothèque de l’Université de Genève? 2014; Disponible sur: https://archive-ouverte.unige.ch/unige:91498
Valoriser les ressources électroniques en bibliothèque. http://www.enssib.fr/offre-de-formation/formation-continue/18e34-valoris...
- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires
Quelle veille pour les start-ups ? compte rendu de la 15ème journée franco-suisse sur la veille stratégique et l’intelligence économique, 14 juin 2018, Besançon
Ressi — 20 décembre 2018
Hélène Madinier, Haute Ecole de Gestion, Genève
Quelle veille pour les start-ups ? compte rendu de la 15ème journée franco-suisse sur la veille stratégique et l’intelligence économique, 14 juin 2018, Besançon
La 15ème journée franco-suisse en veille et intelligence économique s’est tenue jeudi 14 juin 2018 à Besançon à la Communauté d’universités Bourgogne-Franche-Comté (COMUE) sur le thème de «Quelle veille pour les start-ups ? ».
Cette journée, qui a rassemblé environ 60 personnes, était subventionnée par la Communauté du savoir, réseau de l’Arc jurassien franco-suisse, visant à «renforcer, valoriser et stimuler les collaborations franco-suisses en matière de recherche, d’enseignement et d'innovation ». [1]
Après des mots de bienvenue des représentants de cette communauté et de celle de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, Pascale Brenet, maître de conférences à l’IAE de Besançon, directrice de PEPITE BFC (et membre du comité des journées franco-suisses), exposait les objectifs et enjeux du thème de la journée dans l’intervention d’ouverture intitulée Quelle veille pour les start-up : les besoins d’information associés au processus entrepreneurial .
Un startuppeur est confronté à 2 écueils : la difficulté de trouver l’information pour un produit ou un service qui n’existe pas et la menace de la surinformation si la recherche est trop large, d’où la nécessité de structurer ses questionnements.
Le futur entrepreneur a une idée précise, une intention, une envie d’entreprendre. Le processus entrepreneurial résulte d’une co-construction sur l’opportunité d’entreprendre avec les parties prenantes, de séquences et d’itération, puis de décisions et d’actions spécifiques. La veille doit aider à identifier s’il y a opportunité d’entreprendre.
L’idée est de s’inspirer de la lean start-up : fabriquer et vendre rapidement pour tester et mesurer le marché et adapter son offre en conséquence, plutôt que de faire une étude de marché.
Comme il existe une échelle de Technology Readyness Level, Pascale Brenet propose une échelle de Market Readyness Level avec 9 niveaux :
-
Définition du concept
-
Identification de l’OE (opportunité d’entreprendre) par données secondaires
-
Etalonnage concurrentiel
-
Définition de la proposition de valeur orientée utilisateur
-
Etude qualitative du marché (test hors marché)
-
Identification d’une liste de prospects
-
Lancement test / MVP (minimum viable product)
-
Lancement commercial sur un segment de marché
-
Développement du marché.
La veille et la recherche d’information vont aider à étudier l’environnement stratégique, la dynamique de marché, l’étalonnage de la concurrence et les comportements et attentes des utilisateurs. Le startuppeur devra décider s’il procède lui-même à la recherche et à la veille ou s’il sous-traite, et il lui faudra être attentif à la fiabilité des sources, au coût et à l’actualité des informations identifiées, et enfin à analyser et sélectionner les données actionnables.
Ensuite, Frédéric Martinet, fondateur et gérant de Actulligence Consulting, consultant en systèmes de veille a proposé une méthode de veille en 10 minutes chaque jour et introduit l’atelier de l’après-midi: « Veillez en 10 mn par jour » : préparation de l’atelier de l’après-midi.
La vie d’un entrepreneur de start-up consiste à prendre des décisions. Il n’a en général pas le temps de faire de la veille, mais doit se tenir informé. Les responsables de start-up disent connaître leur domaine, mais ne savent pas toujours bien chercher l’information en fonction de leurs besoins et ne connaissent pas les outils. F. Martinet propose la méthode suivante : il s’agit de comprendre le besoin, d’identifier les acteurs-clés, demander leurs sources d’information incontournables, définir le champ lexical autour de leur activité (différent du lexique utilisé pour le marketing), en s’alignant sur le processus décisionnel et en faisant des priorités. Il demande alors au public des exemples de thématiques. Les 3 suivantes sont proposées :
- Le confort acoustique dans un avion-réducteur de bruit dynamique
- Un outil de liaison micromécanique pour les mouvements de rotation- pour l’horlogerie- l’énergie-
- L’immunothérapie pour soigner les tumeurs solides des cancers
La troisième intervention de la journée était assurée par Ali Yacin El Ayouch, chercheur postdoctoral, Institut FEMTO-ST, et Youssef Tejda, ingénieur de recherche, Institut FEMTO-ST. Ils ont présenté le projet innovant «Métabsorber» et leur démarche de recherche d’information.
La pollution sonore, avec les maladies qu’elle occasionne, coûte plus de 57 milliards d’euros par an. En ville, elle provient à 60% des transports. Les deux chercheurs proposent une technologie de rupture sur les méta-matériaux, c’est-à-dire faire qu’un méta-matériau soit ultra-réflecteur et ultra-absorbeur. Il faut pouvoir travailler sur du verre, du bois et des métaux.
Les marchés possibles sont l’ameublement, les transports, et l’industrie. Ils travaillent sur le mobilier acoustique, et la recherche d’information effectuée les a amenés à l’idée de structurer d’emblée le mobilier et non pas devoir ajouter des éléments anti-bruit.
Finalement, Sandy Wetzel, CEO de l’incubateur Neode, ancien directeur de Y-Parc à Yverdon-les-Bains, et Dr. Khalid Zahouily, fondateur et CEO de Horlovia Chemicals, ont conclu cette matinée.
Sandy Wetzel présentait : Quels outils et quels soutiens pour la veille des start-up technologiques à Neuchâtel ? Neode est l’incubateur du canton de Neuchâtel qui met en relation les start-ups avec des experts des industries concernées, qui les guide sur le terrain (dans des salons), leur permet d’avoir accès à des prestataires (comme Centredoc) et accompagne la collaboration entre startups et PME établies.
Il s’agit d’aider les start-ups à définir leur marché ; ces start-up ne doivent pas s’éparpiller mais bien veiller à rester sur leur «core business».
Il y a plusieurs dispositifs de soutien de la veille à Neuchâtel : quatre plateformes sectorielles, des missions économiques, une antenne à San Francisco (Neuchâtel innohub@san francisco), ainsi que des aides financières directes du canton.
Ensuite, Dr Khalid Zahouily, CEO de Horlovia Chemicals, a d’abord présenté sa société, qui a développé des matériaux polymères innovants pour l’horlogerie et l’industrie du luxe : elle propose des revêtements temporaires de protection des montres. Il a montré comment la veille effectuée sur la protection temporaire des montres l’avait aidé aussi bien à identifier des marchés, à affiner ses produits pour qu’ils correspondent à ce qui est recherché, à fixer ses prix qu’à trouver des informations technologiques lui permettant de trouver plusieurs méthodes d’application de son film protecteur. Les informations recherchées étaient notamment les solutions existantes, les volumes des marchés horlogers, les prix des protections concurrentes etc… Outre Google, ses sources ont été les manufactures horlogères, les sous-traitants, les fournisseurs de consommables, les foires et salons (comme EPHJ) ainsi que les clients.
En début d’après-midi, David Borel, directeur du développement à Centredoc, a présenté les prestations proposées aux start-ups par son organisation Centredoc, société coopérative qui offre des prestations dans les domaines de la veille technologique, concurrentielle et stratégique ainsi que dans la recherche d’information brevets, techniques et économiques, et qui existe depuis plus de 50 ans (voir Quelles prestations pour les start-up clientes de Centredoc ?)
Centredoc se définit comme un opticien pour entrepreneurs, leur permettant de mieux anticiper. Il apparaît en effet que la plupart des responsables de start-up ne connaissent pas les sources d’information de brevets, et se reposent sur Google, ce qui est très insuffisant vu les quelques 12 millions de demandes de dépôt de brevets, d’enregistrement de marques et modèles par an ; cela revient à 5% de visibilité. Or le circuit est miné car des brevets peuvent exister sur ce que les start-ups proposent : à défaut de recherches ciblées et suffisantes, les entreprises peuvent être accusées de copie involontaire de brevet.
Centredoc accompagne les start-up avec une méthode en 3 étapes : idéation, business plan et financement.
L’étape d’idéation permet d’aider la start-up à faire sa recherche de brevets, et de démarrer une veille technologique plus large (y compris normes et publications scientifiques) sur le produit/service projeté. L’étape du business plan doit permettre d’aider à transformer l’idée en opportunité d’affaires : identification et segmentation des clients et partenaires, précision des marchés possibles ; et l’étape de financement permet de rassembler des preuves, de mettre en œuvre une veille brevet permanente pour rassurer les investisseurs.
Centredoc anime également des formations permettant d’apprendre à lire des brevets.
Finalement, pour illustrer son atelier de veille en 10 minutes par jour, Frédéric Martinet a traité un des exemples proposés le matin : l’isolation acoustique en aéronautique. Il s’agit tout d’abord d’arriver à formaliser un champ lexical, pour faire des requêtes complètes. Pour ce faire, il recherche cette expression en français et en anglais (Aeronautics acoustic insulation) sur Google, ce qui lui permet d’identifier des sources d’information et de trouver des synonymes ou des termes associés (comme vibration, par exemple), et cela lui permet de trouver des noms de sociétés, d’associations professionnelles, de fabricants comme Aerospace, Hutchinson, Dunmore, 3M ; il va ensuite sur les sites des fabricants pour voir leurs produits, leurs partenaires (laboratoires de recherche), ce qui donne des acteurs-clés. Il identifie des sources d’information comme des revues spécialisées (Journal of the acoustical society of America par exemple), des bases de données spécialisées et crée ensuite des alertes sur les sources pertinentes –attention à Google alerts, qui passe à côté de trop de choses, et filtre la langue et le pays qui correspondent au compte Google.
Il préconise de les agréger dans Inoreader et d’y adjoindre des filtres. Il suggère ensuite d’utiliser soit son Intranet ou Sharepoint ou alors Slack pour diffuser les résultats de sa veille.
Après cette brillante démonstration, François Courvoisier a synthétisé les points-clés de cette journée franco-suisse très instructive, riche en témoignages et en échanges.
Notes
[1]Voir l’article sur les bibliothèques de la communauté du savoir, dans ce même numéro
- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires
Conférence nationale Open Access
Ressi — 20 décembre 2018
Benoît Epron, Haute école de Gestion, Genève
Conférence nationale Open Access
Le 26 octobre 2018, swissuniversities organisait une conférence nationale Open Access à l'Université de Lausanne.
A l'occasion de la semaine internationale de l'Open Access, cette journée souhaitait proposer un point sur l'Open Access dans un contexte suisse marqué par la mise en place de la stratégie nationale suisse sur l'Open Access et par l'annonce du Plan S (initiative de soutien à l’Open Access porté par la commission européenne et Science Europe).
Au travers des différentes interventions cette journée, qui a rassemblé 300 personnes environ, a permis de dresser un état des lieux des problématiques liées à la dynamique Open Access en Suisse.
Ces problématiques se retrouvent principalement à trois niveaux, académique, économique, politiques, repris par plusieurs intervenants. Nous proposons ici un compte rendu personnel de cette journée, il reflète notre propre lecture des enjeux et informations marquantes et ne prétend pas retranscrire l'intégralité des interventions et des débats.
Le premier plan est un plan académique. Tout au long de la journée ont été abordées deux facettes académiques de l'activité de publication scientifique. La première concerne la problématique de la diffusion et des usages. Souvent oublié, cet aspect des modèles OA de l'édition scientifique a été illustré lors de cette journée par la présentation de Mme Nouria Hernandez, rectrice de l'Université de Lausanne. Ainsi, lors de son intervention elle a évoqué la situation de Serval, dépôt institutionnel de l'Université de Lausanne et dont la fréquentation a quasiment doublé en septembre 2018 pour atteindre 100 000 consultations, notamment à l'occasion de l'intégration de Serval dans Google Scholar. Cette variation illustre par l'exemple un paradoxe des dépôts institutionnels, utilisés d'une part par les institutions universitaires comme infrastructures support pour l'Open Access et l'évaluation des chercheurs et dont d'autre part l'utilisation par les chercheurs eux-mêmes passe largement par Google Scholar, les rendant de fait peu visibles.
Sur le plan académique, la question des indicateurs de la recherche a également été largement abordée avec deux problématiques différentes s'y rattachant.
D'une part la nécessité d'imaginer de nouveaux indicateurs de la production scientifique permettant d'échapper à la dépendance actuelle vis-à-vis des plateformes fournissant actuellement les principaux indicateurs bibliométriques. Cette dépendance est donc double, elle concerne d'une part les indicateurs eux-mêmes qui restent uniquement quantitatifs et placent les revues et les éditeurs au centre des processus d'évaluation et de recrutement. Elle porte également sur les producteurs de ces indicateurs, plateformes d'éditeurs commerciaux qui s'appuient sur la maîtrise d'une part quasi-exhaustive des publications d'un domaine pour produire ces indicateurs.
Cette situation restreint le champ des possibles pour le développement de modèles Open Access pour la publication scientifique en rendant incontournables certaines revues et plateformes.
Sur le plan économique, la dynamique suisse de l'Open Access est confrontée à une situation de transition. Cette transition des modèles de publication académique est déjà bien avancée en Suisse. Ainsi d'après la présentation de Mme Angelina Kalt, Directrice générale du Fonds national suisse de la recherche scientifique, ce sont aujourd'hui 28% des publications scientifiques suisses qui sont disponibles en Green Open Access (auto-archivage de la publication par l’auteur dans une archive ouverte, souvent après une période d’embargo) et 11% disponibles en Gold Open Access (publication directement accessible en Open Access, souvent avec un financement en amont). Cela laisse donc 61% des publications non disponibles en Open Access en Suisse et place la Suisse devant les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Autriche, la France, l'Allemagne et l'Italie, qui atteignent un taux de publication indisponibles en Open Access compris entre 64% et 72%.
Ce développement fort de l'Open Access en Suisse laisse toutefois une réelle marge de progression pour laquelle le FNS souhaite se positionner comme un levier d'accompagnement des politiques OA, que ce soit pour les revues ou pour les monographies.
L'ambition suisse pour le développement de l'Open Access vise un passage de la totalité des publications en Open Access à l'horizon 2024, soit après l'échéance prévue au niveau de l’Union européenne en 2020.
Du point de vue financier, la présentation de M. Michael Hengartner, Président de swissuniversities et Recteur de l'Université de Zurich, s'appuyait en partie sur l'étude Financial Flows in Swiss Publishing produite en 2016 pour le FNS. Il en a présenté quelques données et notamment le coût total d'accès à l'information en Suisse, soit approximativement 109 millions de francs suisses. Ce montant se répartit de la façon suivante : 70 millions pour les abonnements à des revues, 31 millions pour l'achat de monographies, 6 millions pour les APC (Articles Processing Charges, financement amont par le chercheur ou son institution pour rendre son article disponible en Open Access sans embargo) et 2 millions pour les infrastructures.
Les enjeux financiers relevés dans cette étude rejoignent les interrogations de Mme Nouria Hernandez qui s'inquiète de la capacité des institutions comme la sienne de supporter le triple coût de la publication académique de ses chercheurs aujourd’hui pour lesquels elles doivent assurer à la fois le prix des abonnements, celui des APC et enfin le coût de développement et de maintenance des infrastructures nécessaires à la mise en place des dépôts institutionnels.
A ces coûts il convient enfin d'ajouter les efforts de pédagogie et d'acculturation portés par les institutions scientifiques à destination des chercheurs et qui apparaissent prioritaires dans l'étude annuelle sur l'Open Access réalisée par l'EUA (European University Association). En effet, les trois actions prioritaires d'après cette enquête sont, par ordre d'importance, la sensibilisation des chercheurs, la mise en place d'incitations supplémentaires à destination des chercheurs et enfin la mise en place de politiques nationales de soutien à l'Open Access.
Cette enquête européenne présentée par M. Jean-Pierre Finance, Président de l'Open Science Experts Group, au sein de European University Association, a permis d'apporter d'autres éléments financiers à la réflexion. En effet, l'enquête chiffre à plus de 421 millions d'euros les dépenses annuelles pour les périodiques, les bases de données et les livres numériques, dont plus de 383 millions d'euros pour les seuls périodiques.
Plusieurs intervenants ont enfin balayé plusieurs enjeux politiques relatifs à l'Open Access. Le premier de ces enjeux a été la nécessité d'une organisation cohérente et unifiée des différents acteurs. C'est dans cette logique que devrait se mettre en place d'ici le premier trimestre 2019 une Open Access Alliance pilotée par swissuniversities (programme P-5) et regroupant l'ensemble des parties prenantes : Académies, éditeurs suisses, CSS (Conseil suisse de la science), etc. mais également des membres de projets comme Sliner, le FNS ou la délégation recherche de swissuniversities.
La place des HES dans les modèles Open Access a également été soulignée avec notamment la nécessité de concevoir des solutions qui permettent de prendre en compte les partenaires économiques impliqués dans l'activité de recherche appliquée des HES et pour lesquels l'ouverture des résultats doit se construire de façon cohérente avec leurs enjeux économiques et commerciaux.
La journée s'est terminée sur une intervention rafraichissante de M. Jacques Dubochet, prix Nobel de Chimie en 2017, qui a replacé, à travers son expérience de chercheur, "la connaissance comme un bien commun pour le bénéfice de tous".
- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires
Les archives démocratiques
Ressi — 20 décembre 2017
Andreas Kellerhals, Directeur des Archives fédérales suisses
Aude Thalmann, traductrice
Les archives démocratiques
En Europe, les archives sont des archives de démocraties. Sont-elles pour autant des institutions démocratiques ? Doivent-elles ou peuvent-elles être démocratiques ? Aujourd’hui, les archives sont aussi des archives de la société de l’information. Sont-elles pour autant numériques ? La démocratie numérique constitue-t-elle l’accès au paradis de l’information ? Répondre spontanément à ces questions par l’affirmative semble difficile. Pour ce qui est de la thématique principale – les archives démocratiques – la réponse dépend dans une large mesure de ce que l’on entend par démocratique, des attributs que l’on associe à la démocratie. Comme le montrent (malheureusement) de nombreux exemples d’États de non-droit et de dictatures, les archives ne sont en soi ni démocratiques ni des institutions de la démocratie.
S’interroger sur la nature démocratique et numérique des archives ne vise pas à analyser des aspects techniques ou organisationnels. Il s’agit plutôt d’examiner les conditions de production et d’utilisation de l’information qui se cachent derrière les notions de cyberdémocratie, d’administration 4.0, des sciences participatives et d’autres néologismes du même ordre [1]. Nous allons apporter un éclairage sur ce point à partir de l’exemple des Archives fédérales suisses.
Il y va notamment de la possibilité de s’approprier le passé pour construire son identité, des débats sur ce passé et de leurs conséquences pour le présent et pour l’avenir. Une société pluraliste se doit de créer les conditions nécessaires à l’établissement d’une vision pluraliste de l’histoire[2]. Une politique de mémoire orientée est une politique qui réduit la démocratie. Pour construire la mémoire collective, l’archivage doit renforcer ce pluralisme en intégrant aussi des traces alternatives d’actions et de décisions[3]. En d’autres termes, il s’agit d’éviter que « les archives […] soient créées, exploitées et utilisées comme des institutions de l’infatuation, de la vengeance, de l’indignation et du ressentiment », que l’archivage soit utilisé « cryptodémocratiquement » essentiellement pour consolider le monopole de l’information, comme complément indispensable du monopole du pouvoir[4].
Pour ce qui est du caractère démocratique des archives, la formulation de Jacques Derrida me semble constituer – compte tenu des différentes définitions de la démocratie et de la diversité des États qui se disent démocratiques – un bon point de départ[5] : « Nul pouvoir politique sans contrôle de l’archive, sinon de la mémoire. La démocratisation effective se mesure toujours à ce critère essentiel : la participation et l’accès à l’archive, à sa constitution et à son interprétation. »[6]
Au-delà du lien de dépendance entre pouvoir politique et contrôle sur les archives ou sur la mémoire, deux aspects clés du travail en archivistique sont abordés ici : l’évaluation et la sauvegarde des informations d’une part, l’organisation de l’accès et l’accessibilité des informations d’autre part.
Accès aux archives selon la loi
Commençons, en parcourant le cycle de vie des informations à l’envers, par la question de l’accès aux archives. Un éclairage peut être apporté d’un point de vue juridique / théorique (accès) et d’un point de vue pratique (accessibilité). Le cadre légal est fixé par la loi fédérale sur l’archivage (LAr) du 16 juin 1998 (RS 152.1)[7]. Historiquement, cette loi s’inscrit dans la tradition de la première loi sur l’archivage, fondatrice des archives nationales françaises, à savoir la loi du 7 messidor an II (25 juin 1794) concernant l’organisation des archives établies auprès de la représentation nationale, dont l’art. 37 définit le libre accès aux archives : « Tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux jours et aux heures qui seront fixés, communication des pièces qu'ils renferment : elle leur sera donnée sans frais et sans déplacement, et avec les précautions convenables de surveillance. »[8] Ce principe, révolutionnaire à l’époque et qui tombe sous le sens aujourd’hui, est repris à l’art. 9 de la LAr (Principe de la libre consultation et délai de protection) : « Les archives de la Confédération peuvent être consultées librement et gratuitement par le public après l’expiration d’un délai de protection de 30 ans ».
Les Archives fédérales suisses, qui ont succédé aux Archives centrales de la République helvétique, ont ainsi créé un point de rattachement à l’époque de la Révolution. La LAr s’éloigne toutefois du principe d’accès énoncé encore dans l’ancien règlement relatif aux archives fédérales, selon lequel « les documents […] sont accessibles au public après l’expiration d’un délai de 35 ans, à la condition toutefois que des intérêts publics ou privés importants ou dignes d’être protégés ne soient pas mis en péril ». Des autorisations dérogeant au délai général de 35 ans pouvaient néanmoins être accordées « à des fins scientifiques »[9]. Dans la nouvelle loi, les restrictions d’accès sont reléguées au second plan et les conditions particulières pour le champ des sciences supprimées. Ce changement est à mettre au compte de la nouvelle place occupée par le droit d’archivage dans la systématique du droit : la LAr ne régit plus simplement la documentation, elle est devenue une composante essentielle de l’ordre juridique fondamental, de la liberté d’information et d’opinion[10]. Avec cette nouvelle base légale, les scientifiques se retrouvent au même niveau que les autres citoyens[11].
Si ce cadre légal donne une définition abstraite de l’accès aux archives, l’accessibilité pratique demeure dépendante des prestations fournies par les archives. L’art. 10 de l’ordonnance relative à la loi sur l’archivage (OLAr) précise ce que comprend le droit de consulter les archives : la consultation des instruments de recherche, la consultation des documents et leur reproduction, ainsi que la reproduction et l'exploitation des informations recueillies, sous réserve des dispositions relatives à la protection de la personnalité, en particulier de celles de la protection des données[12].
Les conditions légales de l’accès démocratique aux archives sont donc posées au niveau fédéral. La première étape consiste à concevoir un accès légalement démocratique aux archives, la seconde à le mettre en œuvre démocratiquement. Mais il convient tout d’abord de s’interroger sur ce à quoi précisément l’accès est accordé.
Constitution des archives : sélection, sauvegarde, description
Les archives auxquelles l’accès est accordé sont le fruit d’un processus de sélection comportant plusieurs étapes. L’administration n’enregistre pas tout ce qui a été pensé, débattu, décidé et communiqué dans le cadre de ses activités. À cela s’ajoute que seule une partie des informations susceptibles d’être archivées le sont effectivement[13]. La description des documents réellement versés aux archives restreint un peu plus les documents pertinents pour les utilisateurs. Les deux premières étapes de sélection – depuis longtemps objet d’une structuration active (mot d’ordre : gestion électronique des affaires) – sont irréversibles, tandis que la dernière, non moins importante, permet des rectifications.
La première étape de sélection, qui implique la participation des Archives fédérales, est l’évaluation. Comment faire pour qu’elle s’organise selon des principes démocratiques ? En matière d’évaluation, la LAr prévoit une coopération entre les Archives fédérales et les unités administratives qui produisent les informations. Chaque partie procède selon des critères d’appréciation différents. Les unités administratives évaluent la valeur archivistique des documents en fonction de critères juridiques et administratifs. S’appuyant sur des considérations historiques et sociales, les Archives fédérales placent quant à elles la constitution des archives dans une perspective à long terme. En cas de désaccord, les services administratifs ne doivent détruire aucun document qui mérite d’être archivé selon les Archives fédérales, tandis que ces dernières sont tenues d’archiver tous les documents proposés par les services administratifs[14].
Dans le cadre de l’administration numérique, ces décisions sont des décisions prospectives. Avant la création des documents, une pertinence potentielle est présumée en fonction de la catégorie d’affaires considérée (affaires avec atteinte aux droits fondamentaux, assorties de conséquences profondes ou irréversibles / difficilement réparables), ce qui permet d’optimiser les processus de sauvegarde après une évaluation positive. Si l’on dispose, fondamentalement, d’un temps suffisant pour corriger les évaluations, il est aussi possible d’éviter le versement aux archives (p. ex. si des données sensibles ont été enregistrées dans des dossiers qui n’étaient pas destinés à l’archivage). L’évaluation – même prospective – reste donc une décision délicate « qui a des conséquences finales »[15].
Démocratiser l’évaluation reviendrait en somme à étendre la participation des services qui produisent les informations et de ceux qui les archivent aux utilisateurs des informations. Si cela peut paraître simple, les problèmes suivants se posent :
- Il ne peut y avoir évaluation que si les services producteurs accordent l’accès à leur système de classement et de gestion des documents. Si cela ne pose pas de problème aux Archives fédérales en interne, il n’est pas certain qu’une telle transparence soit appliquée vis-à-vis de tiers.
- Les Archives fédérales ne peuvent se soustraire à leur responsabilité décisionnelle. La décision finale ne peut pas être prise en fonction de critères et d’intérêts variables ; le patrimoine archivistique doit afficher une cohérence à long terme.
- Enfin, la question de la légitimité de la participation se pose. Qui peut participer ? Tous ceux qui le souhaitent ou seulement ceux ayant une qualification particulière ? Qui a une légitimité démocratique ? Les citoyennes et les citoyens ou toutes les personnes concernées ?
Répondre à ces questions ne pose pas de difficulté majeure. Ces aspects doivent être considérés sérieusement si l’on entend démocratiser l’évaluation de la valeur archivistique des documents. Le 10 novembre 2017, les Archives fédérales ont fait un premier pas dans ce sens en proposant un atelier sur le thème de la construction des routes nationales – un sujet certes non sensible, mais qui suscite beaucoup d’intérêt. L’atelier réunira, outre une délégation des Archives fédérales, des représentants d’autres archives (archives cantonales notamment), les utilisateurs intéressés (fédérations de transports, spécialistes de la construction routière, historiennes et historiens des transports) et les producteurs d’informations. Le sujet est intéressant non seulement parce que les intéressés sont nombreux et que les transports sont aujourd’hui au centre de nombreux débats, mais aussi parce qu’en 2008 les compétences en matière de construction routière ont été redéfinies et les attributions de l’Office fédéral des routes (OFROU) élargies[16]. Les archives cantonales détenaient auparavant dans ce domaine de nombreux documents qui n’étaient pas centralisés. Des conditions presque idéales pour la constitution coopérative et la structuration participative des archives. L’enjeu est donc de se concerter pour définir ce qui doit être conservé et entrer dans un inventaire des infrastructures routières historiques. L’objectif est de fournir plus de renseignements que la Table de Peutinger qui répertorie les principales routes et villes de l’Empire romain, sans pour autant tomber dans l’exagération et conserver chaque plan détaillé à l’échelle 1:10.
La constitution démocratique des archives implique donc bien plus qu’une simple publication des décisions d’évaluation : elle passe par une véritable participation, qui doit se substituer à la pratique actuelle des commentaires a posteriori. Mais qui dit participation ne dit pas nécessairement codétermination. Il ne s’agit pas de démocratiser entièrement la compétence en matière d’évaluation, même si l’on vise une amélioration de la qualité de la sélection[17].
Pour une sélection de qualité, il importe que les informations appropriées atterrissent dans les bons dossiers et que toutes les étapes essentielles des activités documentées soient disponibles sous une forme figée et donc archivable. Autrefois, les conversations téléphoniques étaient source d’informations peu ou non documentées. Le relais a été pris aujourd’hui par les SMS, les tweets et les autres communications éphémères via les réseaux sociaux. Malheureusement, les informations transmises via ces canaux parviennent trop rarement jusqu’aux archives et il y a suffisamment de raisons de penser que cela ne changera pas de sitôt. Une situation que les Archives fédérales cherchent à faire évoluer avec la gestion numérique des affaires, la création d’un écosystème informationnel permettant de conserver les traces documentaires voulues sans que cela implique de difficultés et contraintes particulières pour les acteurs. Grâce à la consolidation d’une gestion consciencieuse des affaires, à l’évaluation prospective et à la meilleure vue d’ensemble des informations à traiter, il est désormais possible d’avoir une idée de l’étendue des documents versés aux archives, d’identifier les lacunes et d’y remédier avant qu’il ne soit trop tard. Cela induit une amélioration non seulement théorique (évaluation), mais aussi pratique (versement des documents) de la constitution des archives.
Aux Archives fédérales, il n’y a pas que l’évaluation prospective qui s’effectue à partir des systèmes de classement (anciennement : cadres de classement). C’est aussi le cas pour l’activité de description. Les temps de la classification, de la description, du référencement et de l’inventorisation en interne sont révolus. Nous avions accusé un trop grand retard dans ces tâches d’une part, les coûts étaient trop élevés pour un accès qui n’offrait pas la meilleure efficacité d’autre part. Les bordereaux de versement et les séries des plans / cadres de classement sont aujourd’hui les principaux éléments d’orientation. Les instruments de recherche reflètent leur structure et leur terminologie (coexistence de plusieurs jargons techniques), ce qui a une incidence sur l’accessibilité pratique des archives.
Accessibilité des archives
La consultation libre des instruments de recherche est une condition essentielle de l’accès aux archives. Compte tenu du régime de protection des archives en vigueur, c’est aussi une condition sine qua non pour les demandes d’accès aux archives soumises au délai de protection[18].
La qualité de l’accessibilité dépend par ailleurs de la qualité des instruments de recherche et des outils de consultation. Les instruments de recherche ne permettent que partiellement une exploitation ciblée et efficace des archives. Ainsi, la logique de la provenance – malgré tous les avantages méthodologiques qu’elle présente – n’est pas une logique évidente, elle engendre souvent un certain hermétisme. Les inventaires les plus détaillés laissent rarement entrevoir toute la richesse des documents archivés qui seraient disponibles pour des utilisations non intentionnelles : en saisissant « Raubkunst » / « art spolié » / « looted art » dans la base de données des Archives fédérales, on obtient 44 occurrences, soit une toute petite partie des documents versés aux archives que Thomas Buomberger avait analysés en 1998, c’est-à-dire trouvés malgré les instruments de recherche existants[19].
Ici aussi, une plus grande participation serait envisageable. Comme le montrent différents exemples, la description et la transcription participatives peuvent être à l’origine d’améliorations et accroître l’exploitabilité des documents archivés. Elles peuvent être mises en place sur des thèmes pour lesquels il existe des communautés d’intéressés (images de la Suisse, chemins de fer / trains, etc.)[20]. Cela ne signifie pas que les Archives fédérales doivent s’en désintéresser : chaque participation active du public permet de s’engager un peu plus sur la voie du perfectionnement, sans pour autant viser la perfection. Elle permet le versement aux archives de ressources qui ne sont généralement pas disponibles directement, un avantage tant en termes d’efficacité que d’expertise (contenu).
Les expériences passées l’ont montré, nous n’atteindrons jamais la perfection. Cela ne saurait d’ailleurs constituer un objectif. Fortes de développements récents, les technologies de l’information offrent, des réseaux sociaux aux réseaux sémantiques, des possibilités insoupçonnées d’améliorations pragmatiques de l’accessibilité. Cela vaut pour l’accessibilité des archives individuelles comme des archives thématiquement liées mais réparties entre différents sites. Par ailleurs, les contenus des instruments de recherche peuvent être proposés sous la forme de données ouvertes et éditables. Les Archives fédérales mettent ainsi à disposition leur catalogue sur le portail opendata.swiss, pour l’heure sous la forme d’une base SQL, l’objectif étant de le proposer au format RD également. Un projet de coopérations entre plusieurs archives montre comment des informations peuvent être recherchées entre les institutions grâce à Archival Linked Open Data[21].
Le développement de la numérisation des documents versés aux archives et l’accroissement des volumes d’informations numériques disponibles élargissent considérablement le champ des informations éditables et consultables. Cela favorise l’orientation dans les archives d’une part, l’émergence de nouvelles formes et méthodes d’évaluation d’autre part. Dans une perspective démocratique, j’y vois une autonomisation intellectuelle notable des intéressés. De telles évolutions renforcent l’émancipation des utilisateurs vis-à-vis des spécialistes de l’archivage tout en offrant à ces derniers des possibilités intéressantes d’échanges. La réduction de l’écart d’expertise devrait s’avérer stimulante pour tous. Si, comme le prévoit la stratégie actuelle, on parvient à déplacer l’accès aux archives de la Confédération vers une salle de lecture virtuelle, les possibilités d’accès ne feront que se développer et on permettra à encore plus d’intéressés – du monde entier – d’utiliser ces archives moyennant un effort raisonnable et sans devoir franchir d’obstacles insurmontables.
Conclusions : les archives du peuple par le peuple et pour le peuple
Il existe une littérature abondante sur le thème des archives et de la démocratie. L’article de Max J. Evans paru en 2007 dans The American Archivist y occupe une place de choix, moins parce qu’il traite de façon exhaustive le sujet des archives démocratiques que parce que son titre pose des exigences élevées. Archives of the People, by the People, for the People fait référence au célèbre discours de Gettysburg prononcé par le président Abraham Lincoln en 1863, considéré aujourd’hui comme fondateur de la conception américaine de la démocratie[22]. Indépendamment de la question de l’adéquation d’une telle conception pour nous, le principe selon lequel les archives doivent être constituées et utilisées par les intéressés eux-mêmes pourrait guider notre réflexion.
Il est indéniable que les archives publiques conservent des documents « du peuple ». Que la sélection puisse / doive s’effectuer selon un horizon plus ouvert est une revendication légitime. Cela implique toutefois toujours de sélectionner, d’aller à l’essentiel, de concentrer. Nous sommes donc encore loin du tout-archivage. Ce qu’il faut entendre par « essentiel » mérite par ailleurs discussion.
Que nous archivions « pour le peuple » me paraît aussi une évidence. La LAr de 1998 définit le but de l’archivage comme suit (art. 2, al. 2) : « L’archivage contribue à assurer la sécurité du droit, ainsi que la continuité et la rationalité de la gestion de l’administration. Il crée, en particulier, les conditions nécessaires aux recherches historiques et sociales. » Si l’on considère que l’intérêt est avant tout de contribuer à la sécurité du droit et à l’efficacité de la gestion de l’administration, les documents versés aux archives forment une infrastructure « qui permet aux citoyens [et aux citoyennes] et aux chercheurs [et aux chercheuses] de consulter le passé de notre société et de notre État et d’écrire l'histoire. »[23]
Reste à savoir si cela peut être aussi fait « par le peuple ». L’archivage « par le peuple » est aujourd’hui plus facilement imaginable et plus facilement réalisable. Notons que la démocratie telle qu’on l’entend habituellement est une démocratie représentative, dans laquelle le gouvernement et l’administration bénéficient d’une délégation de compétences et de pouvoirs. Par extrapolation à l’archivage, il s’agit de la possibilité de participer aux processus de sélection et de description, ainsi qu’à d’autres décisions et activités. Comme pour la participation politique dans une démocratie, cette offre peut être acceptée (mais ne doit pas nécessairement l’être).
En tout état de cause, les archivistes se voient conférer une responsabilité déléguée qu’ils sont tenus d’assumer en vertu de leurs compétences professionnelles. Ils peuvent justifier et argumenter leurs choix dans le cadre d’un débat ouvert. L’exploitation d’une expertise précieuse supplémentaire (de nature différente) est une conséquence positive de la participation. Parallèlement, la participation permet « au peuple » de s’émanciper – non seulement vis-à-vis des experts archivistes, mais aussi des experts historiens : «Il est normal que les citoyens s’emparent de leur histoire. Et je le répète, l’historien de métier n’a pas le monopole du discours sur le passé, ni celui de l’accès aux sources.».[24] Démocratisation est ainsi synonyme d’opportunités de participation. Il en résulte une situation gagnant-gagnant. La démocratisation simplifie l’accès aux documents archivés. Ce serait toutefois aller trop loin que de prétendre que la consultation des archives deviendrait un sport national. Quelles que soient les simplifications effectuées, l’utilisation des archives demeure complexe. Démocratiser les archives n’implique pas simplement que leur accès soit estampillé Google : sapere aude[25] doit rester la devise et un enjeu en cette ère post-factuelle. Cela nécessite la maîtrise de la méthodologie historique, à savoir la critique des sources, une compétence de base que chacun devrait posséder dans la société de la surinformation pour ne pas risquer de replonger dans l’immaturité (autodéterminée ?). Participer à la constitution des archives et utiliser les archives par soi-même signifie aussi penser par soi-même.
Notes
[1] La cyberdémocratie (ou e-démocratie) consiste en l'utilisation d’Internet pour développer la démocratie, en se servant de sites web comme support des informations, des débats voire des processus de décisions démocratiques. La cyberdémocratie cherche à répondre à l’idéal démocratique dans lequel tous les citoyens seraient des participants égaux aux propositions, aux créations et à la mise en œuvre des lois.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyberd%C3%A9mocratie (page consultée le 04.10.2017)
Concernant l’administration 4.0, voir Jörn von Lucke : Smart Government. Wie uns die intelligente Vernetzung zum Leitbild „Verwaltung 4.0“ und einem smarten Regierungs- und Verwaltungshandeln führt (white paper), The Open Government Institute, Université Zeppelin de Friedrichshafen, 14.09.2015.
[2] Le pluralisme de l’information est régulièrement remis en question. Du fait par exemple de la concentration (économique) des médias amorcée depuis un certain temps déjà, ou plus récemment, de la suprématie effective d’un nombre très restreint de plateformes numériques organisant notre accès à l’information. Voir le dernier numéro de Réseaux : « Modèles économiques, usages et pluralisme de l’information en ligne. Les nouveaux enjeux du pluralisme de l’information à l’ère des plateformes numériques », Paris, 2017 (n° 205).
[3] Les cas des Verdingkinder ou des « enfants de la grand-route » sont de tristes exemples de non-prise en compte, dans les archives, des voix des personnes concernées et intéressées.
[4] [Notre traduction] Marcel Lepper, Ulrich Raulff : « Idee des Archivs », in : Marcel Lepper, Ulrich Raulff (dir.) : Handbuch Archiv. Geschichte, Aufgaben, Perspektiven, ORT, 2016, p. 1-8 (citation p. 4). / Ulrich Raulff, « Gedächtnis und Gegen-Gedächtnis: das Archiv zwischen Rache und Gerechtigkeit », op. cit., p. 117-124 (p. 119 : « Denn auch für nicht- oder kryptodemokratische Staatsformen gilt die Regel: Will der Inhaber des Gewaltmonopols dieses nicht aufs Spiel setzen, muss er auch das Informationsmonopol für sich reklamieren. »).
[5] Voir à ce propos l’article Wikipedia concernant l’indice de démocratie (page consultée le 04.10.2017).
[6] Jacques Derrida, Mal d’archive, Paris 1995, p. 15.
[7] La loi fédérale sur l’archivage (LAr) est entrée en vigueur le 1er octobre 1999. Les travaux d’élaboration de la loi ont commencé au début des années 1990.
[8] Cette loi, édictée par la Convention nationale, est accessible en ligne.
[9] Art. 7-8 du règlement du 15 juillet 1966 pour les archives fédérales (RS 432.11, état le 24 octobre 1973), Recueil officiel 1973.
[10] Dans la systématique du droit, la LAr se retrouve en position 152 (État – Peuple – Autorité (1), droits fondamentaux (15), liberté d’opinion et d’information (152)) et non plus en position 432 (École – Science – Culture (4), Documentation (43), Bibliothèques – Musées (432)). Il est intéressant de noter que l’ancrage de l’archivage dans la loi découle d’une loi de droit civil, la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1, du 19 juin 1992), qui impose une base légale pour le traitement des données sensibles. Dans la mesure où nous ne pouvons pas aborder ici les autres nouveautés, se reporter à : Andreas Kellerhals, « Das Bundesgesetz über die Archivierung: neue Chancen für die Zeitgeschichte », in : Revue suisse d’histoire 50 / 2000, p. 188-197 ; Andreas Kellerhals, « Unentgeltlicher Zugang zum Archivgut als Grundrecht. Art. 9 BGA als Konkretisierung der Meinungs- und Informationsfreiheit », in : traverse 10 / 2003, p. 57-68 ; Corinna Seiberth, « Erinnern und Vergessen in der Informationsgesellschaft », in : ARBIDO 4 / 2016 (version en ligne).
[11] Les chercheurs aiment bien évoquer la liberté de recherche qui, comme la liberté d’opinion, compte au rang des droits fondamentaux (liberté de communication). L’argument est que « malgré la possibilité de raccourcissement des délais de protection, la longueur des délais n’est pas compatible avec la garantie constitutionnelle de la liberté de recherche » [notre traduction] : Anna-Bettina Kaiser, « Archiv und Recht », in : Lepper / Raulff, note de bas de page 5, p. 107-117 (citation p. 110). Sur l’interprétation de la liberté de recherche (art. 20 de la Constitution fédérale, RS 101), voir le message relatif à la nouvelle constitution fédérale ou Giovanni Biaggini, BV Kommentar. Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, point 4 sur l’art. 20 Cst, Zurich 2007. La liberté de recherche est essentiellement un droit de défense : la pratique ne révèle pas de prétention à une prestation de l’État.
Cf. aussi : Entretien de Michel Lefebvre avec Étienne Anheim : «Nous sommes entrés dans un temps de scepticisme vis-à-vis de l’histoire et de la science», dans : Les querelles de l’histoire, Le Monde hors-série, (octobre) 2017, p. 6-11.
[12] Art. 10 (Principes) de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur l'archivage du 8 septembre 1999 (ordonnance sur l’archivage, OLAr, RS 152.11).
[13] Concernant les documents manquants / le silence des archives et leurs causes, voir la publication récente de David Thomas, Simon Fowler et Valerie Johnson, The Silence of the Archive, Londres, 2017.
[14] Art. 7 LAr : Détermination de la valeur archivistique et reprise de documents.
[15] Jürg Treffeisen, « Die Transparenz der Archivierung - Entscheidungsdokumentation bei der archivischen Bewertung », in : Nils Brübach (dir), Der Zugang zu Verwaltungsinformationen - Transparenz als archivische Dienstleistung. Beiträge des 5. Archivwissenschaftlichen Kolloquiums der Archivschule Marburg, publications de l’école d’archivistes de Marburg n° 33, Marburg, 2000, p. 177-189 (citation p. 179).
[16] Voir le communiqué de presse sur la réforme sans précédent du fédéralisme suisse.
[17] Voir le dossier détaillé de Franziska Brunner : Überlieferungsbildung 2.0. Eine Untersuchung zum Mehrwert von Partizipation Dritter in staatlichen Archiven, Churer Schriften zur Informationswissenschaft 89, Coire, 2017.
[18] Cf. l’annexe 3 de l’OLAr. Mise à jour chaque année, elle référence les fonds soumis à un délai de protection prolongé (plus de 30 ans). Cette publication peut donner lieu à des débats houleux, comme p. ex. en 2014 à l’occasion de la définition d’un délai prolongé pour 160 000 dossiers du service de renseignement / de l’armée. Voir https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143871 (page consultée le 04.10.2017).
Une procédure juridique peut être initiée pour exiger l’accès aux archives protégées. Dans la pratique, c’est rarement nécessaire dans la mesure où plus de 90 % des demandes de consultation sont acceptées.
[19] Thomas Buomberger, Raubkunst – Kunstraub. Die Schweiz und der Handel mit gestohlenen Kulturgütern zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, Zurich 1998, bibliographie p. 438 et s.
[20] Cf. le traitement du fonds photographique de l’ancienne compagnie aérienne Swissair : voir le blog News and experiences from the community - Swissair volunteers at ETH-Bibliothek’s Image Archive.
[21] Cf. la page du projet impliquant six archives.
[22] Max J. Evans, Archives of the People, by the People, for the People, in : The American Archivist 70 / 2007, p 387-400. Christoph Graf a utilisé ce titre comme sous-titre de son article Archive und Demokratie in der Informationsgesellschaft, in : Études et Sources, Berne, 2004, p. 227-271.
[23] Message concernant la loi fédérale sur l'archivage du 26 février 1997, Feuille fédérale 1997, p. 829-865 (citation p. 830).
[24] Cf. note 12, p. 9.
[25] Locution latine empruntée à Horace (Épitres, I, 2, 40) signifiant « Ose savoir » devenue la devise des Lumières selon Emannuel Kant (Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sapere_aude, page consultée le 11 décembre 2017)
- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires
La revue Ressi
- N° Spécial DLCM
- N°21 décembre 2020
- N°20 décembre 2019
- N°Spécial 100ans ID
- N°19 décembre 2018
- N°18 décembre 2017
- N°17 décembre 2016
- N°16 décembre 2015
- N°15 décembre 2014
- N°14 décembre 2013
- N°13 décembre 2012
- N°12 décembre 2011
- N°11 décembre 2010
- N°10 décembre 2009
- N°9 juillet 2009
- N°8 décembre 2008
- N°7 mai 2008
- N°6 octobre 2007
- N°5 mars 2007
- N°4 octobre 2006
- N°3 mars 2006
- N°2 juillet 2005
- N°1 janvier 2005
